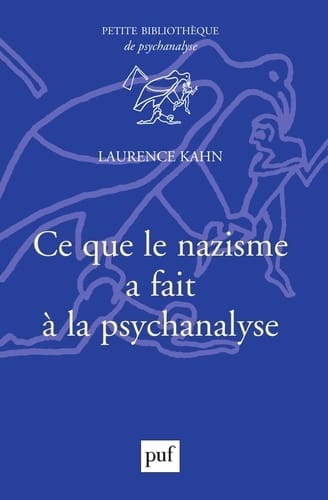« Les nazis ont pétrifié et détérioré les mots de la psychanalyse » répond Laurence Kahn dans un entretien avec Virginie Bloch-Lainé pour Libération, à propos de son nouvel ouvrage Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, que nous publions ici avec son accord.
« Il existe un lien peu intuitif entre l’empathie, actuellement sacralisée, la psychanalyse et le nazisme. La psychanalyste Laurence Kahn explique ce tissage dans un essai ardu et passionnant, Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. Les atteintes sont allées bien au-delà des mises à l’index des ouvrages de Freud et de l’exil des grands psychanalystes viennois en Grande-Bretagne notamment. La littérature, à travers Thomas Mann mais surtout Imre Kertész, est un des fils directeurs de ce livre.
Pourquoi avoir choisi ce titre, et non « Nazisme et psychanalyse » ?
Parce que « Nazisme et psychanalyse » aurait débouché sur une histoire des instituts psychanalytiques et des psychanalystes durant la période nazie. Elle est connue : Matthias Göring, cousin d’Hermann Göring, lance une politique d’aryanisation à laquelle participent certains analystes. Elle aboutit en 1936 à la création de l’Institut Göring, institut de psychologie et de psychothérapie présidé par Carl Jung. Les psychanalystes juifs s’exilent en masse avec l’aide de Jones ; certains sont assassinés. Mais ce que j’ai souhaité et essayé de repérer, au-delà de la catastrophe dans les vies individuelles, c’est la manière dont les nazis avaient atteint la psychanalyse dans son utilisation de la culture.
De quelles façons ?
Très tôt, l’usage nazi des mots de la culture fait écho au vocabulaire de la psychanalyse. Des mots qu’ils détériorent et pétrifient. Par exemple le mot « pulsion », Trieb en allemand, que la traduction française de Mein Kampf en 1934 restitue de façon erronée par « instinct ». De même, l’expression « pulsion d’autoconservation », mise par Hitler au service de la destruction d’une partie de l’espèce et de la justification d’un « Lebensraum ». Ou encore le terme d’inconscient ou celui de forces obscures. Plus largement, dans l’Homme Moïse et la religion monothéiste, Freud désigne le « grand homme » avec le terme « Führer ». Certes, le mot est banal en allemand, employé dès les premières traductions du Contrat social de Rousseau pour nommer le « chef ». Mais en 1934, sa charge est tout autre. Thomas Mann repère ces dévoiements et les souligne avec une ironie mordante dans Frère Hitler (1938), qui fit scandale, ou dans la Loi (1943). De même il insiste sur le fait que les nazis développent une théorie de la pulsionnalité et il en fait part à Freud – les deux hommes étaient en étroite relation. Lorsqu’on lit en allemand Mein Kampf ou le Mythe du XX siècle d’Alfred Rosenberg, on s’aperçoit qu’Hitler et sa « troupe » ne cessent de mettre à contribution ceux que l’historien Eric Michaud appelle les Grands Allemands – Goethe, Fichte, Kant, Nietzsche bien sûr. Il s’agit d’un véritable « art de la citation » qui aboutit à la corruption de la langue elle-même. Ce qu’étudient aussi Klemperer et Cassirer.
Pourquoi invoquez-vous autant Imre Kertész dans votre essai ?
C’était un survivant de l’Holocauste, un romancier, un lecteur de Thomas Mann et d’Adorno, et un traducteur de Freud. Il était en quête de la « langue d’après Auschwitz » qu’il voulait « atonale » pour indiquer la brisure que représentait Auschwitz. Il eut aussi le culot d’utiliser l’expression de « contre-culture nazie ». Culot, car « contre-culture » véhicule l’idée d’une avant-garde émancipatrice et créatrice. Kertész le fait après que les nazis, en fait de contre-culture, interdisent l’échange entre Einstein et Freud sur les causes de la guerre et les sources de la destructivité, qui devait paraître en trois langues en 1933.
Comment cette « contre-culture » atteint-elle la psychanalyse ?
Elle fut un renversement. Après Auschwitz, il faut réfléchir à la culture telle que l’entend la psychanalyse, c’est-à-dire à la façon dont nous vivons ensemble, à partir de ce meurtre inaugural nazi et non plus à partir du meurtre originaire du père, depuis lequel Freud conçoit les interdits civilisateurs. Mais rares sont les analystes qui ont investi ce terrain.
Quelles conséquences eut Auschwitz sur la pratique analytique ?
L’inflation de l’empathie, entre autres. En travaillant sur Shoah, de Claude Lanzmann, j’ai découvert un très grand nombre de textes issus de débats tenus autour du film. Ils étaient entièrement centrés sur la pathologie des rescapés, et ils expliquaient que Shoah était le film de quelqu’un définitivement traumatisé par les camps dans sa jeunesse, qui avait subi comme tous les rescapés un abrasement de la mémoire sous le coup du traumatisme. Selon eux, la théorie psychanalytique était trop sévère, trop froide pour s’adapter à l’écoute du patient traumatisé par Auschwitz. Ils reprenaient des enquêtes américaines de 1961 sur la pathologie d’un rescapé, affirmant que celui-ci souffre d’un trauma spécifique qu’il faut l’écouter avec une méthode spécifique : l’empathie. Le psychanalyste devait tenir la position de la mère pour réparer le rescapé : il ne restait plus rien de la théorie analytique.

Pourquoi l’empathie vous gêne-t-elle ?
L’idée qu’on va pouvoir en finir avec l’effroi en reconnaissant la douleur de la victime et qu’à soi seule, cela doit la réparer, est une position simpliste. Or elle s’est généralisée. Je me souviens de la page d’accueil d’un site psychanalytique américain, montrant des demandeurs d’asile syriens derrière des fils de fer barbelés, avec comme surtitre : « Empathy for refugees ». Notre empathie leur faisait une belle jambe. Est-ce que la responsabilité des psychanalystes ne consiste pas plutôt à se demander pourquoi ces réfugiés sont retenus derrière des fils de fer barbelés de triste mémoire ? Là, je retrouve Kertész, dont la langue est dénuée d’emphase et qui refuse absolument tout pathos pour écrire sur l’Holocauste.
Autre effet du nazisme sur la psychanalyse : la prégnance de l’identité…
En effet : pourquoi l’identité est-elle devenue le fer de lance de toute une psychanalyse qui adore réparer les troubles identitaires, alors que l’identité est aussi l’arme de guerre du refus des étrangers ? Le nazisme a atteint la théorie analytique là où pointe le mal qu’il nous a appris. Il a fait de l’identité un élément majeur, il a réveillé en nous une passion identitaire. Comme si le vœu nazi d’ignorer la complexité de la vie psychique s’accomplissait encore là. »
Virginie Bloch-Lainé
Accéder à l’article sur le site de Libération
Laurence Kahn, Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, « Petite bibliothèque de psychanalyse », PUF, 260 pp., 14 €