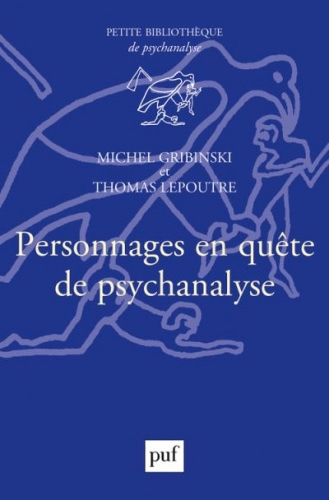Lorenzo Inghirami : Thomas, vous enseignez la psychanalyse désormais à l’Université de Paris et vous êtes un érudit de l’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Michel, vous êtes membre de l’APF, éditeur, traducteur, auteur et vous avez créé la revue Penser/rêver.
Votre livre à tous deux, Personnages en quête de psychanalyse, a créé en moi une ambiance de lecture particulière. Ces « personnages » – il y en a plus de deux cents – sont des hommes et des femmes qui ont eu un rôle dans la pensée, la préhistoire et l’histoire de la psychanalyse. Or il ne s’agit pas d’un répertoire, malgré l’ordre alphabétique où ils se succèdent, mais d’une galerie de portraits, à la temporalité déstructurée. Goethe y croise le petit Hans, Nietzsche côtoie le professeur de langues anciennes David Ernst Oppenheim. Benito Mussolini et Friedrich Rückert, l’auteur du fameux : « Ce qu’on ne peut pas atteindre en volant, il faut l’atteindre en boitant », sont sous la même couverture. Une galerie de portraits : cela fait penser à la galerie vasarienne, ce long couloir suspendu qui permet de passer de la galerie des Offices de Florence au Palazzo Pitti et fait découvrir des autoportraits, de tous les temps et de tous les lieux, d’Andrea del Sarto à Chagall en passant par Guttuso.
Lorenzo Inghirami : Vos deux propres « personnages » m’intriguent : comment est née votre collaboration ?
Thomas Lepoutre : Michel a édité dans « Connaissance de l’Inconscient », chez Gallimard, la correspondance inédite entre Freud et Bleuler à laquelle je travaillais depuis longtemps, et…
Michel Gribinski : …et nous avons fait connaissance. Nous avons chacun découvert la façon de travailler de l’autre, qui était complémentaire. Bref, le plaisir du travail commun a été réciproque. Jamais d’anicroches entre nous, mais une entente réelle sans complaisance. Pour ce livre, chacun a pris la responsabilité d’un certain nombre d’auteurs, en fonction de son intérêt personnel. Puis nos choix – à mesure qu’ils faisaient des allers et retours entre nous deux – sont devenus des « personnages » : leur héroïsme s’est imposé à nous, signe que notre travail aboutissait. « Notre travail » : impossible de dire qui a écrit quoi, du fait que chacun s’est mêlé du texte de l’autre qui s’est mêlé alors de corriger le nouveau texte, et ainsi de suite.
Th. L. : Plus encore : chacun à tour de rôle a été à la fois premier auteur et premier lecteur.
Lorenzo Inghirami : J’imagine que cette façon de travailler a permis cette forme particulière : des « hétéroportraits »…
M. G. : Exactement : nous nous sommes parfois fortement identifiés à l’« autre » qui est dans le portrait. Et cela a été un résultat inattendu. Au début il s’agissait de mettre en forme les éléments de vie et les travaux de gens auxquels Freud s’était intéressé et qui l’accompagnent dans ses écrits, et puis, très vite c’est devenu une histoire de la psychanalyse dans laquelle nous nous sommes retrouvés. En outre, quelque chose d’une tragédie s’est installée d’un auteur à l’autre, et dans leur vie comme dans leur pensée. Nous nous sommes rendu compte aussi que c’était une époque assez folle, avec des auteurs que l’on ne prendrait pas en considération aujourd’hui, et des hommes et des femmes qui affrontaient souvent des risques immenses. Freud, lui, les prend parfaitement au sérieux, il les prend avec leur folie, leur pensée déraisonnable.
L. I. : Une tragédie… Le titre que vous avez choisi évoque la pièce de Luigi Pirandello de 1920, contemporaine donc de l’époque freudienne, « Six personnages en quête d’auteur.«
Th. L. : Je ne sais plus comment nous avons arrêté ce titre en réalité. Il y avait eu plusieurs suggestions, de nous et de Jacques André, notre éditeur. Dans le titre finalement retenu, ce n’était pas tellement le clin d’œil intertextuel à Pirandello qui avait principalement retenu mon attention, mais le fait que les noms que l’on rencontre dans ce livre ne devaient pas simplement se figer comme ceux de célébrités, ne devaient pas prendre une allure biographique encyclopédique, comme dans un dictionnaire – ils devaient également s’animer comme des personnages de théâtre ou de roman. Nous avons certes emprunté autant que possible à la recherche de la vérité historique, mais sans refuser celle, mélangée, de la fiction transférentielle et de la factualité. C’est pourquoi, nous avons souvent souhaité privilégier un trait de caractère, un élément biographique ou personnel, pour justement donner à nos « héros » une dimension et de personnage hors du commun et de personne humaine. J’ai été sensible à ce que le titre final en disait : de drôles de personnages, que l’on rencontre un par un, en quête de : la dynamique d’une quête, donc en germe quelque chose d’inabouti dans ces vies exceptionnelles, c’était ça, l’intéressant.
L. I. : La quête. En effet, tous ces personnages aux multiples facettes cherchent, chacun de leur côté et finalement tous ensemble.
M. G. : La quête, oui. Certes, Pirandello est présent. Son titre est actif et a beaucoup fonctionné : il existe en français plus de dix titres construits sur le modèle « en quête de ». Mais, essentiellement, l’attrait d’une quête, c’est qu’elle n’est pas assurée. La quête de psychanalyse, c’est aussi la possibilité, le risque (la chance ?) de se tromper, d’errer, d’être au service de la résistance, sans le vouloir, sans le savoir – ou de le devenir. La quête n’est pas un mouvement linéaire, même s’il est tendu. Un certain nombre de nos personnages se sont trouvés un beau jour en train de lutter ouvertement ou secrètement contre la Cause et la chose freudiennes.
Th. L. : Oui. La quête est une manière possible d’aller contre. De ce point de vue en effet, on voit bien que si certains sont encore et toujours en quête de la psychanalyse, c’est pour l’attaquer et néanmoins pour mieux continuer de la chercher, un peu comme lorsque l’on rejette au loin la « chose » tout en continuant secrètement de la titiller, sur le mode de la formation réactionnelle, où l’on est attiré par ce que l’on condamne. Certains auteurs d’hier et d’aujourd’hui (notre livre veut éclairer le présent !), en luttant contre Freud, sont passionnés par lui. C’est valable aussi pour les disciples qui n’ont pu que se déterminer par rapport à Freud, et ont parfois erré dans leur cheminement à côté de lui ou contre lui. Cela vaut aussi pour les psychanalystes restés les plus fidèles à Freud : c’est la (fausse) naturalité du lien à l’analyse qui est subvertie par cette notion de quête.
M. G. : Rien de pire qu’un disciple en psychanalyse… Mais, en psychanalyse, du moins dans ses débuts rien d’autre – sauf Freud ! Les auteurs littéraires qui ont précédé la découverte, Freud montre qu’ils étaient en quête de quelque chose qui n’a pas trouvé sa formulation sauf quand l’analyse a été inventée. C’est très drôle avec Goethe, qui devient, sous la plume de Freud, un disciple avant l’heure de la psychanalyse. Freud a eu le prix Goethe. On donne le prix Goethe à des écrivains, des auteurs ou des chercheurs pour qui Goethe a compté et ils sont sensés dans leur discours montrer en quoi. Que fait Freud dans son allocution ? Il montre, à l’inverse, en quoi la psychanalyse non encore inventée a compté pour Goethe. Il renverse complètement la perspective et fait du célébrissime Dichter un individu en quête d’un sens analytique non encore abouti.
Th. L. : Du reste, du point de vue méthodologique, Freud aimait beaucoup une formule de Cromwell que nous avons parfois repris à notre compte dans notre manière de travailler : « Dans la vie on va toujours plus loin quand on ne sait pas où on va. »
M. G. : Formule de conquistador, d’ailleurs prêtée d’abord à Christophe Colomb, puis à Napoléon, et que nombre d’écrivains – ce sont des explorateurs – se sont attribuée. On voit en quoi elle plaît à Freud. Savions-nous ce qu’allaient découvrir les mini-explorateurs que nous étions, Thomas et moi, et où nous allions aller ? Pas sûr du tout. Mais l’exigence du « plus loin » était présente.
Th. L. : Freud revendique en effet la formule pour l’analyse et pour lui-même. La quête est mouvement vers un but qu’on ne soupçonnait pas.
M. G. : C’est d’ailleurs la même quête, le même mouvement, sur le divan. Et dans l’écriture : nous nous sommes glissés parmi les « personnages en quête de psychanalyse », jusqu’à chercher parfois une définition de l’engagement analytique à travers ces « vies brèves ».
L. I. : Ça témoignait bien effectivement, quand vous en avez parlé tout à l’heure, de la « folie » ambiante, question qu’on retrouve à la fois avec ces personnages mais aussi avec la dimension subversive de la psychanalyse. Mon lien avec Pirandello vient aussi du fait que la pièce de théâtre a été accueillie, le soir de première, par un public qui scandait : « Asile ! Asile ! » Encore aujourd’hui, la psychanalyse passe pour une histoire de fanatiques, et notamment chez les jeunes médecins les plus éduqués, les plus « scientifiques ».
M. G. : C’est une chance : quand l’analyse sera complètement intégrée par la sensibilité scientifique et le sens commun, ce sera sa fin. Mais vous trouvez que l’analyse suscite encore beaucoup de choses ?
L. I. : On continue d’en parler beaucoup, dans les médias, dans le cinéma : c’est une référence de l’imaginaire collectif. On n’arrête pas de l’attaquer. Elle continue d’animer les débats et la polémique, et parfois elle fait scandale.
Th. L. : Ceci m’évoque une formule qui était déjà active il y a un certain temps, je crois même que nous l’avons évoquée dans le livre au sujet d’Alfred Hoche – un professeur de psychiatrie très critique de Freud toute sa vie, pas loin de souscrire à l’idée que le scandale psychanalytique ne devrait pas occuper les scientifiques mais devrait être plutôt l’affaire de la police, ayant déclaré que les tenants de Freud, victimes d’une « épidémie psychique », étaient nécessairement, je cite, « mûrs pour l’asile » (Pirandello pas seul…). Accuser les analystes : le motif n’est pas nouveau et faire un peu d’Histoire permet de retrouver les résistances chroniques et structurelles que l’analyse soulève depuis ses premiers moments…
M. G. : Est-ce si faux, en même temps, de dire qu’il y a une folie chez les analystes ? Ne serait-ce que dans ce qui conduit à écouter des discours incohérents (des « associations libres ») des huit et dix heures par jour. Et cette autre folie qui consiste à chercher la vérité ? Et la folie qu’installe le transfert réciproque du patient et de l’analyste, folie à deux, folie circulante de l’un à l’autre ?
L. I. : On pourrait dire une folie nécessaire ?
M. G. : Sûrement, oui. Une folie méthodologique. Demander aux gens de s’allonger pour parler d’eux à quelqu’un qu’ils ne connaissent pas c’est totalement hors norme, anormal, et cela retentit sur la pensée de la méthode, sa théorie. Dans la correspondance entre Freud et Lou Andreas Salomé, c’est sans cesse présent : Il faut ménager le chaos, lui écrit Freud, il faut de l’obscurité : vous mettez de l’ordre et de la lumière et ce n’est peut-être pas mal aussi, mais enfin, moi, je ne peux travailler que de façon fragmentaire…
On sait que les fragments en question ne suivent pas la logique ordinaire. On ne peut pas dire que Freud fasse appel à la raison – plutôt à sa dictature, à son propre tyran.
L. I. : On voit Freud à travers ces portraits et je l’imaginais en chef de file, en chef d’orchestre. J’ai l’impression qu’il se nourrit énormément de tous ces personnages, de toutes ces figures et il y a quelque part une sorte d’humilité de Freud dans la façon dont il se nourrit de la créativité des uns et des autres, de leurs intuitions, de comment ils se confrontent à ses propres découvertes. Il y est attentif et à la fois il y a une exigence de sa part de tenir son projet, de donner une cohérence à sa découverte, à sa création. Dans ses correspondances on trouve rigueur et intransigeance. Peut-on dire qu’il a une main de fer dans un gant de velours ?
M. G. : Freud est en train de découvrir quelque chose – une méthode d’exploration de l’inconscient – qui n’avait pas encore eu lieu et qui a changé la façon laïque de penser le monde, qui a introduit une pensée différente du monde occidental : il a affaire à une vérité nouvelle – et il écrira que la vérité n’est pas tolérante, nicht tolerant, qu’elle est unilatérale, einseitig. La vérité doit être poussée, explorée, confrontée : cela occupera sa vie toute entière – mais je ne crois pas que l’homme ait, comme vous le proposez, une « main de fer dans un gant de velours ». Il est extrêmement tolérant avec les gens qui travaillent autour de lui. Il accepte des choses qu’aujourd’hui on n’accepterait certainement pas. Quand Ferenczi parle du transfert ou de la suggestion, tout un coup ça n’a plus rien à voir avec ce que dit Freud, mais ça ne dérange pas Freud du tout. Il s’est référé à plusieurs reprises, aux « schibboleth » de la psychanalyse, ce qui fait le partage entre l’analyse et ce qui n’en est pas : le transfert (et la résistance), pour la technique, la sexualité infantile inconsciente, pour la chose même. Quant au reste (mais y a‑t-il « reste » ?), chacun est libre, et cette liberté qui fait parfois dresser les cheveux sur la tête est tout à fait évidente chez nos personnages, dans leur rapport à l’analyse freudienne.
Th. L. : Les « piliers de la théorie » psychanalytique sont sans cesse secrètement menacés par la résistance. Naturellement, on retrouve chez tous les analystes, à divers degrés et avec des variantes (d’ailleurs assez peu nombreuses, assez peu inventives) les errements de Ferenczi quant à la suggestion ou plus tard quant à l’analyse mutuelle. On les retrouve non moins actifs chez les analystes qui apportent leur pierre à l’édifice que chez ceux qui contestent lesdits piliers – ce sont parfois les mêmes. En ce sens, je ne crois pas que nous ayons voulu brosser un portrait négatif de Freud en chef d’école cherchant à « clouer l’héritage » ; s’il l’a été de fait, il l’a été sans doute plus par le regard que les uns et les autres ont porté sur lui que par son propre geste. Ce qu’on voit beaucoup dans ces « personnages en quête de psychanalyse » et parfois en quête de Freud, c’est leur transfert à Freud ; et c’est par le prisme de leur transfert sur Freud qu’on le voit parfois tantôt comme un chef, tantôt comme un père, tantôt comme un tyran. Par définition Freud est caléidoscopique, il est composé par la mosaïque des différentes relations des uns et des autres avec lui – jusqu’à nous d’ailleurs. Je crois que les personnages sont intéressants pour ça aussi : de façon indirecte ils offrent un certain regard sur Freud et ils complètent ainsi son portrait qui s’achève chez les disciples et les dissidents. A contrario notre livre a Freud pour axe, mais Freud n’y figure pas et ceci dit aussi quelque chose. Habituellement, il est la figure centrale, rayonnante qui dit tout de l’analyse. C’était intéressant pour nous, par rapport à aujourd’hui, de montrer comment, autour de lui, beaucoup de gens ont contribué à (re)dessiner sa figure.
L. I. : Votre livre donne en effet l’impression d’une sorte de révolution copernicienne : il inverse la perspective, l’angle de vue. Une redécouverte de Freud se propose au travers les regards de tous ces personnages.
Th. L. : Effectivement, et en ce sens il ne nous est pas tellement apparu comme celui voulant fixer son héritage, mais plutôt comme celui qui autorise un certain nombre de divagations – quitte à les suivre à l’occasion d’ailleurs, puisqu’il a parfois accompagné certains analystes dans des questions un peu folles. Je pense à la télépathie, à l’occultisme. Il a suivi de loin ou de moins loin, et longtemps, certains analystes, tout en disant qu’il serait mieux, pour la psychanalyse, que certains analystes se tiennent à l’écart de ces questions.
M. G. : Une des résistances à l’analyse, c’est d’en faire une série d’anecdotes (je suis loin d’y échapper). Quand on parle de Freud, quand on parle des gens avec qui il a travaillé, on transforme ça en petites et moyennes histoires, sinon en rumeurs et gossips imaginaires. Il me semble que nous avons pris d’abord le point de vue anecdotique pour, ensuite, le transformer. En faisant des portraits, en construisant des vies brèves, en prenant un trait ou un autre d’un auteur pour essayer de définir sa trajectoire en quelques lignes, on est paradoxalement sorti de l’anecdote et très vite quelque chose de général s’est installé et a fabriqué une autre histoire de la psychanalyse, marquée aussi par le destin de chacun de ces personnages. C’est très frappant de voir que la plupart d’entre eux terminent leur vie soit en exil, soit dans les camps de concentration. On oublie vite le prétexte immédiat – la judéité et, chez certains, la conscience politique – pour penser que prime l’objet intellectuel et l’engagement de ces gens : cela dit quelque chose de la pensée de l’analyse qui est une pensée en exil, et une pensée qui tend à modifier les destins individuels. Une pensée qui n’a pas de place fixe, assignée ; qui ne trouve jamais sa place et chacun de ces personnages a une activité dans le déplacement, dans l’absence de place, dans la place qui n’est jamais celle-là, dans la place dont on est en quête toujours aujourd’hui – l’analyste est toujours aujourd’hui en quête de psychanalyse. Si un analyste vous dit : « Ça, c’est la place de l’analyse, et donc c’est ma place, et c’est bien comme ça », vous soupçonnerez évidemment qu’il est en proie à l’activité de la résistance – ou en délicatesse avec sa femme ou son mari !
L. I. : Ces questionnements, chaque analyste se les pose et repose avec chaque patient ?
M. G. : Et ils s’imposent à lui. Ce qui s’impose à lui, ce sont des ruptures, des ruptures dans la pensée. Lou Andréas Salomé a un parcours totalement inattendu avant d’arriver à l’analyse, et là il y a une rupture pour elle qui est manifeste. Entre la personne qui s’exhibe en train de fouetter Nietzsche et Rée attelés à la charrette dans laquelle elle est, et celle à qui Freud dit : « Même quand on dit les choses les plus horribles votre regard s’allume comme si c’était Noël », il s’est passé quelque chose. Il se passe quelque chose qui n’est pas attendu par l’analyste lui-même. Et je crois que chacun de ces personnages prend ça en charge dans nos descriptions.
L. I. : Est-ce qu’on pourrait dire que ces personnages évoluent entre résistance et désir ? Entre résistance à la psychanalyse et désir d’analyse ?
M. G. : Certainement. Mais ils ne savent pas toujours que c’est, au fond, la même chose. Ils hésitent : est-ce que je veux être tiré, ou est-ce que je préfère être poussé ?…
Th. L. : Toutes ces trajectoires, une par une, donnent l’idée d’un rapport individuel à l’analyse. Parfois, en croquant juste une particularité, un trait du « personnage », ce qui survient, loin d’être anecdotique, c’est la chose même, et par exemple la résistance même, ou exemplairement le désir. Freud avait une belle formule : « L’exemple, c’est la chose même. »
M. G. : Une anecdote qui n’en est pas une va dans ce sens-là : le critique Georg Brandes au milieu d’une longue conversation avec Freud se décide et : « Je dois vous dire, je n’ai jamais désiré sexuellement ma mère. » « Mais vous savez, dit l’autre, vous n’avez pas besoin de l’avoir su, c’est inconscient. » Et Brandes de dire « merci, merci ! », en lui prenant les mains…
Th. L. : Dans ce mouvement particulier, on voit bien que quelque chose du rapport à l’analyse se joue, non comme dans un dictionnaire ou un curriculum, mais parfois dans un tout petit rien très simple, un mouvement de la main, un élan de soulagement où se tient un peu de l’essentiel. Nous avons privilégié ces petits riens par rapport au sérieux d’une description exhaustive, objective, universitaire. Un aveu : à cet égard, notre collaboration avec Michel m’a beaucoup aidé à me défaire de réflexes académiques – disons de symptômes académiques – qui s’imposaient à moi, pour faire, sur ce coup, autre chose.
M. G. : À côté de ces petits riens qui condensent quelque chose d’essentiel de l’analyse, il y a de temps en temps, dans cette galerie de portraits, des vies beaucoup plus longues qui mettent l’époque en scène et sont exemplaires non plus de l’analyse mais de l’ambiance sociale et intellectuelle dans laquelle l’analyse a pu germer et pousser. Ainsi de l’arrivée d’Anita Berber au détour de l’histoire de Sidonie Csillag – la « jeune homosexuelle » : Anita Berber c’est, absolument, la première danseuse intégralement nue. Or elle est dans le paysage, à la fois dans ses marges et dans sa signification. Autre exemple : Freud avait Eugenia Sokolnicka en analyse, qu’il ne supportait guère au contraire de Ferenczi, son second analyste. Et voilà qu’il la délègue, de façon ambiguë, à Paris, où elle tombe dans un milieu médical, réactionnaire, antisémite, misogyne et anti-analytique. C’est toute une époque qui donne leur relief aux difficultés et à l’empreinte de la psychanalyse à Paris.
Th. L. : Cela nous a frappés : dans chaque portrait, il y avait le paysage. Et derrière chaque figure, on retrouvait l’époque qui a rendu l’analyse à la fois impossible et possible (comme vous le dites : résistante et désirante) – l’époque de la découverte, qui fait partie aussi de l’imaginaire analytique.
Mais j’aimerais par ailleurs dire un mot de l’hétérogénéité de ces vies brèves, de leurs longueurs assez diversifiées. Il m’a été difficile, comme auteur, de le justifier : nous nous attardons parfois longuement auprès de certains portraits peut-être secondaires, et nous allons parfois très vite avec les monuments, Goethe ou Nietzsche par exemple. Sokolnicka est plus longue que Ferenczi, si l’on peut ainsi parler. En fait, cette hétérogénéité tient vraiment au fait que nous avons composé une galerie : comme dans un musée, on s’attarde parfois longuement sur des tableaux qui retiennent l’attention mais qui ne la méritent pas forcement, et on peut passer rapidement devant une toile trop connue.
M. G. : Il y avait ça – mais je suis beaucoup plus paresseux que Thomas et, pour moi, faire une vie à la fois conséquente et brève de Nietzsche aurait demandé un travail dont je ne suis pas capable. Et puis l’entreprise elle-même ne le justifiait pas. Nous avons a été saisis plus par la relation de ces gens avec l’analyse – ou la relation analytique de Freud avec eux – que par leur vie propre.
L. I. : Les gens de la première génération d’analystes (les parents des enfants de l’analyse…) étaient jeunes : l’approche de l’analyse, l’approche de Freud est marquée par cette jeunesse. C’est différent aujourd’hui. C’est à l’adolescence qu’on attribue la soif révolutionnaire, la rébellion, et simplement le pouvoir d’oser s’opposer.
Th. L : Question difficile ! C’est vrai : certains d’entre eux étaient vraiment jeunes. Theodor Reik, Otto Rank, Victor Tausk, sortaient de l’adolescence au moment où ils ont rencontré Freud et se sont engagés auprès de lui. Mais est-ce que cela a vraiment changé ? Je ne sais.
L. I. : Il y avait une sorte de fulgurance dans la façon dont l’analyse venait saisir ces jeunes psychanalystes, et c’est probablement toujours d’actualité aujourd’hui.
M. G. : Cela ne venait pas saisir de jeunes psychanalystes…
L. I. : …En effet, ils n’étaient pas encore psychanalystes.
M. G. : Ils le deviennent sous nos yeux dans ces vies brèves. Peut-être pas chacun d’entre eux, mais quelque chose fait tout d’un coup sentir que l’analyse les transforme. Le seul psychanalyste de cette première époque est Freud.
L. I. : Autre chose (pas trop éloignée sans doute, car la jeunesse est inventive et pressée) m’a retenu en lisant votre livre : les questions des débuts continuent de se poser aujourd’hui, comme la durée de l’analyse, la tentation d’abréger le traitement. Au-delà du fait que les cures se déroulaient sur des temps plus courts et dans des conditions de setting différentes. Vos personnages, parfois au moment de s’éloigner de Freud et de l’analyse, se confrontent à ces questions.
Th. L. : Peut-être ces questions-là sont-elles structurelles et actuelles comme elles l’étaient à l’époque. Il y a le risque qu’elles le demeurent puisque dans la relation trouble à l’analyse, dans notre quête à tous, les forces qui tendent à se défaire d’elle sont constantes, y compris sur le mode du rétrécissement d’une cure expédiée. Freud nous avertissait à sa façon : il n’y a rien dans l’essence de l’homme qui le prédispose à s’occuper de psychanalyse. S’occuper de sa propre psychanalyse entre autres, évidemment.
M. G. : Octave Mannoni disait, dans une soirée de débats : « Il n’est pas vrai que la cure analytique aujourd’hui dure beaucoup plus longtemps que dans les débuts. » Il ajoutait que, simplement, on mettait beaucoup plus de temps à la commencer. Mais que, quand l’analyse commençait, elle allait aussi vite qu’au temps de Freud. Cela me semble très juste, on en fait l’expérience sur le divan. Quand ça démarre, ça va vite. Mais il faut du temps pour que l’analyse commence, ce dont les analystes sont et ne sont pas responsables : ils savent d’avance que, lorsqu’ils disent « allongez-vous » à quelqu’un, ce quelqu’un ne va pas se mettre à protester : « Quoi ? Qu’est-ce que vous me demandez ?! » Du coup la cure prend un retard considérable.
L. I. : J’associe sur l’échange que vous rapportez entre Eduardo Weiss et Freud. À la question que pose Weiss de savoir s’il est judicieux d’analyser son propre fils, Freud répond : « Avec un fils je ne sais pas, je ne vous le conseillerais pas, mais, avec ma propre fille, j’ai bien réussi. » Il le déconseille en soulignant la différence des enjeux.
M. G. : On voit bien ce qu’il veut dire. La soumission passive homosexuelle au père est un terrain totalement différent pour l’analyse de celui de l’attachement œdipien de la fille et de son exigence d’obtenir enfin ce qui – croit-elle – lui fait défaut.
L. I. : Pour continuer sur Anna Freud, je trouvais très intéressant la façon dont vous avez témoigné des fantasmes que cela a suscités, et des différentes versions de la chose dans les biographies d’Anna.
M. G. : C’est grâce à Wikipédia. Nous avons mis en perspective tout ce que les gens y disent d’Anna Freud. Sur Wikipédia, il y a tout et son contraire, de façon passionnelle, engagée, lointaine, ahurissante et presque tout tourne autour de l’homosexualité d’Anna Freud. De même avons-nous essayé de n’esquiver aucune des gênes que l’on peut avoir, à tort ou à raison, avec certaines positions ou déclarations de Freud, qu’il s’agisse de sa propre vie sexuelle, de l’analyse de sa fille, ou encore de sa fameuse dédicace à Mussolini.
Th. L. : Nous avons voulu ne pas faire le ménage de la psychanalyse dans son histoire. Si des choses sont désagréables, pourquoi les éviter ? Nous ne sommes pas en cause et, si nous avons été contaminés (ce que nous espérons vivement !) par « l’épidémie analytique » dont parlaient Hoche et Freud, nous n’avons pas pour autant souhaité immuniser l’histoire après-coup. L’histoire de la psychanalyse est tellement orientée, tendancieuse, aujourd’hui, qu’il ne s’agit plus de corriger ou de ne pas corriger les fantasmes qu’elle suscite. Des « dossiers Freud » poussent comme en famille, en se ressemblant et en s’assemblant, et il convient simplement de souligner la qualité fantasmatique de ce dont il se nourrissent. Je songe ici, par exemple, à la notice relative à Minna Bernays, sa belle-sœur. Comme on le sait, il existe un dossier (on se croirait dans les sous-sols d’un ministère de l’intérieur néo-soviétique) sur la grave question de savoir si, oui ou non, où et quand, Freud a couché avec sa belle-sœur. Que la chose soit avérée ou non, elle parle de chacun autant que de Freud et sans doute plus : l’envie de salir la psychanalyse et son créateur, l’excitation soulevée dans le geste d’aller renifler les draps, rend très important le fait de savoir si, quand, où, et avec qui Freud a joui, et cette forte question a même mérité un gros titre dans le New York Times ! C’est dire que le public et non Freud, est au centre et le moteur de ladite forte question. Le fantasme, là, est sans doute que l’on va pouvoir visualiser la vraie scène primitive…
M. G. D’ailleurs l’article du New York Times est illustré ! Une photo montre une chambre d’hôtel où cela aurait eu lieu et pousse l’inanité (l’insanité ?) jusqu’à exhiber « la » chambre …telle qu’elle est refaite cent-huit ans plus tard. Passionnant, is it not ?
Th. L. : C’est assez caractéristique du genre de passions que peut susciter encore aujourd’hui l’histoire de la psychanalyse, et qui s’interprète comme un symptôme.
*
L. I. : Je trouvais en vous lisant que la forme choisie laissait beaucoup de liberté – dont celle de se dégager de quelques symptômes… Ces événements de vie n’indiquent pas une direction à suivre ; les époques sont déstructurées, et l’ordre alphabétique n’empêche pas de lire, comme je l’ai fait, une page après l’autre, ou bien d’ouvrir le livre au milieu ou à la fin.
M. G. : Vous l’avez lu en suivant l’ordre alphabétique ?
L. I. : Oui, et cependant je me suis laissé entrainer, comme dans un roman. La liberté que j’évoque ne manque pas d’être paradoxale, puisque le lecteur est peu à peu obligé de se laisser impressionner au sens photographique par ces vies et leurs traits singuliers.
Th. L. : C’était tout à fait notre souhait : que le livre soit lisible dans l’ordre et dans le désordre, ce qui pouvait, ordre et désordre, être l’écho, sinon rendre compte, de ce qui régnait alors dans la psychanalyse, dans l’époque, dans l’Histoire elle-même. Nous souhaitions aussi que l’on puisse « piocher » un nom, parcourir la notice, noter une date, un lieu, l’orthographe du nom lui-même, et refermer le livre, comme on le fait avec un outil de travail familier.
M. G. : Le livre est une construction subjective de faits objectifs. Tout y est vrai – je rends grâce à Thomas qui est un érudit de l’histoire de l’analyse et de la psychiatrie. Tout y est vrai, y compris notre vérité : ce n’est pas un livre objectif, et nous y sommes, avec nos choix, nos réticences, nos emballements. Ces personnages, leur conversation secrète, nous représentent probablement un peu, Thomas et moi, dans notre déraison personnelle aussi – mais, cela, le lecteur ne le saura pas.
Th. L. : C’est vrai que même dans l’objectivité de la « vérité matérielle », ces histoires-là sont toujours altérées par la vérité transférentielle de notre rapport à la psychanalyse : mieux vaut donc assumer le rôle qu’y tient notre relation à « nos » personnages.
M. G. : Une conséquence est que, lorsque je feuillette le livre, certaines de ces « vies » me plaisent beaucoup, et d’autres ne me plaisent pas. J’ai l’impression de rencontrer des aspects agréables ou désagréables de ce que j’y ai mis – alors qu’on pourrait dire que c’est simplement untel, dans son propre portrait, dont les traits sont plaisants ou pénibles. Le texte s’est mis à vivre sa propre vie (pas brève, j’espère).
L. I. : Le choix de ces personnages est à la fois presque exhaustif, soumis à un travail de recherche et de vérité, et j’imagine en même temps que vous avez laissé un certain nombre de personnages de côté, que vous avez opéré un tri.
M. G. : Oui, on a certainement laissé des auteurs de côté, mais je suis incapable de dire lesquels.
L. I. : Je me suis posé la question de savoir s’il y en avait certains que vous aviez exclus.
M. G. : Est-ce qu’on a exclu de gens ? je ne crois pas… Je me tourne vers Thomas.
Th. L. : « Qui est manquant ? » est une bonne question, et une question difficile. Ce qui est certain, c’est que dans notre rédaction, nous avions des personnages candidats, sur lesquels nous souhaitions nous pencher et où, à l’enquête, on ne trouvait pas grand-chose. Freud s’est intéressé à tel philologue, tel ethnologue, tel professeur de psychologie, le distingue et l’introduit dans l’œuvre, mais, à l’enquête, l’intérêt n’était pas au rendez-vous : comme s’il n’en restait rien qu’une mention et non un personnage.
M. G. : Ce n’est pas qu’il n’y avait tout à fait rien, que la vie et l’œuvre auraient été vides, non. Mais rien ne nous y dérangeait, et même la question de savoir pourquoi Freud s’y était arrêté avait quelque chose de trop évident. Toute notre « subjectivité » n’y aurait pas suffi : l’auteur n’était pas fichu de devenir un « personnage », même quelconque, et j’ai parfois couru après un « personnage ordinaire », sans le trouver.
Th. L. : Il n’y avait aucune accroche qui nous donne envie d’aller plus loin, si ce n’est de dire bêtement les raisons pour lesquels tel auteur était cité par Freud. Quand il n’y avait pas de prime de plaisir, disons, à l’enquête historique, ou prime de subjectivité, on laissait tomber. Du coup quelques candidats pressentis ont été retranchés. De toute façon rien de mécaniquement exhaustif n’a présidé à nos choix. Nous aurions pu suivre l’index des personnages cités par Freud, mais nous avons préféré appliquer un « principe de lucidité sélective » : le choix tient au fait que, d’un point de vue lucide on ne peut pas méconnaitre l’auteur en question, en sachant qu’on ne pourra ni parler de tous ni tout dire de chacun. Donc, bienvenu aux auteurs qui nous plaisent.
M. G. : Mais pas seulement : j’ai été, comme Thomas, fortement saisi par les auteurs qui, a priori, posent un problème non soluble. Ceux qui nous confrontent à quelque chose non d’énigmatique, le mot est trop plat, mais plus simplement à de l’obscur. Avec tel auteur, il se passe quelque chose qu’on ne saisit pas et, quand il y a « du » problème, ça devient très intéressant.
L. I. : N’est-ce pas là l’intérêt des Correspondances, qui n’apparait pas dans les textes « scientifiques » de Freud ? Les Correspondances ménagent cette partie (plus) obscure.
M. G. : Sans aucun doute. L’obscurité de fond, qui est en même temps le moteur de la pensée analytique, s’expose sans embarras dans les lettres que s’écrivent ces gens, dès qu’ils se connaissent un peu et sont un peu en confiance. La plus curieuse des « obscurités » logiques, c’est que, dans cette enquête, cette quête, cette recherche analytique – celle de Freud, des analystes qui l’ont accompagné, des analystes qui l’ont suivi, de nous aujourd’hui – l’enquêteur est la même personne que l’assassin, le détective et l’assassin sont la même personne, comme Œdipe exactement, et ça c’est une obscurité de principe en quelque sorte. Comment peut-on fonder une pensée (je ne parle même pas d’une « science ») sur cette confusion nécessaire entre qui a commis le délit et qui recherche celui qui a commis le délit. C’est une obscurité merveilleuse, comme dans les contes fantastiques d’Hoffmann, ou de certains de textes de Hofmannsthal, ou encore certains romans de Faulkner : l’implication du lecteur est obligée à ce moment-là, mais il ne peut pas dire pourquoi. Le lecteur ne peut pas rester à l’extérieur, l’analyste ne peut pas rester en dehors, et l’un pas plus que l’autre ne sait pourquoi en vérité.
L’obscurité dans le champ de l’analyse n’est pas juste un problème intellectuel : c’est une question centrale pour le mouvement même de la découverte et de ses prolongements aussi bien thérapeutiques, que méthodologiques, que théoriques. Et ça a l’air d’être facile à dire comme ça, mais quand on se rend compte à quel point c’est vrai, cela devient déconcertant, extraordinairement dérangeant et comme un peu déréel ou fou – disons que c’est dans cet éventail-là.
L. I. : En vous écoutant, on pourrait dire que, lorsqu’on écrit de la psychanalyse, on est confronté au mouvement même de la cure.
M. G. : Oui ! Mais écrit-on de la psychanalyse ? Ce serait probablement alors mal parti… Quand on dit que l’on écrit de la psychanalyse, que veut-on dire ? Est-ce pour faire un peu plus de théorie sur la théorie de la théorie ? Ou bien pour faire servir la clinique à ce qu’on veut démontrer ? Le conseil de Freud à Ferenczi est essentiel : on ne fait pas de théorie, elle s’impose à vous comme un invité qu’on n’avait pas prévu. De la même manière, je crois que l’on n’écrit pas « de la psychanalyse », l’écriture s’impose comme quelque chose qui n’était pas au programme.
Th. L. : Cela nous est plusieurs fois tombé dessus. On savait que certains personnages auraient une place, mais on ne savait pas encore laquelle, et son retentissement sur l’ensemble était moins encore prévisible.
M. G. : Et parfois cela donnait un sens après coup à tout un travail déjà fait.
Th. L. : Cet imprévu dans notre propre quête a souvent retenu notre attention et a donné sa nécessité à une notice. Cette imprévisibilité-là m’a plu. Je songeais à telle chose, je ne l’avais pas formulée comme ça, et c’était ma quête envers ces personnages qui prenait forme, une quête libidinale au sens où suivait le plaisir d’une découverte.
L. I. : Le travail à quatre mains a sans doute facilité la chose, l’aller et retour entre vous deux.
M. G. : Tout à fait. Le mouvement d’aller et retour a animé le travail, et le travail a animé la recherche, la promenade dans un paysage qui devenait neuf à nouveau.
L. I. : Notre propre promenade, ici, ne peut être qu’inachevée. Vous vouliez dire quelque chose que nous n’aurions pas encore évoquée ?
Th. L. : Au moment où le livre est publié, il ne nous appartient plus, mais il fait rebond et nous renvoie quelque chose après coup. Je me rends compte que nous avons certes mis beaucoup de sérieux dans ce livre – tout a été plusieurs fois vérifié, contrôlé, sous l’empire des vieux réflexes académiques – mais aussi que je ne voulais pas y faire de l’Histoire de la psychanalyse. Je voulais des histoires, vives d’être aussi prises par quelque chose qui n’a rien à voir avec la vérité historique et matérielle, mais avec des vérités particulières. Freud avait une belle formule : il soulignait qu’après tout dans une vie, à cause de la logique désirante de la mémoire, des souvenirs écrans, tout était « un mélange de vrai et de faux ». Et c’est vrai que dans ces histoires-là, si tout est vrai du point de vue des données factuelles, on voit bien comment à ces données exactes se mélangent d’autres choses, qui fait qu’on les prend par ce qu’elles ont d’invraisemblables. On supporte toujours mal aujourd’hui l’idée que la vérité fantasmatique prime dans le monde de la névrose, et pas seulement : dans l’analyse même. Alors ce que nous avons écrit se veut exact, mais pour faire exister quelque chose de l’analyse, il faut accepter d’y introduire le plaisir de l’écriture, le plaisir de ces vies brèves. Si elles ont un relief, il vient de là et du contraste créé avec les données factuelles. Le livre s’adresse à cet égard à un regard neuf, parce que nous avons-nous-même cherché à poser un regard neuf sur le « déjà su ». Quant aux érudits et quant aux psychanalystes, si, par hasard, ils n’y apprenaient rien (c’est une éventualité très pessimiste : nous-mêmes nous avons appris toute sorte de choses que nous ne connaissions pas), ils découvriraient vite ce qu’ils ont à y prendre : le plaisir de l’événement. Freud écrit qu’à cause de l’effet de censure, l’essentiel se loge parfois dans un endroit où, comme pour la contrebande, il n’est pas attendu. Et l’essentiel, c’est peut-être cette transmission.
M. G. : Soyons radical : la transmission est heureuse – ou elle n’est pas. Elle procure un bonheur de lecture – ou elle n’existe pas. Elle se fait en contrebande. Le lecteur est un contrebandier !
Michel Gribinski, psychanalyste membre de l’APF, a crée la revue et le collection Penser/rêver et dirigé la collection Connaissance de l’Inconscient, Gallimard.
Thomas Lepoutre, psychologue clinicien, Maître de Conférence à Paris Diderot.
Personnages en quête de psychanalyse de Michel Gribinski et Thomas Lepoutre, collection Petite bibliothèque de psychanalyse, PUF, Paris (2020)