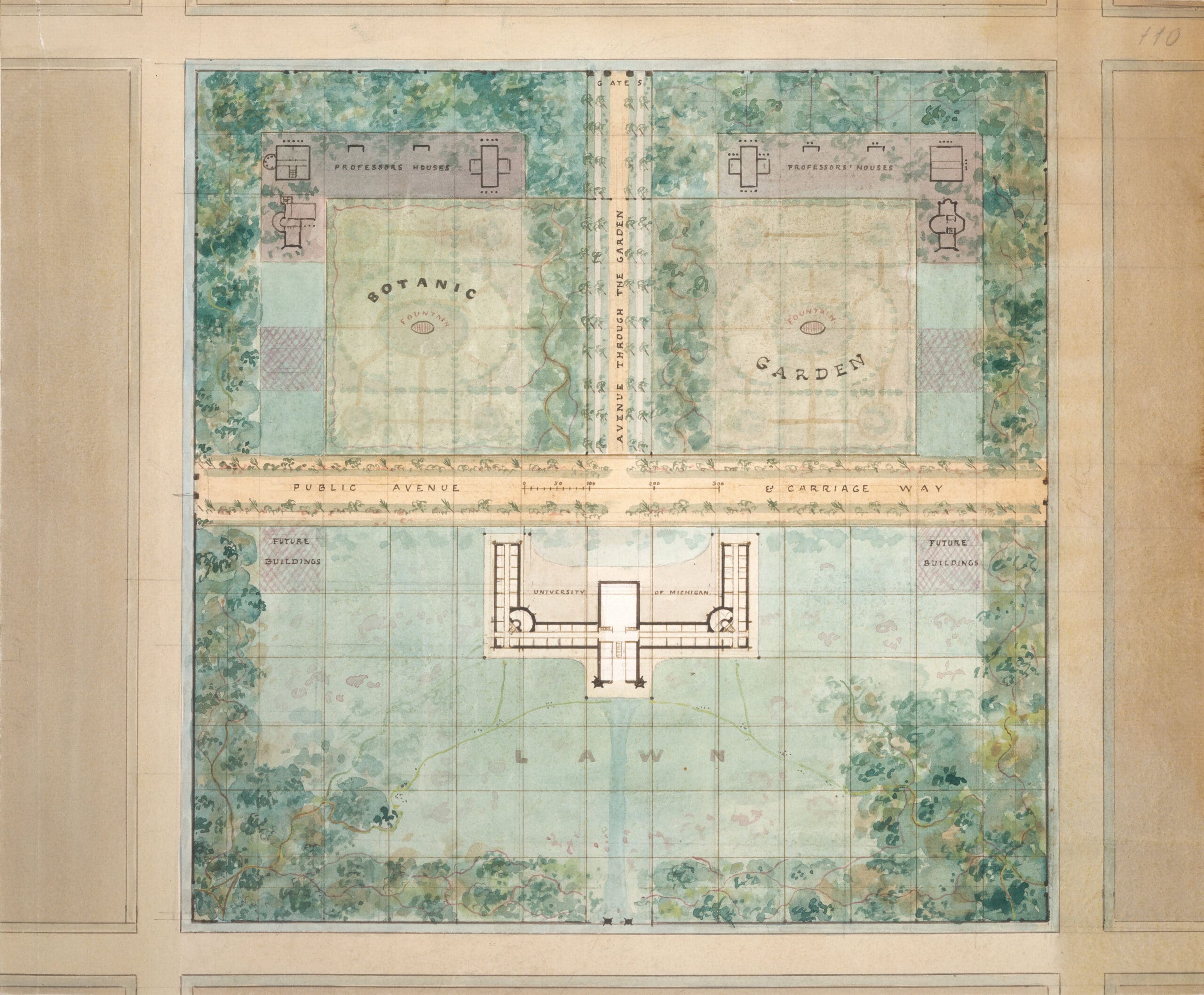Olivier Nicolle est psychanalyste, ancien maître de conférence à l’Université de Picardie Jules-Verne, a été membre du CEFFRAP.
Les Enfants de la psychanalyse : La transmission de la psychanalyse est problématique : elle repose sur un paradoxe qui met en tension d’une part les exigences liées à la possibilité de transmettre un savoir, et des connaissances psychanalytiques reproductibles et universelles ; et d’autre part la prise en compte de l’expérience analytique, l’expérience personnelle des transferts, l’histoire singulière et non reproductible d’une cure. Ce paradoxe inviterait-il d’emblée à repérer une dialectique possible ?
Olivier Nicolle : Oui, c’est un paradoxe qui en engendre d’autres à son tour. Vous semblez lier paradoxe et dialectique, nous envisageons ou invoquons bien souvent une dialectique pour tenter de surmonter un paradoxe… ou mieux, de le transformer. Ce qui a pour effet d’ouvrir une multiplicité de positions possibles, individuelles, contingentes, voire précaires, sinon temporaires. Voilà qui peut aussi rendre compte de notre diversité comme analystes, et de celle des institutions « psychanalytiques », mais sans doute aussi, en partie au moins, de ce qu’on a pu nommer une « babélisation » de la psychanalyse, et une sorte de « fureur scissipare » dirais-je, qui a pu s’observer dans certains pays, et notamment en France, et ce, précisément autour de ce que l’on résume sous les mots « transmission de la psychanalyse ». On pourrait envisager donc de penser (anthropologiquement et analytiquement) un couple dialectique transmission/dispersion dans la succession des générations – au-delà de la transmission comme problématique isolée.
Je parlais d’engendrer à son tour de nouveaux paradoxes… alors par exemple : comment concilier l’idée d’une norme collective, et un processus infini, parfois aussi indéfini, entre deux sujets – ou bien : comment maintenir l’idée d’un « enseignement », avec « école(s) » et « maîtres » comme disent encore certains, et l’horizon d’un dégagement par le sujet lui-même de ses propres désirs, et d’un trajet de vie, et de vie comme analyste, qu’il puisse s’approprier ? Force est aussi de remarquer que ces paradoxes ne se muent pas toujours, dans les conditions groupales des institutions d’analystes, en occasions élaboratives dialectiques, mais parfois en positions narcissiques inexpugnables sinon inexpiables, ayant des effets d’interdits de penser ou de dire, et de violence.
EDP : De quelle manière ce paradoxe, que l’on pourrait qualifier de paradigmatique, intervient-il dans votre façon d’envisager la transmission en psychanalyse, surtout lorsque celle-ci s’opère hors de la cure, plus précisément à l’université, et dans des groupes à visée de formation ?
ON : Évidemment, ma façon de questionner la transmission en psychanalyse se travaille à partir de ma propre expérience, ainsi que celle de « quelques autres ». Ma rencontre avec la psychanalyse a été ma rencontre avec mon premier analyste, et avec son écoute dans des moments de fin d’adolescence, alors que mes conflits internes vécus comme paradoxes, justement, me semblaient rendre ma vie impossible. Plus tard, j’ai travaillé ma formation pendant une bonne vingtaine d’années au Quatrième Groupe. Je l’ai quitté un an après la scission, entre autres parce que j’en étais arrivé à la conclusion que cette société – à l’époque en tous cas – échouait à élaborer cet événement. J’ai plus tard fréquenté un peu la SPRF. Brièvement d’ailleurs, parce que le travail psychique nécessité par mon départ du Quatrième Groupe me préservait maintenant d’une dépendance à une nouvelle société, qui dans sa jeunesse et son insécurité, m’a confronté à des effets de violence institutionnelle que je trouvais inacceptables. Il faut dire que, parallèlement, j’ai été vingt-cinq ans durant membre du CEFFRAP (Cercles d’Études Françaises pour la Formation et la Recherche : Approche Psychanalytique du groupe, du psychodrame, de l’institution), et que j’y ai notamment investi les processus de crise et de régression groupale dans les institutions… C’est d’ailleurs là, au CEFFRAP, que nous organisions très régulièrement des groupes de sensibilisation aux mouvements inconscients groupaux, puis des groupes de formation au psychodrame de groupe, et à l’écoute analytique des groupes. C’est ce à quoi vous faites allusion, je crois.
Ces activités groupales étaient conçues par des analystes, de différentes sociétés se réunissant au CEFFRAP, pour contribuer à la formation et à la transmission à travers l’expérience personnelle des participants, dont beaucoup avaient une expérience personnelle analytique.
Mais ce type de situation formative « par l’expérience personnelle » est aujourd’hui malheureusement quasiment impossible à instaurer à l’Université, et je n’y ai pu – des années durant cependant, et tant mieux – reproduire en gros cette transmission « par l’expérience personnelle » que dans un seul cas : la participation durant quelques heures à un psychodrame pour un groupe de futurs cliniciens presque diplômés, groupe dont le psychodramatiste était extérieur à l’université.
Sinon l’université reste (même dans le cas de l’élaboration en groupe des stages cliniques) en gros structurée verticalement par la relation ex cathedra, plutôt antagoniste avec une « transmission de la psychanalyse » qui soit en même temps une « libération dans la psychanalyse ». Au contraire, dans ce milieu comme dans bien d’autres, se transfèrent sans cesse et s’actualisent jusqu’à l’agir des relations infantiles et infantilisantes, pétries de craintes, de fausse révérence, de complaisance, de séduction, de protection paternaliste, voire pire.
Je crois aujourd’hui, après une trentaine d’années à l’université, que des « effets de transmission » peuvent certes découler incidemment des dispositifs universitaires (enseignements, recherche, colloques etc.). Pourtant la seule voie d’une transmission plus authentique, à l’université, de la pratique de la psychanalyse (et non des théorisations et du discours « psychanalytique appliqué »), cela reste le témoignage personnel qu’un analyste, dans son enseignement, peut donner de sa position analytique dans la proposition d’un dispositif clinique et/ou thérapeutique, le témoignage personnel de son écoute, de ses hésitations et de son questionnement toujours convoqués par la clinique, de sa prise en compte des transferts, de son ouverture au latent chez lui-même comme chez l’autre, de son tact dans l’intervention etc. Je crois que ce qui, dans un tel milieu (je parle ici de la psychologie clinique), peut aider à transmettre la psychanalyse, c’est ce qui témoigne pour des étudiants, travaillant la clinique, d’une humilité réaliste qui est le fruit des analyses personnelles et de l’expérience du vif (et parfois brûlant) de la pratique analytique. C’est aussi ce qui fait connaître la psychanalyse comme une liberté d’imaginer, de penser et de ressentir – et non comme la revendication d’un savoir précisément défini et définitif (ce qui, certains s’en rappellent, a sans doute été l’une des illusions idéalisantes très partagées des années 70–80, que nous payons chèrement aujourd’hui, dans le monde psychiatrique comme à l’Université, entre autres).
EDP : L’histoire de la psychanalyse et des sociétés « analytiques » est traversée par de multiples scissions : comment analysez-vous les enjeux et écueils dans la transmission qui ont conduit, et encore aujourd’hui, des analystes à se séparer, à se désaffilier de leur société d’origine ? En quoi transmission et séparation sont parfois imbriquées ?
C’est, me semble-t-il dans certaines aires culturelles, en France tout particulièrement, que l’histoire du mouvement psychanalytique est depuis l’après-guerre (en après-coup de la disparition de Freud ? puis de celle de Lacan ?) caractérisée par la scissiparité répétitive, jusqu’à un certain émiettement. Il y a des situations radicalement différentes ailleurs, chacun le sait : au Royaume-Uni, par exemple, la British Society a pu garder depuis toujours une structure assez souple pour rester unique et suffisamment diversifiée pour contenir les uns, les autres et ceux qui ne se veulent ni l’un ni l’autre : the Independent Group… En Allemagne, les deux sociétés historiques de l’IPA rendent compte des après-coups de la césure nazie catastrophique dans l’histoire de la psychanalyse allemande comme dans celle du pays, et voisinent avec des sociétés locales rattachées ou non, dans lesquelles se côtoient parfois descendances freudienne, adlérienne et jungienne, d’une façon qui nous paraîtrait quelquefois intenable…
Mais, outre cela, votre question demanderait à être elle-même diversifiée, je pense : « excommunication » (pour reprendre un mot lacanien qui en dit long sur son arrière-plan mythique), exclusion donc, scission (groupales), séparation, désaffiliation (individuelles) ne sont pas une et même chose, mais des destins très différents, et il faudrait les investiguer chacun pour ce qui le concerne, et évidemment dans une histoire propre. Ceci, quand bien même dans toutes ces occurrences, il s’avère après-coup y avoir eu un nouage complexe fait d’enjeux personnels, dont beaucoup inconscients, et de mouvements groupaux. Parmi ceux-ci, certains sont essentiellement des constructions imaginaires groupales (qu’on songe par exemple à la tâche commune du « sauvetage héroïque de la psychanalyse menacée » ou à la revendication partagée de transmettre « la psychanalyse pure et authentique ». D’autres, et parfois les mêmes, sont aussi des manipulations politiques pures et simples (ainsi : « soutenez-moi/nous en tout, parce que nous vous assurons la reconnaissance par l’IPA »).
Au-delà de ces évidences, je ne pourrais renvoyer qu’à l’ensemble des travaux, nombreux et très différents, qui ont été consacrés à ces questions depuis une cinquantaine d’années, et, entre autres mais pour sûr, aux travaux d’Anzieu, de Kaës également et de quelques autres du CEFFRAP, depuis 2014 hélas dispersé, travaux portant sur les constructions et les crises groupales institutionnelles en général.
Et en reprenant les termes de votre question, je voudrais faire remarquer que « transmission » et « séparation » ne sont pas seulement imbriquées, comme vous le dites, elles sont inséparablement liées. Ne serait-ce déjà que parce que la transmission, anthropologiquement, n’a lieu que face à l’inéluctable de la mort, de la séparation définitive, la mort de chacun, la mort d’une génération, et pour nous, la mort de la psychanalyse. La transmission est toujours aussi celle d’une génération qui anticipe sa disparition à une autre qui, a priori, lui survivra.
Je dis a priori, parce ma génération est née dans la décennie suivant la disparition brutale du sol de l’Europe, devenu un immense cimetière, de populations entières tuées au combat, bombardées, affamées, chassées, mais aussi assassinées industriellement dans une tentative quasi réussie d’effacement total, toutes générations confondues, de sorte que se sont évanouies dans leur fumée des pratiques, des savoirs, des cultures, des langues et des transmissions séculaires, voire millénaires.
Comme on l’a fait remarquer récemment très opportunément, la psychanalyse, si elle en a réchappé, n’en est pas restée indemne[1]. Le déroulé des événements nous a montré à quel point cette annihilation, sauf pour quelques très rares individus, avait été imprévisible, incompréhensible, impensable parce qu’elle avait défié tous les a priori qui nous aident à penser notre vie. Aujourd’hui, outre les défis que nous présentent d’une part la machine « virtuelle » envahissante, et maintenant l’IA, et à l’heure où l’on recommence d’autre part en Occident à brûler des livres non-conformes idéologiquement, à bâillonner des intellectuels, et où un nouvel iconoclasme progresse, qui peut dire ce que l’on parviendra à transmettre et à penser, voire même, ce que l’on pourra encore lire de l’œuvre freudienne dans une génération ou deux ? Qui peut dire si les usages sociaux, et les discours politiques à venir permettront encore à la « méthode psychanalytique » de se déployer dans une privacy entre deux sujets ? Comme tout un chacun, je n’en sais rien… Je sais certes qu’à chaque génération, à chaque transmission, la perte, l’oubli mais aussi la nouveauté, l’invention, la créativité sont déjà à l’œuvre, cependant nous savons aussi que la disparition brutale, totale, et surtout inimaginable, est aussi possible.
Alors qu’est-ce donc du coup que « l’Institution », sinon (aussi) ce qu’un groupe de sujets édifient ou à quoi ils s’allient, parce qu’ils tiennent que, face à cette grande mort que chacun porte en soi, comme l’énonce Rilke, cet édifice tiendra debout (comme son nom l’indique : stare/instituere), même après que la mort fasse de chacun d’entre eux des gisants ? On se souvient évidemment des circonstances de la naissance du Comité secret puis de l’Internationale autour de Freud vieillissant et anticipant sa disparition, et aussi celle, possible déjà, de la psychanalyse. Chaque fantasme institutionnel partagé sécrète, distribue entre ses membres et entretient au moins un peu une illusion d’immortalité à travers la transmission.
Mais ce n’est pas tout : la transmission ne va jamais sans transfert ni sans traduction, et la traduction ne va jamais sans interprétation, c’est-à-dire sans appropriation de l’objet transmis, appropriation qui elle-même ne va jamais sans transformation, ni sans perte accompagnant celle-là. Toute transmission se déroule donc certes à l’ombre de la mort, mais aussi de la transformation, de la nouveauté, donc, mais au risque de la trahison[2]. C’est évidemment l’enjeu d’un travail de la perte, et de séparation, que de pouvoir élaborer ces dimensions-là dans une « fin de formation » institutionnelle[3], et ce autant pour les transmetteurs que pour le ou la récipiendaire.
J’insiste après d’autres sur l’activité traductrice au sens fondamental dans ma façon d’essayer de penser la pratique analytique, et surtout sur l’activité « trans- » elle-même, parce qu’accompagnant l’élément dynamique de tant des concepts et notions que nous utilisons, ce syntagme et ses apparentés désignent (position 1) le passage d’un état ou d’une inscription (2) à un/e autre(3), et font signe de la ternarité au sein de laquelle un sens apparaît. À l’Inconscient, nous n’avons accès que par des traductions, transformations, et traductions de traductions et de transformations.
Il est d’ailleurs à remarquer qu’à part dans les pays germaniques, l’œuvre de Freud, de Ferenczi, d’Abraham et de quasiment toute la génération des fondateurs ne se transmet en psychanalyse qu’à travers des traductions, dans chaque langue diversement inspirées, avec les conséquences de gain et de perte que cela occasionne. L’exemple français est à cet égard très… parlant.
Pour revenir et en finir (ici…) sur ce point de votre question, en reprenant avec un grain de sel la pluralité de situations que vous évoquiez (scission, séparation, désaffiliation…) quant à l’institution analytique, je dirais que c’est quand même de tout autres destins psychiques de la perte intrinsèquement liée à la transmission que de pouvoir dire : « adieu et merci beaucoup » à ceux qui vous ont transmis et autorisé – ou bien alors de hurler en meute « sus aux traitres ! », ou bien encore : « feu sur le quartier général ! »
EDP : D’ailleurs comment l’institution psychanalytique intègre-t-elle la nouveauté, et promeut-elle une pensée en perpétuel mouvement, tout en poursuivant la transmission des fondamentaux, sans lesquels elle ne se reconnaîtrait pas ?
ON : Pour chacun de nous la nouveauté est susceptible d’investissements et de fantasmes très différents, jusqu’aux opposés. La nouveauté c’est d’une part la séparation elle-même, l’épiphanie de la séparation dirait-on : séparation d’avec le vieux monde, le monde des vieux et le discours des vieux — et les affects violents qui sont en cause ici, soutenus par les discours sociaux d’une économie de consommation effrénée à laquelle nous participons, peuvent aussi se résoudre dans une position maniaque assez répandue : tout nouvel objet est alors un objet-intéressant, mais très vite ou très souvent aussi un tout-bon-objet. Nous évoquions précédemment l’Université : la dictature du publish or perish, avec ses indices etc. y encourage largement ce mouvement, qui n’est sûrement pas absent dans ce qu’on a appelé la « Psychanalyse à l’Université ».
Mais la nouveauté, c’est aussi en chacun comme dans l’Institution, l’angoisse devant l’inconnu. Dans l’Institution, l’objet nouveau est de fait souvent vécu comme un objet suspect, sinon dangereux. Il n’en va pas autrement dans les institutions « psychanalytiques ». Le conformisme, une des voies de « l’identification mutuelle » et de « l’idéalisation du chef » (au sens de Freud 1925) y est remarquablement à l’œuvre, et il faut souvent des transferts idéalisants très intenses sur un « maître à penser » la clinique, pour que des propositions nouvelles trouvent leurs voies au sein des instruments élaboratifs de la clinique.
À mon sens, il ne faudrait d’ailleurs pas seulement s’interroger sur une « psychosociologie » de la nouveauté, mais plutôt, analytiquement, sur la nouveauté et son envers, c’est-à-dire sur le couple nouveauté/obsolescence : quels sont donc les motifs inconscients, individuels et groupaux, qui, dans le milieu analytique en l’occurrence soutiennent durant une génération ou plus un concept ou une conception, devenant peu à peu un instrument élaboratif légitimement partageable dans une partie importante du mouvement analytique ? Quels sont les processus d’obsolescence amenant tel autre concept ou telle conception, autrefois (années 60, 70, 80) ressentis si évidemment opératoires, à apparaître désormais à la plupart d’entre nous comme une formulation dévitalisée, voire un mantra, dont l’intérêt et le sentiment de pertinence qui leur était attaché semble s’être maintenant dérobés, défaits. Bien sûr, les transferts… Concepts et conceptions théorico-cliniques sont inconsciemment des êtres imaginaires, objets de nos amours. Et désamours. Mais encore ?
Par ailleurs, par-delà les méfaits du conformisme et de l’angoisse quant à l’objet nouveau (qui nous fait risquer aussi la disparition de l’objet « connu »), faut-il considérer comme vous semblez le faire, que la « nouveauté » en soi, le « perpétuel mouvement » soit une positivité ?… Pour moi c’est tout sauf évident.
EDP : Vous avez soutenu l’idée originale que la crise en institution permet finalement la mise en œuvre des impensés de la genèse groupale de l’institution. Pourriez-vous nous expliquer en quoi la crise peut être ainsi génératrice de transmissions jusqu’alors restées voilées ? L’état de crise permet-il selon vous la co-construction d’un mythe originaire qui ait valeur de refondation ?
ON : Je ne dirais pas cela tout-à-fait ainsi. Le fait que la mise en crise du groupe aille de pair avec (entre autres) le retour sur la scène groupale de mouvements restés clivés, déniés, projetés depuis l’origine du groupement ou la fondation, et cela assurant les alliances, pactes, idéalisations etc. vécues comme nécessaires à la durée du groupe dans l’être, ceci avait déjà été repéré sous d’autres formes dans des recherches menées depuis les années 70 autour puis à la suite d’Anzieu, par Kaës et d’autres au CEFFRAP. Je n’ai peut-être que contribué à vérifier exemplairement ces mouvements dans de nombreuses situations groupales institutionnelles, mais j’ai pu préciser de façon plus systématique le recours du groupe, après sa fondation, à un régime de discours pour lequel j’ai repris de l’anthropologie le terme (mais pas le contenu) de « mythopoïèse », de « fabrication mythique ». Mythique, parce que comme le rêve, le mythe, en tant que régime de discours groupal, désigne une vérité de l’origine par ce fait même qu’il la transfigure en la cachant, en la travestissant.
Je ne crois pas que la crise en elle-même soit génératrice de transmissions, cliniquement elle en serait plutôt un moment d’effacement, de rejet violent etc. car la crise est un défilé de régressions individuelles en groupe, et collectives partagées.
Analogiquement au rêve : le rêve manifeste ne nous apprend pas grand-chose en soi, il n’est pas en lui-même la Via Regia… c’est l’apparition de sens (Deutung) dans le dépliage-déploiement du mycélium associatif, dans la croisée des transferts de la séance qui l’ouvrira, cette Voie. Dans la crise groupale, ce sera son élaboration progressive, plus ou moins associative par les membres du groupe, avec un tiers analyste et en après-coup parfois fort lointain, qui constitue souvent une élucidation au moins partielle, et de fait, un enrichissement de la pensée des membres du groupe sur leur propre histoire partagée. C’est cette élucidation qui fait, si vous voulez le dire ainsi, transmission : parce qu’il s’agit d’une réappropriation, mais sous un tout nouveau jour, d’éléments identificatoires qui ne s’étaient transmis aux générations successives venues s’agréger au groupe, que dans une version mythifiée et en général grandiose de la fondation, de la geste des fondateurs ou de ceux tenus pour tels, et surtout des excès de cette geste, alors que leurs effets de violence, d’injustice, de culpabilité, de honte etc., « oubliés » depuis, réapparaissent dans la clinique de la crise groupale elle-même.
EDP : Les processus de transformation à l’adolescence sont eux aussi sous-tendus par la crise qui fragilise les identifications du sujet et les transmissions inconscientes sur lesquelles il s’était édifié. Pourrions-nous rapprocher ce que vous dites à l’endroit de la crise institutionnelle, de la crise adolescente qui vous a également occupé comme analyste ?
ON : C’est effectivement dans le mouvement de l’adolescence que la « passivité infantile » se lève (en général…) en partie au moins, et que les remaniements dont vous parlez s’opèrent sous des modalités multiformes.
« Peut-on rapprocher », dites-vous ? Si nous nous référons seulement ou essentiellement à une écoute associative, alors règne le principe de généralisation[4], et certes alors toutes les crises psychiques ont des aspects communs, à commencer par les régressions de tous types, le retour puis l’envahissement de représentations non seulement infantiles, mais archaïques : des objets partiels, clivés et binaires, violemment projetés, intraitables, qui déchirent la pensée des sujets et des groupes de sujets, en attisant les vécus persécutoires, victimaires, sadomasochistes, par exemple. Ils rendent alors très difficile ou impossible la formation de compromis, engagent au passage à l’acte comme résolution temporaire de l’angoisse et des affects etc.
Mais en ce qui me concerne, ces cliniques, individuelle adolescente ou groupale, une fois repérées, décrites, je préfère vraiment que chacune soit bien différenciée. D’abord parce que chaque dispositif « appelle », « borde » comme on dit, et va héberger une clinique différente : ainsi l’écoute analytique en groupe avec un analyste n’est pas le même dispositif qu’avec un couple d’analystes. L’écoute des associations dans un « groupe de parole » ne mobilise pas les mêmes ressorts que le psychodrame de groupe, lequel ne mobilise pas les mêmes mouvements transférentiels que le psychodrame individuel, lequel n’est évidemment pas la même chose que le face-à-face. Ensuite parce que chaque entreprise travaillée par une compréhension psychanalytique (et non pas seulement psychologique ou psychopathologique) des processus, engage immédiatement la question des transferts, et de « l’adresse » dès le premier moment clinique (et ce, quand bien même nous savons d’expérience qu’une partie – et parfois imposante – des enjeux transférentiels d’une entreprise analytique ne sera saisie par l’analyste que bien après-coup, parfois des années plus tard, et qu’une part ne le sera jamais).
Enfin parce que si dans l’élaboration d’une clinique (dont le matériel, du fait des regressions, est très structuré par les processus primaires), on se centre surtout ou trop sur ce qui est analogue, sur les éléments communs, sur la généralisation des concepts et des conceptions, on risque bien de rester dans les généralités, la pensée molle qui n’en est pas une, ou même la non-pensée qui flotte sur de fausses évidences, sur des « ressemblances ». Le risque alors c’est d’être au « Café du Commerce » analytique… que chacun de nous fréquente de temps en temps !
Ainsi, si je reprends l’exemple des intenses régressions, dans la crise groupale et institutionnelle elles s’originent bien souvent dans une fantasmatique de la mort inconsciemment partagée et terrifiante : mort des fondateurs, mort de leur génération de collègue, mort de l’institution, mort de l’idéal groupal, mort des identifications héroïques partagées etc. Cela les différencie, pour moi en tout cas très évidemment, de la crise adolescente, de sa problématique du pubertaire, avec l’angoisse de l’inceste face à l’approche de l’adulte aux différents sens de ce terme, avec le deuil du corps d’enfance et de sa sensorialité, sensualité etc. Certes, la mort est présente aussi dans la crise adolescente, mais à de tous autres titres : on est là, je crois, dans deux mondes psychiques bien différents, même si, lorsque nous écoutons un groupe en crise ou un sujet adolescent, certaines représentations, certains mouvements des transferts, certaines formations défensives peuvent « ressembler » ou nous « faire penser » à d’autres cliniques dans d’autres dispositifs.
Je ne sais pas si cela peut servir de conclusion, forcément partielle et temporaire face à l’ampleur des questions que vous posez. Mais en faisant le tour de ce que nous avons évoqué, il me semble que se justifie la constatation que, comme dans la succession des générations d’une famille, on peut croire savoir ce que l’on veut transmettre, on ne sait jamais ce qui sera transmis de fait, ni sous quelle forme cela sera reçu, ni encore à quel moment de la vie du récipiendaire de cette transmission lui deviendrait éventuellement pertinente. Et comment nous analystes oublierions-nous à quel point c’est souvent cela-même que l’on se refusait absolument à transmettre, qui l’a justement été… Alors comme dans tant d’autres questions analytiques, gardons sur ces sujets une humilité de principe… ce qui n’empêche pas de réfléchir.
[1] KAHN L. (2018) Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, PUF, Paris.
[2] VALABREGA J.-P. (1987) « Sur le concept de traduction et sa nébuleuse », Topique n° 39, EPI, Paris.
[3] NICOLLE O. (2011) « Destins de la perte, forme(s) et formation » in KAËS R. et DESVIGNES C. Le travail psychique de la formation, entre aliénation et transformation, col. « Inconsient et culture », Dunod, Paris.
[4] MATTE-BLANCO I. (1988) Thinking, Feeling and Being, New Library of Psychoanalysis, Routledge, Londres