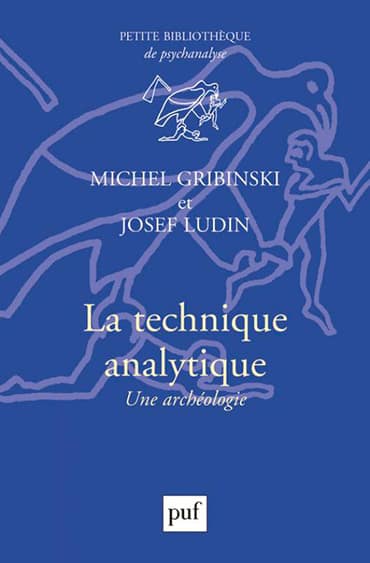Archéologie : le mot est emphatique en l’occurrence, et il faut l’entendre ici comme l’activité de deux néophytes, archéologues en herbe qui, « sur le terrain » (au moins est-ce authentiquement le leur) rencontrent des objets de toutes sortes, des mélanges de pièces antiques et de fragments d’un « passé » immédiat. Mélanges, si l’on veut être simple, de « choses » – souvent improbables et parfois compliquées à identifier : avec quoi, quelle technique, les identifie-t-on ? Question majeure, pour laquelle on se divise, on se perd soi-même et autour de laquelle le monde analytique se désagrège peu à peu. À d’autres moments, on se demande ce qu’elles font là, ces « choses » qui semblent se rencontrer comme la machine à coudre et le parapluie de Lautréamont, sur la table d’opération du psychanalyste.
Le thème, abordé frontalement par les deux auteurs, devrait être scientifique puisque, comme tout scientifique, grâce à sa méthode, l’analyste isole son objet propre, en élabore la théorie, et ne s’étonne pas de ramener au jour, grâce à elle (la théorie) de nouveaux objets. Certains ne lui appartiennent pas, mais il s’en empare, disons hardiment sinon toujours avec bonheur : ils sont religieux, politiques, historiques, médicaux évidemment mais aussi littéraires et psychologiques, et esthétiques – liste non close.
Un avantage du mot, en l’occurrence quelque peu emphatique d’« archéologie », est que, sur le terrain, il admet a priori tout ce qui vient, la religion comme la psychologie, l’anodin comme le trop significatif, quand on gratte le sol à la surface ou en profondeur, quitte, dans un second temps à se défaire de ce qui n’informe pas. Qui n’informe pas sur quoi ? Sur rien moins que la civilisation. Car il s’agit bien de civilisation et d’abord de la civilisation de soi. Une technique existe, mise au jour par Freud, qui permet d’accéder à la vérité individuelle – et quoi de plus uniment civilisé, et à la fois de plus conflictuellement culturel, que la vérité ?
On le saura très vite : pour étudier la technique analytique, il faut être deux – au moins – à se partager les conflits pour pouvoir avancer dans les siens propres. En l’occurrence, un connaisseur de l’histoire du champ analytique et des idées qui le font vivre ou l’ont déserté – disons un archéologue de la pensée freudienne et post-freudienne ; et, presque à l’opposé, un curieux qui se demande ce qui se passe depuis qu’il a fait l’expérience qu’il se passait quelque chose dans certaines conditions techniques de la pratique de l’analyse. Il a affaire au présent, ce qui est paradoxal pour un analyste. Mais ne parle-t-on pas toujours au présent, même quand on parle du passé voire de la préhistoire ?
Le point de vue des deux auteurs est si différent (ils les échangent ici ou là), leur style est si différent qu’avant de le savoir, on éprouve dans l’expérience même de la lecture des pages qui viennent que la technique de la psychanalyse est diverse. C’est l’une des questions que posent les chapitres qui suivent : la confrontation entre la diversité et l’unicité de la vérité recherchée par l’analyse fait que la technique analytique est à la fois une et indivisible et qu’elle offre une certaine variété selon les analystes, les patients, les pathologies – ou plutôt selon les difficultés, leurs interprétations, leurs conséquences méthodologiques. Pour prendre un exemple à distance, sans l’expliciter ici : le « défaut fondamental » auquel Bálint, dans le livre éponyme1 , dit accéder en touchant ses patients, est-il curable, ou bien créé par sa technique ? Cette diversité pose une question majeure : pourquoi s’intéresser à la technique si l’on peut supposer qu’il y en a autant que de techniciens, et de sujets en analyse ? Pourquoi ne pas laisser chacun s’aventurer dans les choix qui lui conviennent ? Avec d’autres, ces interrogations font l’objet de ce livre.
On croit pouvoir faire des choix techniques quand on conduit une cure : sait-on que le psychanalyste n’a pas inventé une technique ou une autre mais que, à l’inverse, c’est la technique qui l’a inventé, lui, et continue de le faire séance après séance ? Sans doute fallait-il, pour en parler, un historien-géographe de l’idée freudienne et postfreudienne – épris de l’histoire du passé – associé à un épris de l’histoire du présent et du geste présent, pour qui c’est toujours au service du présent que l’on pense – et que l’on se trompe, ou s’égare. Mais s’égare-t-on jamais ? Perdre son chemin, avancer sans plan ni carte : est-ce une réalité ou un idéal de la cure ? La cure : une perspective à rejoindre – d’où la possibilité de trouver de l’inconnu ? Ou un « guide des égarés », pour citer Maïmonide, à l’usage des personnes dont l’état (d’âme) est critique, des personnes familières de la Krisis, et pour qui l’esprit est un dictateur qui les prive de choisir ? On sentira vite que ces questions unissent et séparent les auteurs, pourtant certains d’avoir exploré la même matière, fait un travail commun. Certains que leurs divergences éventuelles disent quelque chose d’interne et de propre au principe technique en psychanalyse.
Une technique, transmissible, reproductible, permet de penser, de chercher, de trouver. Quoi ? Du nouveau. C’est-à-dire quelque chose d’indissociable de ce qui vise la vérité. On est reconnaissant à Freud d’avoir inventé cette technique-là, et de n’avoir jamais omis que les inventions et les égarements méthodologiques ont, comme la rigueur technique elle-même, une source sexuelle.
NOTES :
- Michael Bálint, Le Défaut fondamental (1968), traduction par Judith Dupont, Payot, 1971.