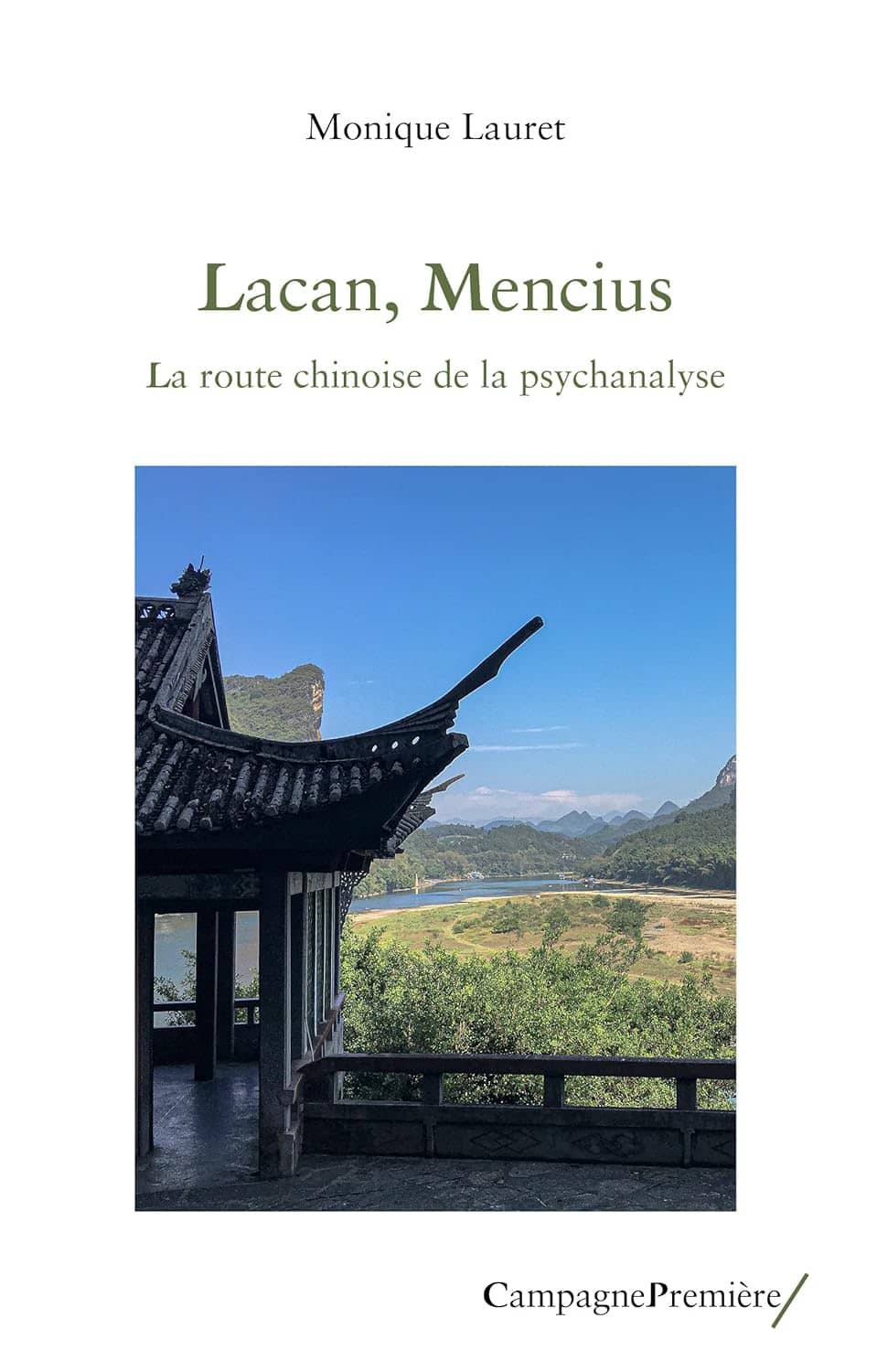(…) le discours à cette époque, à l’époque de Mencius, était déjà parfaitement articulé et constitué. Ça n’est pas au moyen des références à une pensée primitive qu’on peut le comprendre. À la vérité je ne sais pas ce que c’est qu’une pensée primitive. Une chose beaucoup plus concrète que nous avons à notre portée, c’est ce qu’on appelle « le sous-développement ». Mais ça, le sous-développement ça n’est pas archaïque, chacun sait que c’est produit par l’extension du règne capitaliste. Je dirai même plus : ce dont on s’aperçoit, et dont on s’apercevra de plus en plus, c’est que le sous-développement c’est très précisément la condition du progrès capitaliste.
J. Lacan, Séminaire XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant.
Monique Lauret est une psychanalyste habitée par la question de l’éthique, qu’elle associe étroitement à la démarche psychanalytique.
Selon elle, la valeur portée à la transformation des recherches de satisfaction instinctuelle immédiate en un autre mouvement : la quête de vérité, de bonté, de respect d’autrui, pour se tourner vers les diverses formes de bien, est une potentialité en chacun de nous. La dimension éthique semble implicite pour elle dans le trajet de subjectivation de la cure analytique, « retour à soi pour penser sa vie » ; même si « toute lumière sur son désir ne peut être faite ».
Psychanalyste initiée à la pensée et à la culture chinoise, enseignant la psychanalyse en Chine depuis de nombreuses années, Monique Lauret retrace ici les points d’articulation entre la réflexion éthique de Lacan et la philosophie chinoise qu’il a rencontrée et nous a invités à découvrir. Elle présente l’éthique d’une manière qui met en valeur la pensée des grands maîtres chinois, et esquisse des lignes de rencontre, et surtout de divergence, avec la pensée occidentale, même si, on le lit entre les lignes, c’est la domination de la rationalité occidentale qui, au moment où elle écrit son livre, en pleine pandémie du Covid, a conduit à la catastrophe mondiale que nous avons connue.
La pensée philosophique occidentale s’inscrit dans une culture où domine l’idée d’affirmation de soi et de domination du monde matériel ; tandis que la culture chinoise (avant qu’elle ne soit obligée d’intégrer peu à peu, à partir du XIXe siècle, la pensée dominante occidentale) se caractérise par une volonté d’intériorité et d’harmonie avec le monde. La transmission de l’éthique repose sur une enveloppe narrative tissée, au fil des générations, des multiples discours qui ont forgé l’identité singulière d’une civilisation, inscrite dans un ordre symbolique qui lui est propre. Monique Lauret évoque les corpus de pensée philosophique et religieuse, des récits, rituels et interdits qui ont formé, en Orient, des trames étroitement nouées, guides pour le sujet en quête d’atteindre l’humanité qui lui est immanente.
Or de nos jours, en Chine comme en Occident, le travail psychanalytique apparaît sous la plume de Monique Lauret comme une des voies nouvelles pour tenter de retrouver celle qui s’est perdue dans les dérives du capitalisme, qu’il soit d’État, comme en Chine, ou libéral, comme en Occident. Il s’agit de la renonciation, dans le parcours individuel personnel, au « plus de jouir » lacanien, en échange d’une meilleure connaissance de son inconscient, qui implique nécessairement des deuils et l’intégration d’une « tempérance ».
Monique Lauret développe les raisons pour lesquelles la Chine a accueilli, dans les quarante dernières années, la pensée de la psychanalyse, et pu lui faire une place à la fois dans le champ des études philosophiques et dans celui du soin : si la destructuration du lien social et de la pensée du vivant a suscité chez de nombreux chinois une souffrance psychique qui nécessite d’être soulagée, de nombreux éléments de leur culture, de transmission aussi ancienne que celle de l’Occident, et encore latents aujourd’hui, préparaient l’intérêt pour la pensée de Freud. Il en est ainsi du rêve, considéré depuis l’antiquité chinoise comme relevant de trois natures : de présage, de pensée, ou pathologique – l’inconscient étant considéré et reconnu depuis fort longtemps. À ce propos, Monique Lauret procédera, comme elle le fait tout au long du livre, par touches légères qui proposent des rapprochements sans les imposer dans une démonstration ; elle évoque les commentaires de Lacan sur le rêve du papillon de Zhuangsi (IVe siècle avant notre ère) : Lacan établit la condition d’une position subjective dans le fait de se voir (qui est aboli dans le rêve) et développe la place du regard et du désir de l’autre dans le processus qui fait de chacun un sujet. « C’est le réseau symbolique dans lequel le sujet est pris qui détermine son identité » nous dit-elle. Et c’est dans le récit fait à l’autre que le sujet comprend sa dépendance au regard de l’autre en lui et discrimine le fantasme — rêve (imaginaire) de satisfaire à ce regard « je suis un papillon » du désir qu’il contient (j’ai rêvé que j’étais un papillon).
Néanmoins, si le travail psychanalytique est d’accéder à la connaissance de l’inconscient qui parle en nous pour nous dire, au détour de multiples transformations, notre propre désir de sujet (quand bien même serait-il le désir du désir de l’Autre), Monique Lauret développe avec force pourquoi, selon Lacan, l’exploration de l’inconscient n’était pas « ontique », en quête d’une essentialité du sujet, mais avant tout « éthique » ; elle relève dans le Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse, l’impératif catégorique : « La fonction du désir doit rester dans un rapport fondamental avec la mort ».
Et toute la suite de l’ouvrage portera les échos de la traduction qu’elle en fait : « Réaliser son désir se fait toujours dans une perspective de condition absolue et de Jugement dernier, celui du dernier questionnement au moment de notre mort ». Cette vérité, Lacan avait pressenti qu’elle serait déniée, en butte aux logiques mercantiles et à l’hubris scientifique et technologique occidentale, pour conduire, cite-t-elle « au pied du mur de la haine » et à « l’effondrement de la sagesse ».
C’est alors qu’elle nous emmène sur les voies, empruntées par Lacan, du développement de la sagesse chinoise, cette longue suite de courants, qui se rejoignent ou s’opposent dans des dialogues mutuels depuis l’Antiquité : le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme… Pas à pas, elle évoque la spécificité d’une culture morale chinoise qui avance en enracinant la vie et l’humain dans l’univers, qui ne raisonne pas en terme d’unité ou de dualisme mais « vise à l’harmonie en composant de manière dialectique avec les contraires », et « n’est pas de l’ordre de l’être mais d’un processus en développement ». Le mouvement, la mutation, y sont l’essence même de la vie
L’intuition qui anime la pensée, le rén, et donne à la sensation et à l’affectivité autant de valeur qu’à l’intellect, est par exemple une valeur prévalente sur l’entendement (valeur dominante du rationalisme occidental) ; cela lui donne une importance maîtresse, sur le plan éthique, en tant que « sentiment inné d’humanité », intimement lié à la spontanéité et l’exubérance du développement de l’univers, dans la pensée confucéenne. C’est dans cet esprit du rén qu’il est dit que des sages ont profondément influencé certains régnants dans la construction des empires et les mutations qu’ils souhaitaient pour leurs sociétés.
Lacan s’est intéressé à de nombreux auteurs chinois, d’abord en apprenant le chinois auprès du sinologue Paul Demiéville, puis en étudiant les classiques avec François Cheng durant quatre années ; il invitait les auditeurs de son séminaire à aller à la rencontre de la pensée chinoise.
Parmi les sages, Monique Lauret distingue Mencius comme source d’inspiration fondamentale pour la construction de certaines notions théoriques de Lacan, et elle développe quelques aspects des relations dialectiques que ce dernier a entretenu avec la pensée du vieux maître confucéen dont l’enseignement a été transcrit par ses disciples, entre le Ve et le IIIe siècle avant notre ère.
Pour elle, Lacan s’est déterminé, dans son dialogue imaginaire avec Mencius, sur trois questions : la nature humaine, le désir et la jouissance, et enfin la sagesse.
Ces trois questions apparaissent comme les choix personnels d’une analyste qui se penche sur l’humanité défigurée, en Orient (et notamment en Chine) comme en Occident, par le déferlement traumatique des violences de masse qui ont traversé le XXème siècle et qui se poursuivent encore aujourd’hui ; néanmoins elle porte tout son espoir dans l’aptitude de l’humain qui veut se reconstruire, à trouver la voix‑e d’une parole qui soigne. En outre, elle semble défendre le courant de la pensée chinoise qui présente l’homme en mouvement de recherche du bien — même si, en psychanalyste formée à la pensée de Mélanie Klein, elle connaît la force des pulsions de destruction qui peuvent s’y opposer.
Sur cette nature humaine en chacun de nous, Monique Lauret avance que Lacan, bien que critique, rejoint le point de vue de Mencius, que cette humanité est une « virtualité possible », et que le Mal serait la « non mise en acte de cette potentialité ». Citant le sursaut humain de certains citoyens chinois auparavant poussés à la trahison de leurs proches lors du processus de déshumanisation de la Révolution culturelle, elle commente : « Une subjectivité peut-être blessée jusqu’à en devenir informe, se réduire, se ratatiner en un point ultime, mais une lueur d’humanité peut persister (…) Une renaissance est toujours possible, l’homme a toujours le pouvoir de dire non ».
Elle saisit ainsi la parole de Lacan à travers sa propre sensibilité et sa propre culture psychanalytique, qui intègrent les développements de Mélanie Klein sur la pulsion de mort et le sadisme, et tisse des liens entre la pensée chinoise et ce qu’elle trouve chez Lacan d’un intérêt pour les potentialités de transformation qui habitent le sujet, en devenir permanent : il existe un trajet toujours renouvelé du lien à autrui où les oscillations entre férocité schizo-paranoïde et position dépressive peuvent faire de l’autre un objet partiel soumis aux attaques féroces du sadisme (c’est là que se situe le mal), mais aussi conduire à reconnaître en lui « l’Autre dans sa totalité », à travers l’intégration et les mouvements réparateurs de la position dépressive que Mélanie Klein a décrits.
Ses réflexions sur le désir et la jouissance nous présentent un Lacan qui conçoit le processus psychanalytique et l’accès au désir comme une « voie rare », qui conduit à la tempérance, le sujet se sachant « désirant, manquant, et inconscient ». Un trajet qui évoque la spiritualité confucéenne, où le Ciel est à entendre non comme une transcendance, mais comme ce qui se lie à « l’ordre naturel des choses ».
Enfin, partageant l’inquiétude exprimée par Lacan d’une disparition de la sagesse, liée à la démesure scientifique de nos sociétés, Monique Lauret consacre de longues pages à cette dernière, et invite implicitement le lecteur à penser à notre discipline comme outil pour le maintien d’une sagesse dont nos sociétés ont cruellement besoin actuellement.
Dans la langue chinoise, le psychanalyste est médecin de « cœur-esprit ». Monique Lauret nous restitue, de son point de vue d’analyste engagée dans la Cité, l’aspect « cordial » d’une pensée lacanienne qui, pour certains d’entre nous, semblait s’être éloignée dans les éthers intellectuels d’un langage devenu trop abstrait.
Elle termine en faisant non appel à la psychanalyse mais à la philosophie, et aux développements de François Jullien sur la nécessité de penser l’inouï au niveau collectif, afin de sortir nos civilisations de la « désaffection de l’humain » qui les gagne. Néanmoins elle nous fait entrevoir que, depuis notre bureau d’analyste, notre travail d’intrication pulsionnelle et notre position de « refusement » auprès des patients, qui ébranle les mensonges schizo-paranoïdes ou le déni pour les confronter à la douloureuse intégration d’un objet total et à jamais énigmatique, sont des ouvertures vers le Vide, si précieux dans la philosophie chinoise.
Le Vide de la tradition chinoise est une notion reprise par Lacan ; Monique Lauret rappelle que selon lui, « il est central chez le sujet et concerne cette région de la Chose freudienne ». Pour Lacan « la béance du vide (…) constitue le premier pas de tout mouvement dialectique, comme dans la pensée chinoise ». Ces ouvertures vers le vide peuvent accueillir l’inouï (notion développée par François Jullien, que Monique Lauret invite ici dans sa réflexion), comme il laisse la place aux souffles qui traversent les êtres mais participent aussi de l’harmonie des êtres dans le Cosmos. Le souffle, méconnu de la pensée occidentale, et qui pourtant, nous rappelle Monique Lauret, anime, dès notre premier cri, l’entrée dans le monde et l’appel à l’Autre… Traduisant Mencius qui dit « Appuyez-vous sur la volonté, mais n’opprimez pas les souffles », elle propose : « un psychanalyste pourrait dire : Appuyez-vous sur votre désir, mais n’opprimez pas les souffles ». On pourrait aussi bien dire : « Pensez à vous, mais n’oubliez jamais d’embrasser dans votre quête de la vérité l’inconnu vivant et fragile du reste du monde, aussi loin de vous soit-il ». Est-elle, est-on dans l’hubris, lorsqu’on ambitionne de faire de la psychanalyse autre chose que « la recherche du confort bourgeois » dénoncée par Lacan, et que l’on espère voir se développer le sens de sa responsabilité humaine sur les terrains psychiques conquis par le patient grâce au travail d’intrication pulsionnelle et à la meilleure connaissance de ses désirs ?
Lacan, Mencius, la route chinoise de la psychanalyse. Monique Lauret, Campagne Première, 2022.