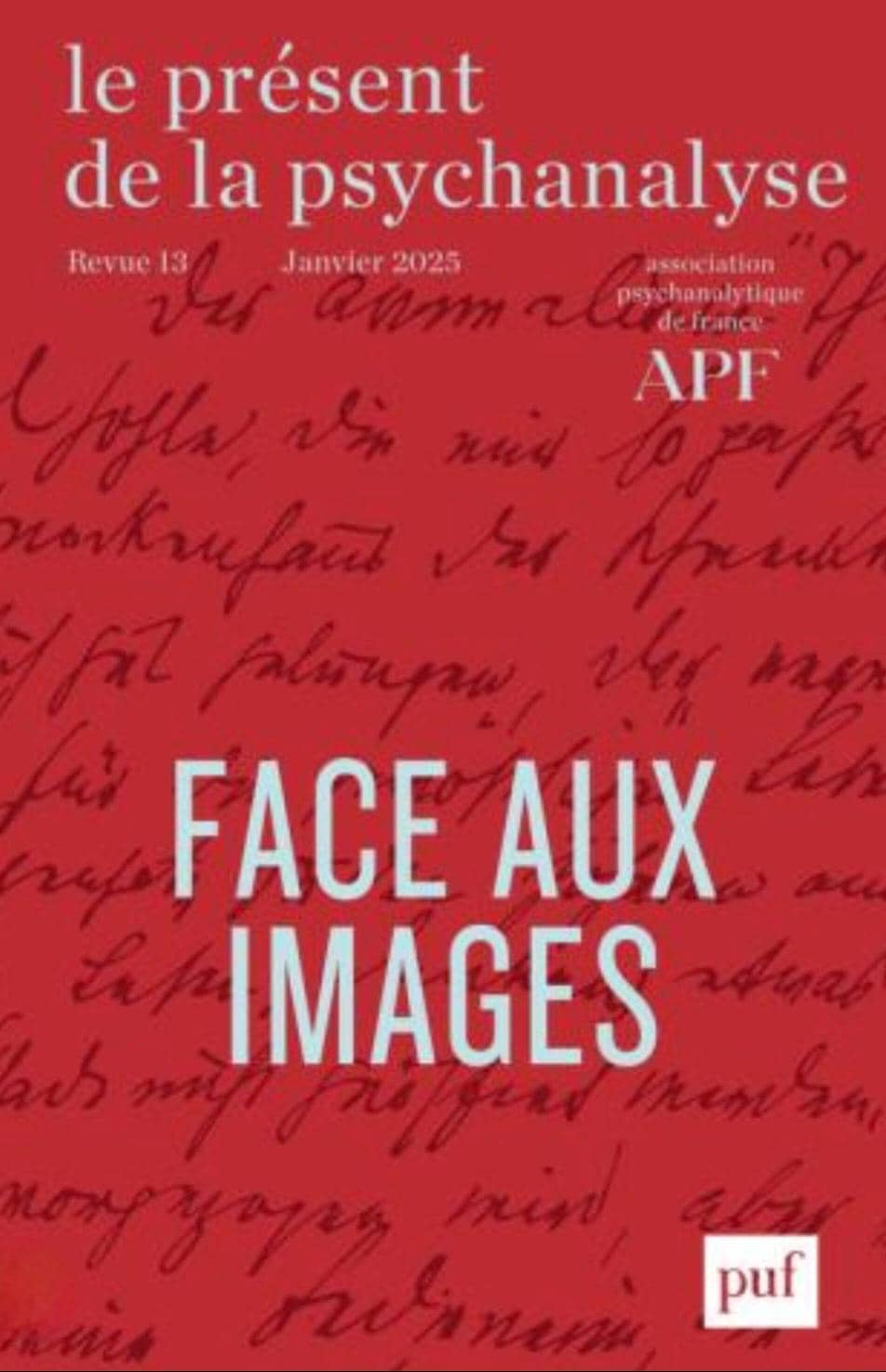Dans ce numéro, on met des mots sur les images. Une démarche que l’on pourrait dire en miroir de celle du rêve, qui met des images sur les mots de la pensée, ce que Freud a appelé « figurabilité », condition de la présentation d’une pensée de rêve par une image de rêve.
Des contributions d’une bonne dizaine de psychanalystes, mais également des auteurs non-analystes, une professeure de sciences de l’information et de la communication, une éditrice et autrice d’ouvrages de jeunesse, un philosophe, une artiste plasticienne, deux poètes agrégés de lettres modernes.
Des images perçues, des images traitées psychiquement, des images créées, fabriquées, c’est ce dont nous parlent les différents auteurs, en voici quelques exemples.
Patricia Attigui a intitulé son travail Du pouvoir imageant de l’écoute. Dans un joli article, elle s’intéresse à ce qui lie le rêve au transfert. Et elle fait l’hypothèse que le pouvoir imageant de l’écoute permet de trouver dans l’analyse et dans le transfert ce qui peut manquer à la théorie.
Effet de vent, effet de temps, effet de vie, Analyse d’un paysage de Soutine, par Anne Beyaert-Geslin ou comment peut s’exprimer le cours du temps dans l’image intemporelle.
Dans Freud et Dali, Frédérick Aubourg parle du rapport du créateur de la psychanalyse aux œuvres d’art. Avec une méfiance voire une hostilité pour les artistes contemporains, expressionnistes, surréalistes, dont Freud ne tenait guère les œuvres pour de l’art, mais pour de la folie, certains artistes pour des fous…
Paule du Bouchet interroge dans son article : Les enfants pensent-ils en images ?Un intéressant point de vue, car de toute évidence les illustrations que les livres montrent aux enfants imposent quelque chose. De quelles images la littérature jeunesse actuelle parle-t-elle ? L’auteure part de sa propre expérience d’enfant.
Jim Gabaret s’intéresse à Une phénoménologie de l’imagination néonatale et infantile et Kalyane Fejtö à L’image et son objet, où les images sont les instruments premiers, les truchements de la satisfaction hallucinatoire.
Vladimir Marinov fait dans Entre douleur et attente une lecture de la correspondance entre Freud et la Princesse Marie Bonaparte, dialogue étrange avec l’os de la mâchoire douloureuse de Freud et l’attente de Marie d’un organe imaginaire qui lui donnerait enfin satisfaction.
Mireille Fognini écrit Mouvements et transformations psychiques dans l’art de « portraitiser ». Inspirée entre autres par Jean-Claude Rolland, l’auteure interroge les sources de l’inspiration qui peut transformer le visage du sujet en un portrait censé lui ressembler dans une image qui rassemble la figure réelle du modèle et l’image intérieure de son peintre.
Dans Guy Rosolato, l’objet de perspective et l’objet a, Patrick Mérot trace un parcours au-delà de l’image qui va de la relation d’inconnu et l’objet de perspective à l’objet « a » de Lacan. Ce texte exigeant qui fait appel à une connaissance des deux points de vue théoriques de Rosolato et de Lacan prouve que la convergence des théories est une ouverture féconde.
Dans Les couleurs de l’irreprésentable, Jean-Michel Lévy montre que l’image, par le biais de la couleur, au sein d’une présentation sensorielle, peut permettre l’affleurement dans la cure d’un matériel psychique autrement inatteignable ouvrant à la question des origines.
Dans L’élaboration des pensées se rapportant à l’enfance, Laurence Apfelbaum relit le texte – contemporain deL’interprétation du rêve – Sur les souvenirs-écrans (1899). Elle y décèle le plaisir que Freud en a tiré en appliquant à son propre souvenir les règles techniques posées pour les productions oniriques. Un travail qui porte sur la mémoire dans la théorie freudienne, avec l’accentuation de ses remaniements – au cours du temps, et par le temps. Le texte de Laurence Apfelbaum donne à voir comment on pense la psychanalyse : ce n’est pas une biographie mais bien une histoire des pensées. Quand, où, comment sont nées nos pensées. Et leur transformation dans les rapports de la mémoire avec la vérité, la réalité, le temps.
Pour conclure, la promesse du titre est tenue et l’on se trouve face à une image de la trace écrite de mots sans lettres formant un tableau, hors lecture comme les enfants – infans, qui ne parlent pas encore – émettent des sons de langage qui ne savent pas qu’ils sont les précurseurs d’une langue. Une brève poésie de Anne Mortal, intitulée Juste une fenêtre, qui accompagne l’image d’un tableau de Krochka. Ci-dessous quelques vers du poème qui, comme un fil, associent le mot à la ligne, la ligne à l’image :
La ligne s’ouvre de quasi rien et s’arrête.
Assez pour que de la suite des lignes bouge un peu d’air.
Chaque ligne va comme on dort
va son tracas et se referme.
D’évidence l’ensemble forme un tableau
Juste une fenêtre.