Jean-Claude Lavie, Le sexe dans la bouche, Petite Bibliothèque de Psychanalyse, PUF, 2020.
C’est une gageure de prendre la parole après la lecture des textes de Jean-Claude Lavie qui sont regroupés dans l’ouvrage que lui consacre la Petite Bibliothèque de Psychanalyse, gageure qui nous enjoint à faire véritablement nôtre l’intrépidité indispensable relevée par l’auteur, à qui fait de la parole et de l’écoute sa pratique. Ce titre d’abord, Le sexe dans la bouche, rien du plus conventionnel, et donc du plus supportable, sexe à la bouche… Nous sommes d’emblée plongés dans l’expérience que produit une écriture qui se tient au plus près de la langue et de son commerce avec le sexe.
Le recueil se compose de huit essais, repris par l’auteur dans ses écrits, ou composés pour l’occasion. L’ensemble mérite d’être lu dans la continuité, la construction imaginée par Jean-Claude Lavie relevant d’une subtile progression, où les deux premiers textes paraissent poser d’entrée, dans des styles très différents, l’apparente impossibilité de la folle entreprise en quoi consiste la psychanalyse, à la pratiquer, à en parler, à l’écrire. Le récit fictionnel « Panther » proclame ainsi avec humour qu’il pourrait en être fini de la parole et du psychanalyste au profit d’une méthode alternative basée sur l’acte virtuel et le solipsisme narcissique, quand « Écrire à la chair mère », posant que parler à l’autre n’est toujours que parler de soi, questionne la possibilité même d’adresser ce qu’on veut dire ou d’être entendu, alors, pour ce qu’il en est de l’écrire…
Le cadre est posé. La cure de parole est née, rappelle inlassablement Lavie, de l’intuition freudienne de délaisser l’irrationnel de la névrose pour se tourner vers le rationnel des discours engendrés par elle. Et que c’est en percevant dans ces discours sa méta-psycho-logique, démarquée de celle du rêve, que Freud a agencé sa pratique. Si le rêve est la voie royale vers l’inconscient et son fonctionnement, c’est bien l’écoute de sa mise en mots, comme de celle du symptôme, qui en permet l’accès. C’est dès lors du rapport ignoré de chacun, patient comme analyste, au langage et au sexuel qui le meut dans ce qu’il dit ou ce qu’il tait, que se fonde la situation analytique. Voilà ce dont il va être question, et on oserait dire, qu’à ce titre, Le sexe dans la bouche est un magnifique manuel pratique à l’usage de tout analyste resté curieux de ce qui, de la langue du patient, anime son écoute, soutient son silence ou impose sa parole.
« Le sexe dans la bouche », qui donne son titre au recueil, et « L’œil du cyclone », forment un diptyque qui témoigne de la richesse que la pensée du psychanalyste doit à sa double filiation, à Freud, celui qui a sexualisé l’intellect, et à Lacan, celui qui a intellectualisé le sexuel. Du premier, il prolonge la portée du legs sexuel dont hérite chaque analyste par sa soumission à la méthode (…), expérimentée par (son) analyse personnelle, pour penser l’usage clinique des courants sexuels, les registres de l’agressivité et de la tendresse permettant tout particulièrement de dépister le sexuel sous ses diverses apparences. D’une écriture qui érige le débat en forme de pensée par un constant dialogue avec son lecteur, Lavie questionne l’écart entre le sexuel de la théorie et l’affrontement au sexuel dans la pratique de la cure : de quoi se protège l’analyste qui disparaît en s’abritant derrière Freud, et le patient derrière les mille variantes du « on m’a dit que » ? Qui sexualise les propos du divan, la bouche qui énonce ou l’oreille qui écoute ? D’où vient, sinon des effets produits sur lui par la parole du patient, la disposition de l’analyste à saisir les effets révélateurs d’une parole qui s’ignore comme démarche itérative ?
N’ayant pas toujours la chance de disposer d’un lapsus qui ferait la plus grande partie du travail, nous n’aurons que nos réactions d’écoute, lesquelles nous conviendrons diversement selon leur nature. Parmi elles, le plaisir de l’analyste, mais pas celui qui se dilue dans un complément – plaisir du bon mot, plaisir des gratifications narcissiques etc., non, le plaisir ressenti, concret et rarement formulé entre collègues. Que penser, interroge Lavie, des moments d’érotisation inopinée, qui ont tout pour être dérangeants, parce que déplacés au double sens du terme ? (…) Le sexuel sous une forme non sexuelle, nous en faisons facilement notre affaire. Mais quand il a une forme directe, il nous déconcerte – surtout pour en parler. (…) Y aurait-il dans le sexuel un secret à maintenir ? (…) Assurément. Ce secret (…) pourrait être le simple rappel de notre subordination au plaisir. Et si nous, alors nos parents, notre analyste, Freud ! Ce qui rend le registre de la sexualité difficile à évoquer, c’est que si on peut parler de la science de façon non scientifique, ou d’art de façon non artistique, il est difficile de parler de sexe de façon non sexuelle. C’est le plaisir charnel implicitement convoqué qui vient tout compliquer. Il faudrait alors en désérotiser, non pas la nature, mais la communication, d’où notre tenace revendication d’avoir une activité scientifique, comme si c’était un blanchiment. C’est cet affrontement cru au charnel, y compris en nous-même, qui réclame de l’analyste une certaine dose d’intrépidité, cette intrépidité qui a tout, par elle-même, d’un courant sexuel qui, en amalgament violence et plaisir, serait par là un des moteurs secrets de notre activité d’analyste.
Alors que « Le sexe dans la bouche » explore une parole sexuelle héritée de Freud, « L’œil du cyclone », reprise d’un texte présenté à l’APF en 1997 sur le thème « Le signifiant pour quoi dire ? », l’envisage à travers sa structuration en mots dotés de sonorité et de sens. Si la différence entre « signifié » et « signifiant » est opérante chez Freud, et même clé du lapsus, le glissement qu’imprime Lacan au signifiant en en faisant une métaphore participe à l’indétermination contemporaine de son sens. Du même vocable relève une chose et son contraire : une sonorité sans particularité, un mot porteur de sens. L’œil du cyclone est l’image qui saisit cette aporie et lui donne une application pratique : l’écoute de l’analyste est attentive au mouvement tourbillonnaire centré autour de l’œil, qu’il soit conçu comme la zone calme et inerte au centre de l’ouragan, ou comme son point organisateur. L’auteur n’a de cesse de rappeler dans ses textes, combien plutôt que contenu, l’inconscient est mouvement, il est ce qui préside à la survenu et au surgissement de telle pensée ou de telle parole.
Mais ce qui retient particulièrement notre attention dans ce texte dense, c’est l’insistance de Lavie sur la matérialité toute primitive du langage. Au fond, la conception lacanienne nous est presque plus acceptable avec ses effets structurants, là où demeure intolérable à la pensée que la simple vibration sonore puisse la déterminer par sa seule matérialité aléatoire, soit l’emprise que les rencontres phonématiques ont sur notre destin, et que pistent les travaux de Robert Pujol. Parce que la nature sonore du langage induit son incarnation dans une parole et son énonciation dans une temporalité, un dire (…) est une affaire personnelle au présent de sa formulation. C’est pourquoi on demande au patient de parler, sans lui préciser de qui. Comment éviterait-il de dire « Je » et par là de se manifester désirant, par le simple usage de n’importe quel signifiant ? C’est ce « je » désirant, incarné dans la formulation des signifiants qui retient l’analyste. (…) Dans l’énoncé de toute parole il y a un « je » en acte et en demande. C’est la dynamique de la cure.
Et on pourrait dès lors lire dans un même mouvement les trois essais « Relents de peste », « Regard sur la pratique analytique » et « Le paradigme perdu », comme l’exploration de cette dynamique éminemment subjective. Pas moins pris que son patient dans la dimension actualisante donc agissante du langage au profit secret du parleur (quand je parle, je ne sais pas ce que je dis, et surtout, je ne sais pas ce que je fais à le dire) l’analyste, de son fauteuil, est un acteur permanent de ce démarquage de la parole, c’est même là son mode d’écoute. Mais qu’il ouvre la bouche et il en devient également le jeu, avec des implications différentes selon que sa parole s’énonce dans le ici et maintenant de la rencontre et de la répétition transférentielle, ou qu’en dehors de la séance, à l’écrit ou à l’oral, elle expose la cure et le patient et ce faisant, l’expose. C’est que la chose psychanalytique n’a pas d’existence en dehors de l’expérience même de sa pratique dans le cadre de la cure. Or, contrairement à la théorie ou à la technique, la pratique est par nature personnelle. C’est la personne de l’analyste, avec tout ce qui la constitue, qui crée par son écoute l’objet de sa saisie : la situation, qu’il élabore et de fait, régit, ou le patient, qui ne lui est donc pas objet extérieur, mais constitué par leur rencontre. Avec lui, l’analyste a affaire, en partie, à lui-même. Cette subjectivité constitutive de la pratique se redouble, du fait que sa dimension psychanalytique est à la merci de qui, à l’écoute du récit, lui donnera tel ou tel écho qui la qualifiera comme telle. C’est donc l’appréciation théorique attribuée au récit d’une pratique à la dimension éminemment contingente qui la fait considérer comme psychanalytique ou pas. L’oreille qui reçoit n’est pas moins personnalisée que la bouche qui émet.
Si le référent est toujours subjectif, la normativité du paradigme parviendrait-elle à arrimer notre parole dans un discours commun et partageable, au moins au nom de Freud ? La peste soit du langage ! Malgré leur apparence réaliste, les récits de cure dénoncent l’empreinte de leur rapporteur en affichant la nature de ses pactes avec les paradigmes psychanalytiques qui arriment son récit. Alors, comment transmettre la psychanalyse ? Toute la difficulté est là : enseigner comment penser sans enseigner quoi. On mesure à les lire combien l’ensemble de ces textes développe une pensée éminemment en prise avec ce à quoi chaque analyste s’affronte dans l’intime de la séance et dans la communauté de ses pairs. L’incessant questionnement de Lavie a le pouvoir de rappeler la radicale étrangeté d’une expérience qui ne sera jamais banale et qui mériterait notre constant émerveillement de ce que produit sur l’homme le langage. Malgré nos infinies diversités, conclut-il, ce qui nous rassemble c’est de maintenir vivante la découverte freudienne du pouvoir qu’exerce sur le destin de tout homme ce qui est voué à échapper à sa saisie.
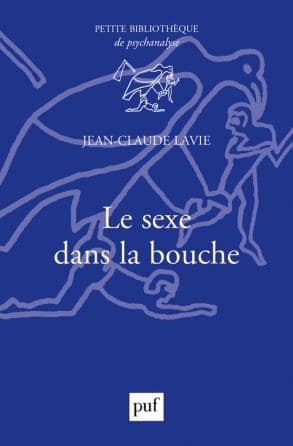 Le recueil s’ouvre, plus qu’il ne se clôt, sur un court et saisissant écrit, « La banalité », très proche dans l’intime de son timbre à « Écrire à la chair mère ». Interpelant directement le lecteur et jouant de son écoute, Jean-Claude Lavie dit la psychanalyse comme rapport au monde, un mode d’être comme une réponse à l’ironique thérapeutique du procédé Panther. Et voilà qu’au solipsisme narcissique du grand fauve inaugural, se substitue dans ma pensée l’oxymore inattendu de solipsisme ouvert, ouvert aux autres, ouvert au temps. Pour finir, on aimerait rappeler que ce livre est celui d’un analyste presque centenaire, impliqué dans les mouvements du siècle, qui nous a quitté en juillet dernier. Dire aussi combien s’y font entendre les échos d’un parcours jalonné de rencontres parmi lesquelles Freud et Lacan évidemment, mais Wladimir Granoff également, l’ami du « désaccord parfait ». Partager enfin le réel plaisir de lecture d’un texte érudit, généreux, jamais dénué d’humour, parfois aussi vertigineux que les figures tourbillonnantes de l’ouragan, du trou noir, de la spirale ou de la voltige du trapéziste, qui nous emportent mais sans jamais nous lâcher ! Michel Gribinski indique en préambule combien il importait à Jean-Claude Lavie que le lecteur le lise, lui, plutôt qu’un texte obéissant à des impératifs syntaxiques ou éditoriaux. C’est chose faite, sinon que, davantage encore que des mots qui se lisent, c’est une voix qui se fait entendre.
Le recueil s’ouvre, plus qu’il ne se clôt, sur un court et saisissant écrit, « La banalité », très proche dans l’intime de son timbre à « Écrire à la chair mère ». Interpelant directement le lecteur et jouant de son écoute, Jean-Claude Lavie dit la psychanalyse comme rapport au monde, un mode d’être comme une réponse à l’ironique thérapeutique du procédé Panther. Et voilà qu’au solipsisme narcissique du grand fauve inaugural, se substitue dans ma pensée l’oxymore inattendu de solipsisme ouvert, ouvert aux autres, ouvert au temps. Pour finir, on aimerait rappeler que ce livre est celui d’un analyste presque centenaire, impliqué dans les mouvements du siècle, qui nous a quitté en juillet dernier. Dire aussi combien s’y font entendre les échos d’un parcours jalonné de rencontres parmi lesquelles Freud et Lacan évidemment, mais Wladimir Granoff également, l’ami du « désaccord parfait ». Partager enfin le réel plaisir de lecture d’un texte érudit, généreux, jamais dénué d’humour, parfois aussi vertigineux que les figures tourbillonnantes de l’ouragan, du trou noir, de la spirale ou de la voltige du trapéziste, qui nous emportent mais sans jamais nous lâcher ! Michel Gribinski indique en préambule combien il importait à Jean-Claude Lavie que le lecteur le lise, lui, plutôt qu’un texte obéissant à des impératifs syntaxiques ou éditoriaux. C’est chose faite, sinon que, davantage encore que des mots qui se lisent, c’est une voix qui se fait entendre.
Martine Mikolajczyk, Psychanalyste