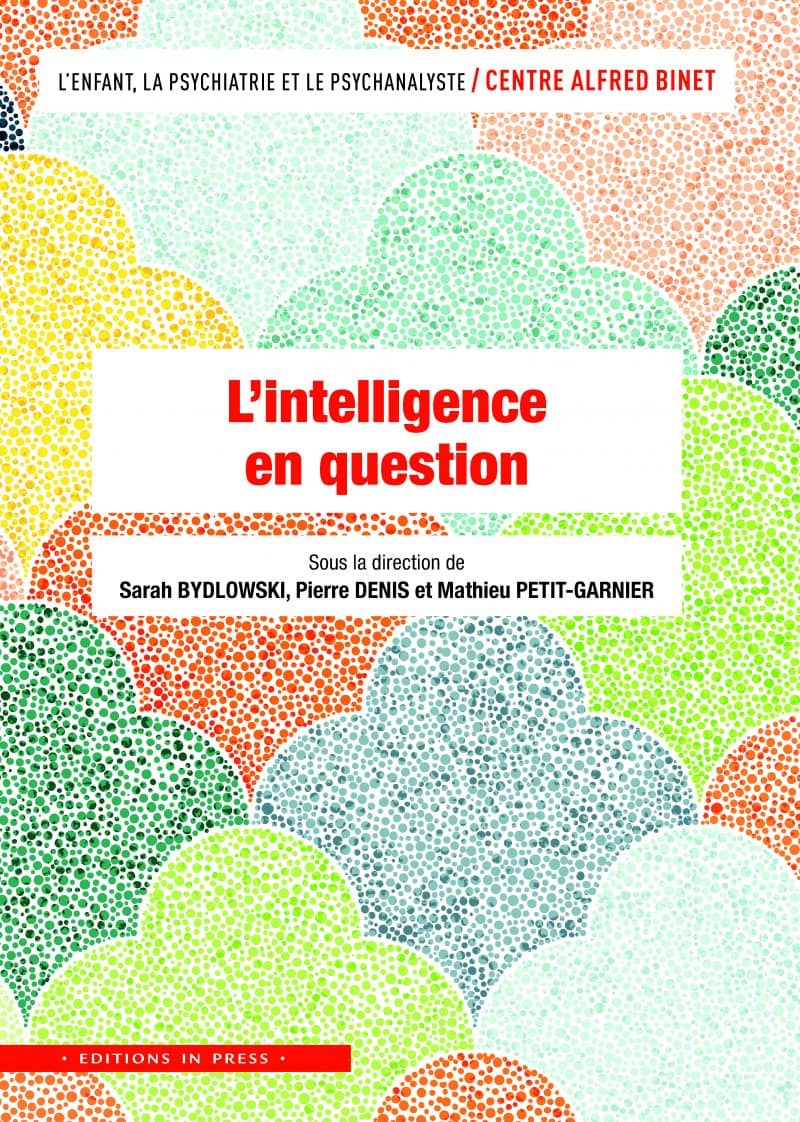Intitulée L’intelligence en question, la Monographie du Centre Alfred Binet dans la collection « L’enfant, la psychiatrie et le psychanalyste » prend le parti de mettre en doute, de reprendre à la source ou encore de revisiter cette notion aussi courante que mal connue qu’est l’intelligence.
Si elle n’avait pas jusqu’alors attiré mon attention de cette façon, elle m’est apparue à la lecture du livre extrêmement centrale à toutes nos réflexions : elle traverse l’ensemble de la théorie psychanalytique, se situe au cœur des préoccupations des thérapeutes de l’enfant et constitue un enjeu majeur de notre société avec la figure de l’Intelligence Artificielle.
En tant que psychologue clinicienne, la réalisation de bilans psychologiques incite à la prudence dans le maniement des données relatives au fameux Quotient Intellectuel. Les performances quantitatives ne peuvent être interprétées sans leur mise en relation avec le fonctionnement psychique dans lequel elles s’inscrivent. Les parents méconnaissent le plus souvent la dimension globale d’une organisation souple et harmonieuse, qui éprouve du plaisir à fonctionner. Ils sont facilement happés par la question des chiffres qui figent dans leur esprit ce que l’on essaye au contraire de traduire en termes de dynamique. Ce sont les épreuves projectives qui viennent nuancer et compléter les données reflétant les capacités intellectuelles, car elles mobilisent les processus de pensée au moment où ils sont affectés par la nécessité de prendre en charge les conflits. On peut ainsi observer comment le rapport au réel peut être fragilisé par les productions déstabilisantes de l’inconscient. L’intelligence à laquelle on s’intéresse est dans le fond la capacité de traitement psychique des conflits.
En parallèle, en place de thérapeute et de psychanalyste, les patients s’engagent dans un travail lorsqu’ils se heurtent à des impasses dans divers secteurs de leur vie, malgré une intelligence qui ne fait pourtant aucun doute. Le but de la cure est celui de permettre au moi de fonctionner avec une plus grande souplesse, de conquérir un plaisir et des capacités de pensée qui permettent de traiter l’imaginaire sans le réduire, et d’enrayer la répétition à l’œuvre. Là encore, notre attention se porte sur une intelligence en mouvement, sur le jeu possible entre les instances et la capacité à prendre en charge les motions pulsionnelles.
Le dernier axe qui a accompagné ma lecture, du fait de son essor fulgurant ces derniers mois, est l’Intelligence Artificielle. Encore peu développée au moment de la conception du livre, elle n’y figure pas. Prise dans le souhait de repousser les limites de nos réalisations et de nos possibilités, l’Intelligence Artificielle s’oppose et interroge la qualité de l’intelligence humaine. Elle remet au jour l’éternelle problématique du remplacement de l’homme par la machine. La presse interpelle : pourrait-elle venir supplanter les psychologues, les psychanalystes ? Elle suscite sans doute la tentation pour le patient de s’adresser à « elle », sans que le coût de « dire » ne soit convoqué, ni même celui de rencontrer une personne en chair et en os, procurant ainsi l’illusion de pouvoir faire l’économie du recours à un autre.
A tous ces égards, j’ai lu la monographie avec intérêt, y trouvant une magnifique démonstration de ce qui est absolument irremplaçable dans la convocation de l’intelligence humaine, ce supplément d’âme que chaque auteur va chercher à approcher.
Vaste sujet donc, attesté par l’épaisseur du volume ; celui-ci se divise en quatre parties distinctes. Une première reprend et illustre la métapsychologie freudienne autour de cette notion qui engage sans détours les idéaux et leurs butées. La deuxième nous amène à penser une intelligence langagière avec un retour aux étapes les plus précoces d’apparition de la langue. Une troisième partie s’intéresse à son inscription dans la société et dans nos institutions à la fois de soin et scolaire avec la question des apprentissages. Enfin la dernière partie propose des ouvertures variées pour penser les conséquences de la convocation des pulsions de vie et de mort dans l’exercice de l’intelligence, les figures d’une réussite narcissique chez l’adulte ou encore les potentiels bénéfices intellectuels conquis dans la cure analytique. À sa lecture, on suit l’alternance de textes plus techniques et/ou théoriques avec des mises en situation illustratives du travail clinique au plus près des patients, du tout-venant aux situations plus complexes. Malgré la diversité des axes proposés pour traiter la question, l’ouvrage converge remarquablement sur la nécessité de considérer l’intelligence dans toute sa complexité.
C’est dans cette perspective que Sarah Bydlowski oriente d’emblée notre attention dans l’introduction, en pointant les enchevêtrements du développement de l’intelligence, « fruit d’une succession de réaménagements et d’une construction métapsychologique, dynamique, topique et économique. » Outil indispensable pour penser l’intelligence, la métapsychologie freudienne inscrit les processus de la vie psychique à l’articulation des composantes neurobiologique et relationnelle. L’environnement au sens large y joue une place déterminante. Dans le contexte où l’intelligence est devenue enjeu de pouvoir des parents face à l’école, la demande d’étiquetage diagnostique explose au détriment à la fois de la reconnaissance de l’enfant dans sa singularité mais aussi de la prise en compte de la complexité de son développement. Au sein du maillage relationnel autour de l’enfant, Sarah Bydlowski va singulariser la place de l’analyste qui œuvre et s’engage dans la relation avec lui, principalement grâce à sa créativité afin de favoriser l’appui sur son monde interne pour penser. L’enjeu est pour l’analyste d’ouvrir le plaisir au sein du fonctionnement mental et de l’investissement intellectuel de l’enfant, par la voie du jeu dans lequel l’humour trouve une place de choix.
La première partie s’ouvre ensuite avec Mathieu Petit-Garnier qui va suivre, adossé aux textes freudiens, les occurrences de la notion d’intelligence au fil de la théorie, dans ses dimensions précocement narcissiques, œdipiennes, post-œdipiennes, en passant par les enjeux identificatoires de la différence des sexes. Il va ainsi décliner les origines et les logiques diverses dans lesquelles elle est susceptible de s’inscrire pour le meilleur et pour le pire. Dans le même mouvement de la liaison profonde de l’intelligence à la vie affective, il rappelle que l’attention, la mémoire, le jugement, la motricité et la pensée se construisent à l’origine chez le bébé sous le primat du principe de plaisir, pour tenter de maintenir activement la satisfaction dont la réalité le prive. Du côté des parents, qu’ils soient en excès, en carence ou ambivalents, leurs exigences et leur amour conditionnent l’accès à la pensée de leur progéniture. Du côté de l’enfant, c’est poussé par la curiosité de comprendre l’exclusion dont il est l’objet que son investissement intellectuel rencontrera plusieurs destins tels que l’inhibition, l’intellectualisation et la sublimation. En fonction des aléas de sa construction narcissique puis œdipienne, la qualité de son intelligence prendra des colorations variées, qui dans le meilleur des cas sera dégagée de la logique phallique et intègrera la passivité du féminin. Elle sera le résultat d’un renoncement plutôt que chargé d’une équivalence de réalisation des vœux œdipiens, car dans ce cas elle risquerait d’être chargée de culpabilité. Finalement, Mathieu Petit-Garnier résume ainsi : « la pensée nécessite un appareil psychique suffisamment constitué pour accueillir, contenir et transformer les excitations internes comme les stimulations du monde extérieur. » Être intelligent serait donc « pouvoir traiter à la fois de la réalité extérieure, les pressions du ça et les contraintes du surmoi ». Dans ce cadre, il met en avant à son tour la place de l’humour, dont la correspondance chez l’enfant serait la capacité à pouvoir créer un espace de jeu dégagé du tragique.
Deux exemples illustrent l’importance de la liaison psyché-soma dans l’exercice de la pensée, attachée à un corps affecté. Alexandra Depouez déroule le fil d’un long travail de psychothérapie engagé à l’adolescence, période durant laquelle la pensée court le risque de perdre son ancrage au corps, en particulier quand les turbulences de cette période de reviviscence sont trop fortes. C’est le cas pour ce jeune homme aux prises avec une activité motrice pathologique, où les mises en acte obèrent le travail d’élaboration puisque précisément il ne veut pas savoir. En séance, il met en scène des scénarios crus, chargés en processus primaires, sa symbolisation est précaire et sa pensée hypersexualisée. Le fantasme de scène primitive n’étant pas suffisamment refoulé, l’excitation doit être déchargée par d’autres moyens, en l’occurrence ici par l’activité motrice. Le travail de mise en mots au cours de la thérapie, véritable contenant de pensée à travers le transfert, va opérer le décalage du regard du patient sur lui-même. Cela lui permet l’investissement d’une pensée moins excitante, en même temps que l’ouverture vers la passivité et l’accueil d’affects de tristesse jusqu’alors tenus soigneusement à l’écart. Cette intégration psyché-soma qui a pu se réaliser est soulignée par Alexandra Depouez comme le levier vers l’expression d’une intelligence plus harmonieuse en parallèle d’un élargissement de l’espace psychique intérieur.
Un exemple en complémentarité est présenté par Tiffany Vervelle, il s’agit d’un enfant à l’efficience cognitive patente, dit surdoué. Pour autant, son fort investissement intellectuel n’est pas le garant de la qualité de son fonctionnement psychique puisque ce garçon au QI élevé ne peut se laisser aller à jouer : dans ce cas où la sublimation est surinvestie, elle met défensivement à distance la pulsionnalité, les affects et la vie imaginaire. L’espace de thérapie constitue dans un premier temps un lieu d’apaisement et de pare-excitation avant que la puberté rebatte les cartes de son organisation. En effet, un vacillement identitaire à l’entrée au collège se manifeste par des moments de repli, une menace de vide, d’étrangeté et une quête de sensorialité. Peu à peu, une recherche de sensations fortes s’aménage à travers le sport. La pratique du hip-hop lui permet en fin de compte d’éprouver ses limites corporelles, tout en y intégrant la part fondamentale affective et relationnelle. Le risque de désobjectalisation a ainsi pu être enrayé. Tiffany Vervelle montre comment le corps mis en scène par la danse réalise un acte de liaison psyché-soma. La danse offre une voie de symbolisation aux expériences précoces réactivées par le pubertaire et facilite l’ouverture chez ce jeune homme d’une capacité à se rêver.
La deuxième partie du volume concerne l’intelligence dans un en-deçà du langage. Evelio Cabrejo Parra décrit le cheminement qui prépare l’émergence des mots, témoins du monde interne. Il va tout particulièrement souligner dans le développement ce qui découle de la séparation dès la naissance et de l’absence dans l’avènement du langage et de la pensée. Ils sont convoqués pour nommer, comprendre et pallier la distance créée avec l’objet. Dès la naissance, il décrit comment le bébé a la capacité de comprendre les règles qui régissent la langue. Il perçoit très tôt les opérations de liaison – des consonnes, des voyelles, des syllabes – qui soulagent l’angoisse de séparation et créent du lien avec la mère. Cela participe à la création psychique de la représentation symbolique de l’autre. La répétition des pratiques culturelles – du rythme des soins, du sommeil, de l’alimentation, des chants, la tonalité de la voix, des berceuses – aide l’enfant à anticiper les rencontres gratifiantes. Il les désire et cherche à les renouveler, ce qui alimente la pensée. La représentation d’absence est tout aussi fondamentale : l’intelligence trouve des substituts à ce manque par des processus d’une grande complexité comme en témoigne l’utilisation des objets transitionnels, le jeu de la bobine, etc. Le partage avec l’objet nécessite au préalable sa séparation symbolique et il n’y a que le langage qui peut nommer l’absence. Evelio Cabrejo Parra précise que cette création intelligente pour le sujet qui fait exister dans son imaginaire ce qui n’existait pas est une possibilité psychique que l’on réutilise ensuite toute sa vie, pour jouer mentalement avec nos objets internes.
Les achoppements à ces étapes archaïques du développement obligent à mobiliser des capacités régressives pour revenir aux prémices du langage et tenter de rétablir et/ou d’établir des connexions qui n’ont pas pu être réalisées par l’enfant. Emmanuelle Gaborit rend compte du travail de thérapeute par le langage en explorant les voies qu’elle emprunte du désir de communiquer au temps du préverbal jusqu’à l’émergence de l’envie de parler, puis d’écrire et de lire. L’auteur expose le cas d’Hicham, enfant initialement sans langage présentant une dysharmonie évolutive. Il a pu déployer une intelligence sensible, permettant la liaison avec ses émotions et celles des autres à travers le plaisir de lire à deux. C’est d’abord en interprétant le langage de l’enfant à son niveau, attaché à son rythme qu’un espace commun a pu s’ouvrir par le jeu et le dessin puis par la lecture. L’appui sur l’image d’histoires diversifiées a permis de tisser un vécu commun, l’enfant s’appropriant grâce à cette expérience les émotions des personnages en écho à sa propre histoire, créant ainsi des mouvements identificatoires et des ponts pour penser. Ce plaisir découvert à deux, évoqué par Emmanuelle Gaborit, constitue un levier majeur pour la conquête d’une autonomie, l’accès aux connaissances du monde en liaison à ses propres affects. Ce travail est possible grâce à l’utilisation de l’image ; en revanche, quand un enfant n’a pas accès à son pouvoir de représenter, la thérapie est plus délicate. C’est le cas d’une autre situation clinique qui est présentée par Marie-Françoise Bresson (réédition). Il s’agit du traitement d’Hector, enfant présentant une pathologie complexe associant difficultés de communication et absence de langage. La thérapie dans cette situation consiste à développer la compréhension de l’enfant et à tenter d’organiser une communication sans langage. L’enjeu majeur n’est rien moins que l’organisation de la pensée et du développement cognitif. Hector accède à la compréhension du pouvoir de représentation des mots, du langage par l’accès à l’image. Puis c’est en investissant les liens entre les images, ou pantomime, et le langage qu’il trouve la possibilité d’illustrer son propos par une séquence motrice. L’élargissement de son champ de communication par l’association de signes permet progressivement à l’enfant d’utiliser son corps et d’exprimer une variété d’émotions. L’humour et la création viendront ensuite s’intégrer à ces acquisitions. Si petites soient-elles, elles représentent une avancée et souvent un bénéfice substantiel pour les proches et en particulier les parents, étant donné les possibilités de communication qu’elles offrent avec l’enfant.
La troisième partie s’intéresse aux empêchements de l’intelligence dans les apprentissages. Jean-Yves Chagnon fait le constat des difficultés actuelles de la psychiatrie et de la psychopathologie de l’enfant dans les troubles des apprentissages. Son article très engagé et étayé de références soutient « une approche clinique et psychopathologique raisonnée des troubles des apprentissages et des troubles instrumentaux qui les sous-tendent ». Jean-Yves Chagnon décrit le contexte de l’hypermodernité néolibérale qui a conduit à la disqualification de la psychopathologie clinique psychanalytique et à la prédominance du modèle neurologique avec la référence au « dys– », renvoyant à des fonctions et des troubles spécifiques isolés plutôt qu’à une approche psychopathologique globale. La dimension psychique des troubles et des facteurs liés à l’environnement a été mise à l’écart, en dépit des avancées scientifiques qui attestent de la plasticité cérébrale et d’une épigenèse interactive. L’absence de conflictualité psychique et le peu de place laissé à l’autre dans les apprentissages a pour objectif la déresponsabilisation et la déculpabilisation de l’environnement. S’il critique un abord psychanalytique qui a eu le tort de sous-estimer la part instrumentale des troubles dans les apprentissages, se priver des apports de la psychopathologie dans leur compréhension serait préjudiciable. En particulier, il relève à travers les travaux actuels l’existence d’un noyau psychopathologique des troubles instrumentaux et des apprentissages, constitué par une fragilité profonde du narcissisme, de la fonction symbolique ainsi que de l’élaboration de l’agressivité et des affects dépressifs. Il souligne en conclusion la nécessité de soutenir une approche psychopathologique intégrative, de transmettre la pensée clinique et d’insister sur l’intrication des processus entre cognition et affectivité. En l’absence de causalité linéaire, seul un abord thérapeutique diversifié, soutenu par un travail de réseau, est susceptible d’être efficace.
Sur ce chemin des entraves aux apprentissages, deux contributions témoignent des bienfaits de l’utilisation de la psychopédagogie. Discipline à la fois peu connue et mal circonscrite, elle s’avère précieuse pour remettre en mouvement et dégager des fonctionnements bloqués dans l’utilisation de leur intelligence, chez des enfants qui de ce fait ne peuvent pas encore bénéficier d’une psychothérapie. Karine Arakelian insiste tout particulièrement sur l’impact de l’environnement avec l’idée de « soigner par l’apprentissage ». La qualité des investissements libidinaux et la possibilité de contenir les pulsions favorisent l’ouverture vers les apprentissages, le rapport au savoir dépend donc très étroitement de la famille et des parents.
L’engagement harmonieux dans les savoirs se noue dans un partage cohérent des idéaux de l’enfant avec ceux de sa famille et de l’école. Son accès est d’emblée psychologique, sociologique et culturel. Karine Arakelian prend l’exemple d’un enfant en difficulté pour investir l’école. Dans une situation de vulnérabilité transculturelle et socio-économique, l’investissement du langage est associé à une pensée confuse entravée par des émergences archaïques. Des fragilités narcissiques adviennent et faute de contenir les débordements pulsionnels, l’enfant a tendance à transgresser les règles. La psychopédagogie vise la transmission du plaisir d’apprendre en utilisant la relation humaine, l’écoute et la confiance. Les objets culturels de l’enfant, ses domaines d’investissement personnel et le désir de savoir trouvent une passerelle portée par une communication à l’autre qui prend une signification nouvelle par le jeu et la narration d’histoires. Dans cet espace proposé, l’enfant expérimente sa capacité à réinventer et à transformer, à créer du nouveau, à jouer. Au fil des séances, l’accès aux conflits psychiques aide l’enfant à conflictualiser les interdits, à jouer avec l’agressivité et à autonomiser sa pensée. Ainsi, tous les objets de connaissances sont susceptibles d’ouvrir au plaisir d’apprendre chez l’enfant et de devenir ainsi objet du soin.
Fabrice Hayem insiste de son côté sur la fonction de contenance pulsionnelle qu’apporte la psychopédagogie chez des enfants en difficulté de symbolisation : ils ne savent pas jouer avec les objets culturels de l’école. Il évoque l’existence accrue de latences à répression pulsionnelle par défaut de mentalisation. Elles renvoient à des organisations qui ne diffèrent pas la satisfaction et ne peuvent pas suffisamment utiliser le refoulement. Ces enfants qui n’ont pas à leur disposition une pensée symbolisée par l’intermédiaire du rêve et du jeu, par la rencontre et l’accès à du créatif, ont besoin d’une aide. L’investissement d’objets culturels autorise un moment d’écart et d’éveil à la symbolisation. La psychopédagogie n’a pas comme but de traiter les problèmes d’apprentissage, elle permet plutôt une entrée en relation avec le monde interne de l’enfant. Parce que ces enfants ne supportent pas d’accéder à la pensée, ils ont besoin d’en passer par l’autre. L’adulte transmet à l’enfant sa propre appréhension de l’objet et lui fraye une voie de rencontre à son tour. L’adaptation du cadre, du rythme, s’accompagne d’un bain de langage et de parole là où cette dernière fait défaut. De cette manière, le processus associatif se met en œuvre et génère une capacité de symbolisation intégrant le déplaisir. Cela pourra constituer une porte d’entrée vers une psychothérapie. La psychopédagogie constitue un moyen de « régulation » pour transformer l’excitation en pensée quand le milieu scolaire ne parvient plus à s’adapter suffisamment aux difficultés de l’enfant.
Enfin, le dernier chapitre tire plusieurs fils pour élargir le sujet. Denys Ribas nous mène au cœur de l’intelligence en s’intéressant à ce qu’implique la convocation inévitable des pulsions de vie et de mort dans l’exercice de la pensée. Ainsi il remarque que l’insight s’accompagne d’une bonne perception de l’autre, d’une capacité à la relation. Quand un enfant en construction se trouve en-deçà de l’identification projective kleinienne, on s’inquiète de l’effet délétère du désinvestissement des autres et de soi, c’est le cas des fonctionnements autistiques qu’il connait bien. L’auteur s’intéresse à leur intelligence qui tout à la fois fascine et condamne. Il invite les thérapeutes à aller au-delà de leurs a priori, en cherchant à accompagner l’intérêt des patients autistes, qui se révèle plus authentique que restreint et dont il montre, à l’aide d’exemples, la fonction éminemment symbolisante. Si leur spectaculaire intelligence est le produit d’une désintrication pulsionnelle, la plasticité cérébrale est toujours disponible pour accueillir des évolutions. Il souligne ainsi l’acquisition possible d’une capacité à mentir et à faire semblant.
Par ailleurs, Denys Ribas relativise la qualité d’investissement sublimatoire de Léonard de Vinci en dénonçant des carences au niveau de sa relation aux objets. Sa sublimation aurait partie liée à un clivage et à un refus drastique de la perte. Il précise aussi que c’est au sein d’une intrication pulsionnelle bien tempérée, soutenue par un masochisme érogène fonctionnel que l’intelligence s’épanouit au sein des relations d’objet.
Brigitte Bergmann déploie de son côté une pensée subversive, elle propose un renversement du regard sur l’intelligence en postulant que la réussite serait le contre investissement ou le symptôme d’une pathologie narcissique. À la différence des organisations « normalo-névrotique » qui ont la capacité à traiter la castration, le besoin de cohésion du moi est tel dans les pathologies narcissiques que la menace de castration, insupportable, est vécue comme une béance et un effondrement. Dans ce contexte, tout échec est impossible : le mouvement dépressif de renoncement nécessaire à une bonne santé psychique ne peut pas s’amorcer et permettre un dégagement. L’exemple donné à partir des écrits de Sartre est éloquent pour mettre à jour la liaison profonde entre l’investissement sublimatoire et les objets d’amour. L’enfant fixé dans une position valorisée qui conforte sa puissance est piégé dans une boucle narcissique au sein de laquelle les renforcements provenant de l’environnement entraînent de nouveaux investissements et de nouveaux profits, sans fin. Elle pointe dans ces fonctionnements un clivage à l’œuvre, qui peut évoquer le faux-self chez Winnicott ou le bébé savant chez Ferenczi, dans lequel le moi prématurément développé met à mal toute expérience psycho-somatique. Elle nous invite finalement à la prudence dans la levée du clivage, en ce qu’elle est susceptible de dégager comme destructivité délétère.
Marilyn Corcos propose pour finir un texte qui donne la part belle au sensible. Elle reprend la théorie épistémologique de Bion sur les liens entre un fonctionnement intelligent et un fonctionnement sensible, en faisant l’éloge d’une pensée rêvante. Le thérapeute « sans mémoire, ni désir » favorise un travail de transformation à partir de ses perceptions, en captant l’effet sur lui de la rencontre avec le patient. La pensée rêvante en analyse favorise une liberté d’idéation qui enrichit toute forme de pensée. Dans ce mouvement, l’imagination tout comme la pensée analogique, supports de l’association libre court-circuitent la hiérarchie et les catégories, créant ainsi de nouvelles voies fécondes. En parallèle, la capacité négative que permet le doute, tout comme l’attente et la possibilité de supporter la frustration sont essentielles. L’expérience analytique serait une manière d’apprendre la patience et de faire fructifier l’incertitude, aptitude nécessaire à une cognition opérante, qui apprend de ses erreurs et de ses manques. À son rythme, le patient acquiert, par identification à l’analyste, le pouvoir de transformation de la fonction alpha. Le travail d’élaboration des contenus psychiques apporte assurément une meilleure symbolisation et un accroissement des compétences cognitives.
Dans la postface du livre, Laurent Danon-Boileau conclut ce parcours en retrouvant la voie de la question posée par le titre : de quoi parle-t-on quand on parle d’intelligence ? Il en recherche les butées en reprenant quelques enseignements des différents articles ici rassemblés. Il circonscrit l’accueil de l’inconnu qui permet de traiter l’imprévu sans le renvoyer à du déjà connu, Il s’agit d’une capacité à se déprendre de ce que l’on sait pour produire du nouveau.
Il reprend la problématique de l’intrication : quand il existe un trouble, l’important est de parvenir à l’identifier et à le circonscrire sans y rapporter toute la vie psychique de l’enfant. Pour autant, il réaffirme que l’intelligence demeure un processus à envisager dans son rapport à la pulsion et au cadre psychique dans lequel il prend place.
Il apporte aussi quelques distinctions éclairantes entre l’intelligence et la sublimation. À la différence de la sublimation, l’intelligence est une exigence à laquelle il faut se plier, elle fonctionne adossée à un masochisme de bonne qualité et nécessite une capacité à investir la passivité. Elle exacerbe l’intensité pulsionnelle faute de refoulement, au grand dam des surdoués. Il conclut sur l’importance de l’intelligence de l’adulte qui intervient auprès de l’enfant et du partage entre collègues. Il met ainsi en lien l’intelligence avec la transmission et l’identification ; quand on écoute quelque chose qui nous rend intelligent, cela à la fois renverse une problématique convenue et donne à l’autre le sentiment qu’il peut poursuivre la réflexion seul. Cela permet l’émergence de pensées incidentes, sur un fond de doute et de sensibilité à ce qui échappe toujours.
On retiendra à l’issue de ce parcours comme noyau commun pour penser l’intelligence, mis en exergue par chacun des auteurs, sa corrélation très étroite avec l’affectivité qui la nourrit et/ou la contrarie, son ancrage éminemment corporel. La richesse créative à l’œuvre dans l’élaboration de cette monographie est éclairante, recoupant par là même son propos, parce qu’elle a le pouvoir de donner des nouvelles à notre propre capacité à penser. Est-ce un hasard si les mots d’André Breton sur l’amour me viennent au moment de conclure, pour évoquer les apports du livre pour penser l’intelligence : « l’amour c’est rencontrer quelqu’un qui vous donne des nouvelles de vous » ? Le parallèle est convoqué par la nécessité de rappeler que le concours de la tendresse, du contact physique, intime et psychique, entre la mère et son bébé, sont primordiaux pour son développement et que ses besoins ne pourraient être nullement satisfaits s’ils n’étaient pas amarrés à la singularité du fonctionnement psychique d’un autre. Ce processus se poursuit toute la vie durant. L’Intelligence Artificielle dans ses usages fourvoyés ne saurait venir se substituer aux atouts propres au corps et à l’intersubjectivité. L’attrait vers l’affect vient probablement contrebalancer le poids de l’intelligence fascinante qui cherche sans cesse à surpasser les limites humaines, au prix de clivages radicaux et coûteux. Il semble que les auteurs de la monographie aient été portés par cette inclination. Ainsi, plusieurs idées prennent de la place au fil des pages, des atouts « en creux » qui font l’éloge du sensible, la capacité à accueillir du nouveau, l’appui sur un masochisme de bon aloi, la possibilité de douter, l’aptitude à tolérer la passivité et aussi la dimension « relationnelle » de l’intelligence qui s’inscrit dans un partage, et dans la transmission de ce qui rassemble et lie.
Pour finir, une autre question se pose, comme un défi sans cesse à relever, celle de réussir à penser ensemble, à plus grande échelle, quand les enjeux inhérents au groupe et la force des affects qui accompagnent les motions pulsionnelles engagées viennent immanquablement contrarier l’élaboration d’une pensée collective intelligente.
L’intelligence en question, Monographie du Centre Alfred Binet. Sous la direction de Sarah Bydlowski, Pierre Denis et Mathieu Petit-Garnier. Editions In Press, 2024