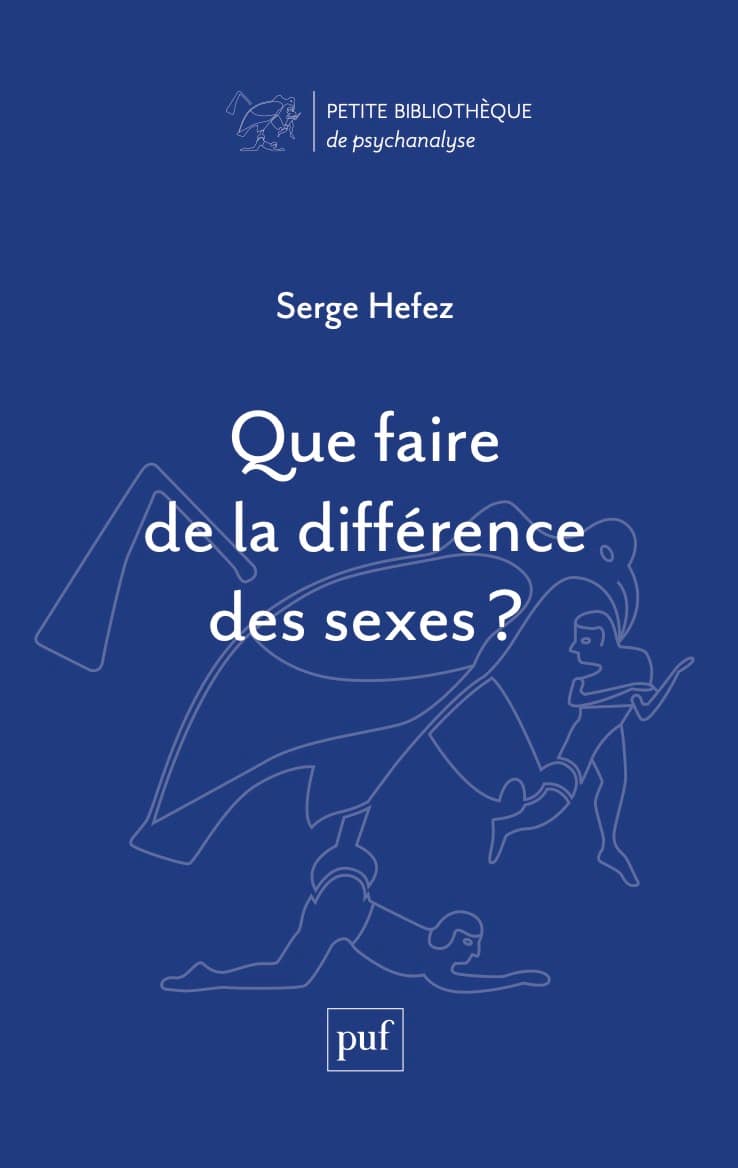Le dernier ouvrage de la Petite bibliothèque de psychanalyse, Que faire de la différence des sexes ? s’organise autour d’un texte inédit de Serge Hefez et d’un entretien qui abordent le sujet forts d’une longue pratique de l’accompagnement des personnes en questionnement identitaire et, pour certaines, en transition. Quand la non-binarité se refuse au choix d’un sexe pour l’autre, il convient là de distinguer d’emblée la transidentité, qui a trait au genre et s’étaye essentiellement sur la modification des caractères sexuels secondaires visibles : seins, pilosité, style vestimentaire, prénom, référencement grammatical, de la transsexualité, qui implique l’intervention chirurgicale sur les organes génitaux. Ces deux « passages » — d’un genre à l’autre, d’un sexe à l’autre — s’ils ne sont pas systématiquement concomitants pour une personne, voire ne le seront jamais, se réfèrent toujours à la différence des sexes, dont la perception contemporaine est précisément, ici, questionnée. Par ailleurs, bien que reposant sur une perception endogène, il est impossible, comme l’indique Hefez, de circonscrire ce questionnement identitaire à la seule dimension narcissique du sujet, tant ce questionnement est pris, comme pour chacun, dans les identifications et la relation à l’autre, que ce soit sur le versant du désir sexuel, de la rencontre amoureuse et évidemment, pour certains, de la rencontre transférentielle. Rarement présentée en première intention, cette dimension objectale n’en demeure donc pas moins présente, voire résolutive dans certains cas. C’est de la multiplicité de ces nouvelles identités sexuelles, des choix amoureux et des nouveaux usages de la sexualité qui en résultent que naît ce trouble relevé par tous, et qui oblige aussi le lecteur moins familier de cette clinique, à un va-et-vient entre les corps et leurs prénoms, les représentations et les fantasmes. Ceci est repérable à la difficulté de nommer la réalité de la chose, tel « vagindomme », qui donne à l’article d’Hefez son titre, néologisme qui surgit par surprise du côté de l’analyste dans le cours d’une cure, et qui condense, à la manière des trouvailles de l’inconscient, l’essentiel des effets contre-transférentiels face à la matérialisation dans les corps de fantasmes infantiles. Car si un vagin d’homme relève d’une naturelle impossibilité anatomique, le mot donne à voir (et le regard est de première importance dans cette clinique) une réalité longtemps cantonnée au fantasme. Le mot dit la conflictualité du sexe naturel et du genre autant qu’il oblige à quitter les identités normées. Les patients, souvent jeunes, sont des hommes trans, ils aiment des hommes ou des femmes, trans ou pas ; ce sont des femmes trans opérées ou pas, en couple avec des hommes cis ou trans, ouvrant la possibilité d’un homme enceint, c’est une jeune fille homosexuelle transitant en garçon gay, où genre et orientation sexuelle changent en même temps… On mesure combien la langue touche à ses limites pour nommer ces nouvelles identités et leurs variations relationnelles, à l’image de Thibault, homme gay amoureux d’un homme trans non opéré, qui s’écrie joyeusement : « Qu’est-ce que je suis maintenant, hétéro, bi, gay, pan ou juste complètement tordu… ?! » Les identités cloisonnées ne tiennent plus.
Mais une fois posée cette réalité de la clinique, quels cheminements pour Thibault, Noah, Djamila, Axelle, Léo, Orphée, Isaac, Natasha, Maelle, Emma, Alexandro, Andréa, Marion, et pour leurs analystes ? L’introduction de Régis Bongrand, « Le destin c’est le fantasme », attrape d’emblée l’un des enjeux du recueil, dans le pas de côté auquel il invite par rapport à la célèbre formule freudienne qui pose, elle, l’anatomie comme destin. L’article introductif déplie ainsi, sur les registres de la théorie freudienne et de la pratique clinique, les deux grands axes qui traversent l’ouvrage : le premier, que c’est bien le traitement psychique de la différence des sexes, donc l’infinie variété fantasmatique pour chaque sujet, qui, plus que l’anatomie, fait destin ; le second, qu’il existe dans l’écoute de la clinique trans, une mobilisation particulière du sexuel infantile de l’analyste, et donc de son contre-transfert, massivement mobilisé par le prisme de la réalité matérielle. Le texte de S. Hefez « Vagindomme » propose ensuite une réflexion en quatre temps dont chaque analyste invité à dialoguer avec lui proposera une variation. (1) Du genre au sexe, questionne du côté des patients et du côté des représentations de l’analyste ces deux modalités de la différence des sexes longtemps tenue pour naturellement harmonieuses et que la force perturbatrice et la puissance émancipatrice des corps trans mettent à mal, obligeant « l’analyste troublé dans le contre-transfert à revisiter ses a priori personnels et théoriques », aspect du travail que développe avec beaucoup d’acuité l’article de K. Fejtö « Peut-on se “défaire” de la différence des sexes ». (2) Sexualités, déploie autour de la cure de Thibault et de la surprise du vagindomme la créativité des nouvelles incarnations de la différence des sexes et les pratiques sexuelles auxquelles elles donnent accès, dans leurs rapports avec le fantasme et la réalité, à quoi l’article de C. Thompson « Couvrez ce sein que je ne saurais voir » offre un prolongement en interrogeant un primat des seins qui ouvre au questionnement du corps féminin dans une clinique trans élargie au cinéma. (3) Déconstructions, propose une série de portraits cliniques, incarnations ce « cette dénaturalisation de la sexualité et de la sexuation initiée par Freud dans les Trois essais », avec laquelle Hefez invite les psychanalystes à penser ces rencontres. (4) L’usage des plaisirs enfin, emprunte à Foucault l’exploration de l’érotique et, ici, du pouvoir transformateur du désir et de la relation affective, en appui sur le régime discursif introduit par ces nouvelles chorégraphies érotiques. « Le jeu de l’amour, du sexe et du hasard », de F. Caraman, prolonge par un nouage étroit entre clinique, théorie et littérature, la question de la guérison par l’amour suggérée par Hefez, et les modalités de ces amours contemporaines qui s’idéalisent dans l’authenticité, la véracité et le consentement réciproque. Un article de l’écrivain P. Zoberman, clôt l’ouvrage par l’étude d’une nouvelle de la fin du XVIIe qui déploie avec force le lien indéfectible entre la parole, le sexe et le genre.
Un ouvrage précieux quand les théories sexuelles infantiles de l’analyste, ressurgissant du dehors par la possible transformation du patient, se voient ainsi mobilisées, imposant une attention particulière au contre-transfert pour se défaire du risque d’une fascination à ce que les fantasmes deviennent vraiment réalité. On y voit là la clé d’une écoute résolument arrimée à la réalité psychique.
Serge Hefez, Que faire de la différence des sexes, Petite Bibliothèque de Psychanalyse, PUF, 2025 (avec Régis Bongrand, Francine Caraman, Kalyane Fejtö, Caroline Thompson, Pierre Zoberman)