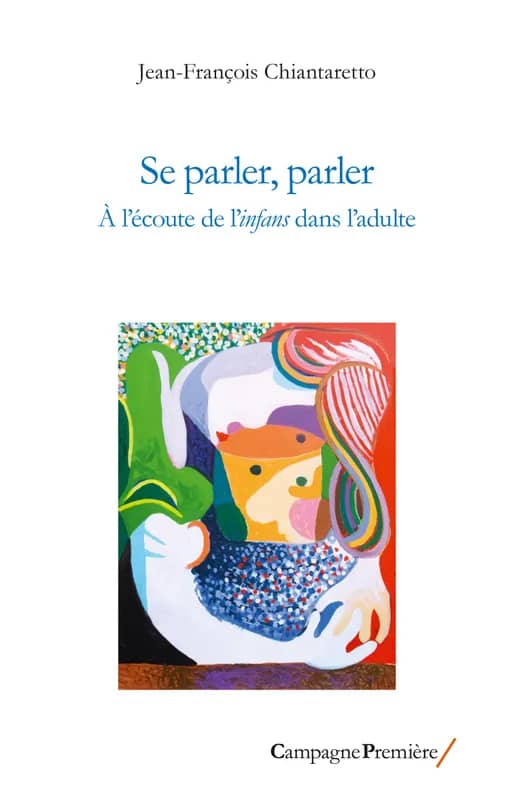Avec une acuité et une finesse d’analyse toujours aussi subtiles et exigeantes, où l’on reconnaît bien la plume de Jean-François Chiantaretto, ce que cet ouvrage propose de traiter, porte essentiellement sur « le penser de l’analyste en séance ». Comment l’analyste s’écoute, se parle, s’interroge, comment l’analyste « se tient-il compagnie » dans les différents moments de la séance ? En quelles circonstances se trouve-t-il en difficulté avec la compagnie de lui-même et que viennent traduire ces difficultés contre-transférentielles ? Comment ou de quelle manière, l’activité psychique inconsciente du patient vient-elle impacter intellectuellement et affectivement les associations de l’analyste ? Pour être en mesure de se « tenir compagnie » sereinement dans le temps des séances, l’analyste aura dû accomplir un travail personnel portant à son acmé l’aptitude à l’absentification ou à la capacité d’être seul en présence de l’autre. « Penser suppose de supporter d’être seul pour se « tenir compagnie », mais dans l’à‑venir du face-à-face, du un-à-un de la parole. » (Chiantaretto, 2025, p. 102) En d’autres termes et pour se ressaisir d’une notion formalisée et conceptualisée par Jean-François Chiantaretto lui-même, ce processus met en jeu la mobilisation de l’interlocution interne de l’analyste. Celle-ci est définie en tant qu’expérience qui « mobilise la dimension intime de l’être, du silence croyant d’avant les mots que les mots ont à garder pour advenir dans la parole, comme organe relationnel : pour échapper au désastre de la communication. » (Chiantaretto, 2025, p. 16) L’interlocution interne suppose l’intériorisation préalable chez l’infansd’une présence psychique suffisamment parlante (interprétante) de la psyché maternelle – et de l’autre dans et pour la psyché maternelle. Cette expérience intérieure de soi dans les mots rend ainsi manifeste le « pluriel de la composition des êtres – identificatoire et relationnelle, narcissique et sexuelle » (Chiantaretto, 2020, p. 14). L’interlocution interne, c’est aussi « un aspect central du penser de l’analyste en séance : l’activité silencieuse – ni volontaire, ni intentionnelle – de mise en mots de ce qui échappe aux mots. Soit une matière inconsciente hybride, mixant les affects contre-transférentiels et les transferts de l’analyste (sur la psychanalyse, sur les analysants). Est ainsi actualisé chez l’analyste ce qui reste affectivement agissant de ses propres passés transférentiels d’analysant et plus largement, des influences et/ou des liens identifiants procédant de toutes ses « rencontres analytiques » – c’est-à-dire toutes les rencontres « rendant moins difficile de trouver seul sa manière propre d’être analyste, pendant les séances, et d’écrire dans la fidélité et l’infidélité aux séances après » (Chiantaretto, 2020, p. 241). Dans la situation analytique, l’interlocution interne de l’analyste fonctionne comme une « écriture potentielle » (Chiantaretto, 2011), qui vient activer la fonction tiercéisante du penser – d’un penser se substituant à l’événement de la rencontre indirecte de deux scènes intérieures irrémédiablement étrangères.
Interlocution interne et tiercéïté en quête d’incarnation
Les liens entre interlocution interne et éléments contre-transférentiels sont donc très prégnants. Se trouve ainsi interrogées la ou les définition(s) et conception(s) que l’on propose du contre-transfert, comme l’usage que l’on peut en faire au cœur du processus analytique. C’est à ce titre que les développements de Ferenczi sont convoqués par l’auteur puisqu’il est convenu aujourd’hui, sur un mode presque consensuel, de considérer Ferenczi comme le premier théoricien du contre-transfert. « Là où Freud en reste à une exigence de maîtrise auto-analytique du contre-transfert, Ferenczi fera de son élaboration, non seulement une condition de l’analyse, mais la source et le fondement de la métapsychologie. » (Chiantaretto, 2025, p. 52) Est-ce que Freud se sera cantonné dans la seule maitrise des éléments contre-transférentiels ? Le jugement nous paraît un peu sévère, même si l’on peut avancer à juste titre que Ferenczi aura été le premier à penser « la transformation du fonctionnement psychique du psychanalyste par les associations énoncées ou latentes du patient », tout en s’ouvrant, par le biais de son propre travail associatif, « à ce que le patient ne perçoit pas de lui-même via les mots » (Chiantaretto, 2025, p. 71) Le propos de Chiantaretto s’inscrit ici clairement dans la lignée des thèses de Granoff, lequel énonçait, là encore de façon quelque peu discutable, « si Freud a inventé la psychanalyse, Ferenczi a fait de la psychanalyse » (1961, p. 85), ce qui laisse déceler une réelle tendresse et une profonde amitié de pensée et pour la pensée clinique de Ferenczi.
Avec Ferenczi, comme ce fut le cas avec Fliess, Breuer, puis avec Jung, Freud cherchait « la promesse d’une possible incarnation de l’interlocution interne » (Chiantaretto, 2025, p. 36) Aussi, au fur et à mesure, qu’il rompra les liens avec chacun d’eux, Freud perdra, non pas l’étayage procuré par la présence sécurisante de doubles narcissiques, mais à chaque fois et douloureusement des garants de sa propre interlocution interne. Ces pertes successives ayant pour effet de défléchir sur l’écriture le penser freudien, comme s’il n’y avait plus alors de différences substantielles entre penser et écrire, Freud inventant la psychanalyse en l’écrivant. Ainsi, à défaut de pouvoir se jouer dans une relation analytique et transférentielle, eu égard aux achoppements de celle-ci, « entre Ferenczi et Freud, tout tendra à se déplacer du côté de l’affectation auto-analytique de l’écriture – de l’écriture comme lieu de transformation de l’attente transférentielle. » (Chiantaretto, 2025, p. 55). Toutefois, au-delà de ces enjeux analytiques et interpersonnels, on peut se demander si ce n’est-ce pas là une façon d’avancer l’hypothèse que l’écriture, plus que la parole, aura été pour l’un comme pour l’autre, une modalité d’accès plus aisé à l’infans, à l’inquiétante-étrangeté, à « l’hantologie » (Derrida, 1993, p. 31) qui comme le précise Derrida, précède l’accès à l’ontologie, c’est-à-dire précède l’avènement de l’être parlant ?
Crispations transférentielles et contre-transférentielles
Pour autant et même si l’écriture représenta pour Freud « le lieu électif du dédoublement de la subjectivité » et la mise à l’épreuve de l’étranger en soi, il n’en demeure pas moins que les rencontres au fil du temps avec ces différents interlocuteurs externes ont pu permettre que l’auto-analyse freudienne s’extirpe d’une certaine gangue et d’un auto-enfermement aliénant faisant fi de l’épreuve de l’étranger en soi. Ainsi, certaines réorientations de la théorisation freudienne ou du penser freudien n’auront pas été sans lien avec l’influence du dialogue qu’il a pu entretenir avec l’enfant terrible de la psychanalyse, entamé dès 1908. Aussi, au-delà de l’incitation très claire à nous laisser à penser que les lectures croisées des textes freudiens et ferencziens sont incontournables pour accéder à une réelle approche analytique, Chiantaretto met à jour la forme psychanalytique de cette amitié de pensée, qui repose sur « la puissance amicale du penser comme dialogue intérieur impliquant le dialogue avec l’autre et les autres. » (Chiantaretto, 2025, p. 43) Privilégier la philia fait écho au souhait ferenczien d’atténuer l’aspect trop verticalisé de l’approche analytique freudienne. Certains pages de son Journal, particulièrement acerbes sur ce plan, n’hésitent pas à dénoncer chez Freud « une crispation théorique exagérée pour se protéger contre son auto-analyse » (Ferenczi, 1932, p. 147) et une méthode thérapeutique devenant de plus en plus impersonnelle (flotter comme une divinité au-dessus du pauvre patient, ravalé au rang d’enfant). « Chez Freud cela correspond sans doute à la découverte que les hystériques mentent. Depuis cette découverte, Freud n’aime plus les malades. Il est retourné à l’amour de son Surmoi ordonné, cultivé (une autre preuve en est son antipathie et ses termes injurieux à l’encontre des psychotiques, des pervers, et en général contre tout ce qui est « par trop anormal », ainsi que contre la mythologie hindoue. » (Ferenczi, 1932, p. 148) Se voulant à l’opposé de cette posture freudienne, il incitera à se défier d’un recours trop pesant à la technique – dénonçant l’hypocrisie professionnelle trop fréquente des cliniciens – et à se montrer sans fard, comme on le demande au patient, allant jusqu’à considérer que « seule la sympathie guérit » (Ferenczi, 1932, p. 271) !
Était-ce là, de la part de Ferenczi, l’expression d’un transfert « traversé par une haine envieuse vis-à-vis du psychanalyste premier, seul à même de mettre en acte un fantasme d’auto-engendrement : fondateur et seul garant des origines d’une œuvre sortie de son psychisme. Ce transfert envieux ne peut avoir qu’un seul destinataire, Freud, qui ne peut que s’y refuser. » (Chiantaretto, 2025, p. 56). Freud n’ayant jamais donné accès au souhait ferenczien d’une sorte d’analyse mutuelle, où ce dernier aurait été tout à la fois l’analysant et l’analyste du père de la psychanalyse. Si tout analysant est à un moment ou à un autre, amené à fantasmer d’occuper la place de l’analyste de son analyste, Ferenczi n’aura jamais pu « renoncer à être et l’un et l’autre, sauf à se perdre en perdant l’espoir d’amener Freud à être présent pour affronter et rendre élaborable le transfert sur lui d’une mère meurtrière. » (Chiantaretto, 2025, p. 53). Si du côté de Freud les réticences et résistances reconnues à occuper une position transférentielle maternelle peuvent rendre compréhensible cette hostilité et cette agressivité de Ferenczi à l’égard de Freud, on peut aussi subodorer que l’analyse et l’élaboration, ne seraient-ce que partielles, des éléments contre-transférentiels de la part de Freud, ont pu renforcer chez lui l’idée qu’il n’était pas envisageable de céder aux exigences et à une certaine toute-puissance[1] ferenczienne, sans que celles-ci ne les entraînent dans une spirale destructrice. Et cela même si les limites de l’auto-analyse freudienne pouvaient rendre légitimes les velléités ferencziennes, confronté qu’il était à un analyste « réputé incapable d’accueillir et d’aider à accueillir l’infans chez l’analysant Ferenczi – un Ferenczi de ce fait condamné transférentiellement à s’identifier à l’infans hiflos (sans-aide) que Freud ne sait pas entendre, avec pour seule issue de donner à cet infans, sinon la parole, du moins une écoute : à savoir sa théorie de l’infans dans l’adulte » (Chiantaretto, 2025, p. 72). Faute d’un travail analytique suffisant pour les deux protagonistes, une dimension rivalitaire semble s’être déplacée dans le champ métapsychologique et clinique. L’un s’accrochant à la défense de l’infantile, là où l’autre s’accrochait à l’infans et à sa situation de désaide fondamentale requérant la présence d’un Nebenmensch. Et cela, au prix d’occulter chacun la présence d’un de ces pans du psychisme.
L’infans, l’infantile, l’enfant…
Ferenczi aura été celui qui a su le mieux entendre la plainte de l’infans dans l’adulte. Or, c’est bien cette disposition et cette faculté singulières qui confèrent aujourd’hui à l’œuvre de Ferenczi une actualité et une modernité assez remarquable. Plus qu’hier, il paraît impérieux de nos jours d’être en mesure de développer cette attention pour l’infans dans l’adulte, c’est-à-dire être à l’écoute de ces états sans aide (hiflos) et sans mots de l’infans réactualisés dans le lien transférentiel, quitte à occulter l’infantile. C’est un risque d’ailleurs auquel Ferenczi aura pu être exposé, à savoir une propension à se focaliser sur l’infans, au point de négliger le rôle joué par l’infantile. On en trouve des traces dans son Journal où certaines notes envisagent même une remise en cause de la notion d’infantile. Par exemple, avec la note suivante : « L’idée du déplacement du haut vers le bas et l’accumulation de toute la libido dans les organes génitaux est-elle donc fausse ? Et comment se constitue alors la génitalité ? Qu’en est-il de la théorie du « réservoir » ?
Nouvel essai : la génitalité se constitue loco proprio [en son lieu propre] comme une tendance spécifique toute prête des organes à fonctionner (mécanisme sensori-moteur). Avant le développement de ce mécanisme, l’enfant n’a pas de sexualité. Retour à la conception généralement admise : il n’y a pas de sexualité infantile extragénitale, mais il y a bien une génitalité précoce, dont la répression suscite comme symptômes hystériques
- Suçoter ?
- Jeux anaux
- Jeux urétraux
- Sado-masochisme
- Exhibitionnisme-voyeurisme
- Homosexualité.
L’« organisation orale » est déjà secondaire.
L’« organisation sadique-anale » l’est aussi.
Suçoter : à l’origine, n’a rien à voir avec la sexualité – seulement après la répression de l’onanisme qui commence très tôt. Le complexe d’Œdipe n’est-il pas une conséquence de l’activité des adultes – la tendance passionnelle ? Donc, pas de fixation par le plaisir. Mais fixation par la peur : Homme et femme vont me tuer si je ne l’aime pas. (si je ne m’identifie pas à ses désirs). » (Ferenczi, 1932, p. 241)
Une telle récusation de l’existence de l’infantile – envisagé comme un processus secondaire apparaît ainsi gênante et problématique puisqu’elle tend à occulter ou à blanchir toute la perversité polymorphe infantile. Aussi, convient-il, contrairement à ce qui se dessine parfois dans l’optique ferenczienne, que cette mise en avant de l’infans ne s’opère pas au détriment d’une prise en compte de l’infantile et de la vie fantasmatique. Tout comme la cristallisation de l’élaboration sur l’infantile ne doit pas être un motif d’occultation ou de scotomisation du rôle et des implications de ce qui s’est joué lors de l’infans. L’apport ferenczien enrichit le sexuel infantile freudien, en octroyant une place significative à l’infans, c’est-à-dire à ce qui ne peut se dire et qui est en souffrance chez le sujet.
Tact empathique
En redéfinissant et en réélaborant la notion d’empathie (à partir des thèses d’auteurs comme Theodor Lipps, Adams Smith, Sandor Ferenczi, Laurence Kahn, Jacques Hochmann ou Daniel Widlöcher), Chiantaretto rétablit toutefois une dimension plus contrastée et plus ajustée de cette notion, en précisant que contrairement à la sympathie, l’empathie « peut faire place à l’ambivalence, à la haine et à la conflictualité. » (Chiantaretto, 2025, p. 69) De fait, l’usage très en vogue de nos jours de la notion d’empathie, prête le flanc à des approches cliniques où le « sentir avec » semble autoriser toutes les dérives et confusions possibles. Or, le tact empathique ne vise donc pas à sentir comme ou pour le patient, en personne, mais recherche avant tout un accordage suffisant avec le fonctionnement psychique du patient. De fait, « l’empathie n’est pas de l’ordre d’une conviction partagée avec le patient. Si l’empathie est bien à distinguer d’une identification inconsciente au patient comme personne, elle repose sur des moments d’identification, partiels et transitoires. Ces moments d’identification – non pas à l’analysant comme personne totale, mais à un élément de son fonctionnement psychique (pensée ou fantasme) – permettent d’imaginer le contexte associatif du patient et par là, le rapport qu’il entretient à ce qui se passe en lui : à travers ce qu’il (se) dit ou évité de (se) dire. De ce point de vue, si l’empathie ne se confond pas avec l’intuition, elle la permettrait et rendrait ainsi possible le tact, c’est-à-dire ce qui permet de juger du moment opportun, de la modalité et du registre de l’interprétation. » (Chiantaretto, 2025, p. 75) Cette façon d’appréhender l’empathie est ici très précieuse pour penser les modalités qui entrainent un risque de sur-identification au patient de la part de l’analyste, à partir d’une identification totale, s’inscrivant dans le registre des identifications narcissiques, lesquelles identifications massives entraînent ce risque de collusion et de confusion narcissique. L’analyse se fourvoyant alors « dans un collage avec la demande narcissique de reconnaissance spéculaire du patient (dis-moi qui je suis), laquelle peut donner lieu à des « erreurs d’empathie », ce que Widlöcher nomme « néguempathie » – voire un délire à deux (…) » (Chiantaretto, 2025, p. 80). S’il faut se prêter au jeu des identifications croisées, Winnicott encourageant même la sélection des postulants à la place d’analyste à partir de leur faculté à se prêter aux identifications croisées, encore faut-il que celles-ci restent modulées et partielles pour éviter que la charge contre-transférentielle ne devienne pas insurmontable et responsable, après des moments d’élation fusionnelle partagés par l’analyste et l’analysant, du surgissement d’une haine contre-transférentielle non contrôlée et non contrôlable. Ce type de réactions contre-transférentielles et de processus se trouvent encore accentués par la clinique des pathologies limites ou des pathologies du Négatif qui se caractérisent par « l’adhésion à l’illusion, là où le sujet n’a pu se constituer qu’à se trouver chez l’autre en se perdant. » (Chiantaretto, 2025, p. 84). Pour survivre à cette perte, le sujet cherchera alors à déployer « une emprise indifférenciante sur soi et l’autre » (Chiantaretto, 2025, p. 84), ce lien d’emprise étant l’expression d’une haine narcissique, laquelle occupe alors une fonction vitale.
L’intime et son altération
Chiantaretto s’attache donc au malaise de l’infans dans l’adulte, au malaise de sujets en proie à « une incorporation de l’autre primordial à lui-même – une incorporation du disparu, de l’autre comme ayant disparu avant même qu’il soit représentable : donc en deçà de toute absence. » (Chiantaretto, 2025, p. 80). Cette présence extérieure vidée d’elle-même restant littéralement accrochée à l’infans et empoisonnant toute son expérience. Si, à la suite de ce défaut d’introjection[2]laissant la place à l’incorporation d’une présence vidée de sa substance, les capacités du sujet à construire l’absence ou la capacité d’être seul en présence de l’autre ou encore la capacité à se tenir compagnie à soi-même, s’en trouvent fortement troublées et mises à mal, cette disparition anticipée de l’autre primordial – avant même qu’il ait pu être représenté – condamne également ou entame fortement l’expérience de l’intime. Or, l’intime doit être distingué de l’intériorité et même de l’intimité puisqu’il « ne renvoie pas à une réalité intérieure limitée à l’individu. C’est une expérience relationnelle sans objet, interrogeant ce qui se situe dans l’entre-deux de soi et de l’autre, du corps et de la psyché ; et qui vient comme de l’extérieur transformer un sujet. » (Chiantaretto, 2025, p. 94) L’intime n’est donc pas véritablement localisable, sauf à le situer comme « expérience de l’Entre ; entre soi et l’autre – l’autre, c’est-à-dire les autres en soi (les identifications), les autres en relation (autrui), les groupes d’appartenance (les liens identifiants) » (Chiantaretto, 2025, p. 91).
L’ère culturelle dans laquelle nous vivons pourfendrait ainsi cette expérience de l’intime au profit d’une « privatisation de l’intime », c’est-à-dire d’une propension à favoriser la consommation/consumation des individus dans l’exhibition de leur « intimité » ou de leur « vie privée ».
Aussi, pour rendre compte des difficultés dans nos sociétés contemporaines à construire le narcissisme primaire se trouve ainsi mise en avant cette altération profonde de l’intime. Celle-ci étant à l’origine de la médiocrité qualitative de l’accueil fait à l’infans[3]. Là où d’autres analystes invoquent à ce sujet la culture de la rapidité, du résultat, de la performance – lesquelles laissent « peu de temps aux bébés pour être des bébés (…) C’est-à-dire plus le temps suffisant de mettre en œuvre leurs mécanismes d’accès à l’intersubjectivité » (Golse, 2016, p. 398) –, Chiantaretto interroge davantage le rôle que nos sociétés contemporaines octroient à cette privatisation de l’intime et au culte de la transparence. De fait, au-delà de ces cultures de la rapidité, du résultat, de la performance qui imposent une autonomisation de plus en plus rapide de l’infans, comme un éloignement progressif mais rapide du corps du bébé et de celui de l’adulte, Chiantaretto émet, lui, l’hypothèse forte d’une désorientation de l’infans qui intervient lorsque celui-ci « a été contraint à percevoir trop tôt l’autre, du fait de son défaut de présence psychique. Une désorientation vouée à être éprouvée sans jamais être représentable, privant le sujet d’un usage relationnel suffisamment adapté de ses ressources fantasmatiques. » (Chiantaretto, 2025, p. 62). L’incitation à percevoir l’autre trop tôt, de façon précipitée, ne peut qu’avoir pour corolaire une difficulté majeure du côté de l’Autre à s’effacer narcissiquement pour être en mesure d’accueillir et d’être réceptif à ce qui émane de l’infans. Ces difficultés liées à la possibilité de proposer une disponibilité psychique suffisamment enveloppante pour l’infans ne seraient pas étrangère à ce que Chiantaretto désigne comme injonction de la transparence ou ce que Winnicott désignait comme « chercher à être vu ». Or, cette injonction de la transparence – que ce soit au plan individuel ou au plan collectif – qui règne dans nos sociétés contemporaines favorise ainsi « l’exhibition et la privatisation de l’intime tendant à effacer l’ambiguïté de la subjectivité, en réduisant le visible au vu. » (Chiantaretto, 2025, p. 99). Notre auteur dénonce ainsi le déni de l’appel au regard de l’autre primordial, susceptible de favoriser « l’intériorisation préalable chez l’infans d’une présence psychique suffisamment parlante – interprétante – et incarnée – dans le dialogue aimant/animant des corps : la présence de la psyché maternelle et des autres dans la psyché maternelle. » (Chiantaretto, 2025, p. 106).
À défaut de pouvoir installer une altérité interne, à défaut de vivre une expérience intime comme expérience d’un dialogue intérieur constitutif d’une capacité intérieure à se tenir compagnie et à être en compagnie d’autres sans se perdre, la fatigue d’être soi et une forme d’hyperlucidité s’imposent – Ferenczi parlait lui de sujets extralucides –, instaurant non plus un dialogue, mais une sorte de monologue intérieur sans adresse véritable – un discours difficilement entamable, prononcé par un être omniscient et une intelligence pure, coupée de tout éprouvé, mesurant froidement l’étendue des dommages subjectifs subits par l’infans. « (…) la lucidité n’étant ni le surmontement, ni l’accomplissement de la psyché, mais seulement la consolation que permet le travail du négatif devant la jouissance impossible. » (Green, 1993, p. 67).
Si se parler constitue un enjeu décisif, associant dans l’intimité du rapport à soi-même la singularité d’être et la confirmation avec les autres d’une place inaliénable dans le monde commun des semblables différents, « parler, se parler » suppose d’avoir été originellement parlé : transformé/interprété. Se parler, que la pensée parle avec elle-même (comme avec un ami) tout en faisant une place à l’altérité interne, engage donc ce qui a pu se jouer pour l’infans, étant entendu que celui-ci, comme le rappelle Pontalis (2007, p. 464), n’est pas à considérer comme un stade de développement mais comme un état de l’être. Un état d’être en attente de mots et tout autant de la chair des mots…
Se parler, parler. À l’écoute de l’infans dans l’adulte, Jean-François, Paris, Éditions Campagne Première, 2025
Bibliographie
Bokanovski T. (1995), Le couple « trauma-clivage » dans le « Journal clinique » de Ferenczi, Monographies de la RFP, Sandor Ferenczi, Paris, Puf, 1995.
Chiantaretto J.F. (2011), Trouver en soi la force d’exister. Clinique et écriture, Paris, Campagne Première, 2011.
Chiantaretto J.F. (2020), La perte de soi, Paris, Campagne Première, 2020.
Chiantaretto J.F. (2025), Se parler, parler, A l’écoute de l’infans dans l’adulte, Paris, Campagne Première, 2025.
Derrida J. (1993), Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993.
Ferenczi S. (1932), Journal clinique, Janvier-octobre 1932, Paris, Payot, 1985, p.241
Golse B. (2016), Plus de suicide en préadolescence ?, Adolescence, 2016, 34, 1, 384–403
Granoff W. (1961), « Ferenczi : faux problème ou vrai malentendu ? », in Lacan, Ferenczi et Freud, Paris, Gallimard, 2001.
Green A., Le travail du négatif, Paris, Minuit, 1993.
Pontalis J.B. (2007), D’une voix l’autre, in Le royaume intermédiaire, Paris, Gallimard, 2007.
[1] Comme le souligne Bokanowski, « en raison de son immense talent d’analyste, Sandor Ferenczi était devenu, dans les quinze dernières années de sa vie (1918–1933), celui à qui ses contemporains, Freud le premier, n’hésitaient pas à adresser les patients les plus difficiles. Ceux qu’il acceptait de prendre en charge, étaient ceux qui, aujourd’hui, seraient considérés comme non-névrotisés (états-limites), voire non-névrotisables (psychoses), et qui, pris dans de multiples tentatives d’analyse, s’acheminaient inéluctablement vers l’analyse interminable. » (1995, p.133) Aussi, peut-on, tout en soulignant l’audace et la témérité clinique novatrice dont il a pu faire preuve, se demander si ce positionnement auprès de patients qui ne développaient pas de véritables névroses de transfert, mais davantage une sorte de névrose narcissique inanalysable n’aura pas participer à une forme d’épuisement subjectif au regard des implications contre-transférentielles en jeu, cet épuisement étant sous-tendu par un transfert sur l’analyse trop idéalisé et les traits mégalomaniaques d’un Nebenmensch s’astreignant à épancher les souffrances psychiques ou les douleurs d’être de ses analysants.
[2] « Le processus introjectif primitif serait lié à l’éprouvé intérieur, dans l’investigation auto-érotique du corps propre, d’une présence étrangère) – d’une présence étrangère correspondant à l’action du plaisir/déplaisir éprouvé par l’autre dans la satisfaction des besoins de l’infans, en état de dépendance vitale. » (Chiantaretto, 2025, p. 83)
[3] « Si l’enfant s’éprouve non bienvenu, c’est qu’auparavant l’infans a été mal accueilli et contraint par là à incorporer ce mal-accueil, installant chez le sujet un infans blessé, destiné tout au long de sa vie, non pas tant à demander réparation qu’à se plaindre auprès d’autrui de sa défection comme autre secourable. » (Chiantaretto, 2025, p. 61).