Anne-Sophie Bourdaud est psychologue clinicienne et psychanalyste membre de la Société Psychanalytique de Paris, musicienne, ancienne élève pianiste à l’École Normale de Musique de Paris, autrice-compositrice-interprète.
Soit ce puits était très profond, soit Alice tombait très lentement, car elle eut tout le temps de regarder autour d’elle pendant sa chute et de se demander ce qui se passerait ensuite.
Lewis Carroll
Le musicien en surmenage
Il existe quelques discrets signes annonciateurs avant l’effondrement psychique du musicien surmené. Quelques troubles apparaissent ici et là mais ne semblent pas assez bruyants pour en permettre une pleine appréhension de la part du sujet.
Certaines douleurs peuvent être persistantes, un malaise diffus s’installer, voire des angoisses se développer. Mais au début de ces signes, rien de bien alarmant ni de très précis pour confirmer l’existence d’un problème. Est-ce peut-être parce que l’alerte n’est pas suffisamment donnée ou alors aisément perçue par le sujet que cet accident de parcours peut faire autant de dégâts somatopsychiques ?
L’omerta sur les douleurs qui se devine au cœur du monde de la musique participe pour beaucoup au temps perdu avant la prise de conscience du danger. C’est un univers où la technique doit s’effacer devant l’esthétisme absolu. Le corps vêtu de noir doit disparaître devant la grandeur des compositions jouées. La place est fragile et la concurrence mordante et sans pitié. Le monde de la musique recèle en son sein une loi du silence redoutable. La peur ou encore la honte maintiennent le musicien dans une posture périlleuse. Il se doit de garder secrets ses maux et en vient à les occulter pour ainsi rester en lice. Mais en risquant d’aller trop loin, c’est la barrière du déni qui se dresse alors avec son lot d’écueils. Souffrir ou ne pas être en état de fonctionner est généralement vécu comme une faiblesse ou la preuve d’une inefficacité dans son travail. La crédibilité du sujet musicien est en perpétuelle remise en question et demeure constamment fragilisée. Et son art dans son accomplissement le pousse sans cesse à devenir ce funambule mis au défi d’une chute imminente.
À ce silence ravageur et ce déni généralisé dans le monde de la musique, s’ajoute alors la déconnexion de sa communication avec soi-même. Est-ce que ce sont les sens qui se mettent à dysfonctionner ? Une perte des sensations corporelles en lien avec les douleurs ? Ou bien encore une mauvaise interprétation concernant les signaux venant de soi ?
Le lien ne semble plus s’établir entre ce que vit le corps du musicien dans l’exercice de ses fonctions et son psychisme. Une séparation s’opère entre ces deux mondes et le précipice entre eux ne fait que s’agrandir. « Se sentir réel, c’est plus qu’exister, c’est trouver un moyen d’exister soi-même, pour se relier aux objets en tant que soi-même et pour pouvoir avoir un soi où se réfugier afin de se détendre. » (D.W. Winnicott, 1971/1975, p.161). C’est pourquoi les détériorations autres que corporelles peuvent être incommensurables.
Le surmené ne s’entend plus, n’a plus accès aux différents signaux d’alerte qui sont censés œuvrer à la préservation de soi. Le contact semble s’être coupé. Le musicien avec ses douleurs et son épuisement partent en roue libre sur un chemin sinueux et dangereux. Dans cette descente vertigineuse, seul un stop violent et radical peut y mettre fin. Un arrêt somatopsychique brutal du musicien qui signera que l’effondrement a déjà eu lieu en amont. C’est seulement une fois que la rupture est devenue flagrante que la mesure de l’étendue des dommages peut commencer.
Les aléas du pulsionnel du sujet psychique sont alors en jeu ou plutôt dans un « hors je », qui suivent leurs propres desseins. Didier Anzieu a de façon très imagée montré leur immanence dans le processus artistique : « Avant de pouvoir être pensé, quelque chose en l’artiste pousse, souffre, crie, pue. Créer, c’est sans doute renaître, mais à partir de son urine et de ses excréments. » (Anzieu, 1996/2012, p34).
L’artiste a quelque peu l’habitude des bas-fonds de son âme d’où il tire ses forces pulsionnelles. Il ne recule pas devant l’écœurement, la dureté de la tâche à accomplir, l’insatisfaction constante et peut aller facilement jusqu’à la douleur. Après tout, elle n’est qu’un aléa de plus sur son parcours de musicien. Être prêt à tout donner jusqu’aux confins de lui-même semble parfois lui être un sacerdoce. Le milieu au sein duquel il évolue peut contribuer à la tendance à frayer avec les limites de soi. Intégrer un orchestre et tenter d’y garder sa place maintient le musicien dans un système organisé dont la violence peut lui échapper. Les injonctions de réussite et de performance sont telles que les mécanismes sous-jacents sont minimisés voire abolis.
Une étude brésilienne de psychologie sociale intitulée « Tous les musiciens ne sont pas calmes : du stress au burnout chez les musiciens d’un orchestre symphonique et les chanteurs de chorale » pointe une dialectique importante entre le mouvement du taylorisme et le musicien en état de stress. (Andrade et al. 2021).
Le stress, même s’il est un état intérieur est essentiel à mettre en perspective avec sa gestion en lien avec l’environnement étudiant ou professionnel du sujet musicien.
Le taylorisme est défini par le Trésor de la Langue Française informatisé comme une « méthode d’organisation scientifique du travail industriel visant à assurer une augmentation de la productivité fondée sur la maîtrise du processus de production, sur la séparation stricte entre travail manuel et travail intellectuel, sur une parcellisation des tâches et sur une standardisation des outils, des conditions et des méthodes de travail ; organisation du travail qui vise à accroître la productivité par la répartition du procès de travail en éléments partiels et chronométrés éliminant les mouvements improductifs. » Ce mouvement inventé par l’ingénieur américain Frédérick Winslow Taylor autour de 1880 a eu une grande influence lors de l’essor de l’industrialisation. Or l’organisation du monde de la musique n’échappe pas à ses rejetons ni à son influence.
« En abordant le thème de la gestion, il devient pertinent de commenter qu’il est impossible de parler de musique sans l’aligner sur les influences de Taylor et Ford, dès lors que le travail effectué par les musiciens d’un orchestre présente des caractéristiques des principes de gestion scientifique (…), qui finissent par assurer le succès dans la réalisation du travail des musiciens, générant comme produit final le travail immatériel plein de sentiments, de réactions, de perceptions, c’est-à-dire un contenu de vie inexprimable. » (Andrade et al., 2021, P13)
L’humain est ainsi aux prises avec son ère industrielle tel que Charlie Chaplin a su le mettre en lumière dans son film intitulé Les Temps Modernes en 1936.
Le rouleau compresseur de la productivité et de l’efficience ne peut pas laisser intacts les sujets qui y sont confrontés. L’efficacité exigée mais aussi l’interchangeabilité des instrumentistes créent une ambiance de stress auquel le musicien se trouve soumis.
Dans sa fosse non pas de lions, mais d’orchestre, le musicien est particulièrement exposé aux pressions de son environnement pour le but commun d’interpréter magistralement des œuvres musicales. La mobilisation des ressources est maximale pour un projet qui dépasse ses acteurs. « (…) la subjectivité du travail immatériel dans le domaine de la musique, est pleine d’émotions, d’affections et de sentiments, devant cela, suit la relation entre l’organisation rationnelle du travail de Taylor, le principe de la production de masse de Ford et le domaine de la musique. » (Andrade et al., 2021, p 28)
Les auteurs citent une étude de 2008 de Eduardo Davel et Sylvia Vergara pointant l’identification des individus avec les valeurs organisationnelles du travail qui, ne faisant plus qu’un avec elles, renoncent à leur vie personnelle pour pouvoir atteindre les objectifs prescrits. (Andrade et al., 2021, p31) L’effacement du sujet devant l’impériosité de ses exigences propres et externes en vient à le fragiliser dans ses bases profondes. À force de fonctionner avec efficience et comme une machine, le musicien ne se perçoit plus comme un sujet souffrant et désirant. Il y a une érosion de sa personnalité, une détresse du moi, voire son annihilation. La clinique du surmenage chez le musicien rend compte de régressions archaïques tant au niveau de l’expression des besoins vitaux (un sommeil inextinguible, des troubles alimentaires…) que de la recherche du « care » winnicottien. « Grâce aux « soins qu’il reçoit de sa mère », chaque enfant est en mesure d’avoir une existence personnelle et commence donc à édifier ce qu’on pourrait appeler le sentiment d’une continuité d’être ». (Winnicott, 958/1969, p.377)
Le sujet est dans une quête avide de réassurance et de protection de la part de ses proches qui peuvent être mis en difficulté pour pouvoir bien y répondre. Les besoins sont impérieux, à la mesure de la lointaine régression libidinale provoquée. On lui reproche de ne plus se ressembler, d’être devenu difficile à cerner et à supporter. Il ne semble plus aussi investi et motivé. La fuite qui peut être générée par le surmenage peut passer pour un désintérêt croissant. Ainsi l’étudiant n’assiste plus à ses cours jusque-là suivis avec assiduité, le musicien professionnel s’absente de plus en plus souvent.
Une forme d’indifférence et de rejet vont prendre le pas et s’étendre sur ce qui était jusque-là l’acmé de son existence : faire de la musique.
Plus loin que la vie privée, le détachement apparent du sujet peut aller jusqu’à affecter sa santé et la perception de son propre corps. Sans cesse mis au défi de se surpasser, le corps devient un outil dont on ne mesure plus l’usure ni la fragilité. La douleur est présente mais perçue comme une étrangère avec qui l’on ne sait plus traiter. Elle se développe et demeure secrète jusqu’à ce que les remparts érigés pour tenir se fissurent. Revenu à lui-même, le musicien meurtri est face à une douleur devenue insupportable qui va déborder le moi. Il devient alors très difficile de faire agir son corps ne serait-ce que pour des activités basiques comme se lever, manger ou réaliser une tâche. Maintenant ce corps est devenu un obstacle aux projets, une partie perdue de soi.
Chaque instrumentiste a son propre talon d’Achille et des zones corporelles qui sont particulièrement exposées au surmenage. Le livre de la kinésithérapeute Coralie Cousin, spécialiste des douleurs chez les musiciens, décrit bien les spécificités de chaque instrumentiste dans ses fragilités. (Coralie Cousin, 2012)
En ce qui concerne l’orchestre à corde, « il est demandé au musicien un effort physique et mental adéquat pour assurer le succès dans l’exécution des œuvres, étant donc plus particulièrement sur la section des cordes, exige que le musicien frotte les cordes avec des mouvements répétitifs, (…) favorisant grandement un excès de tension pendant les présentations, puisque les violons, altos sont soutenus sur l’épaule gauche (…) corroborent pour la tension et les différents efforts musculaires ». (Andrade et al., 2021, P37)
Les instruments à vent quant à eux vont davantage solliciter des zones physiques impliquées dans le contrôle de la pression de l’air et de la respiration.
Les auteurs concluent que « pour jouer de ces instruments, les muscles du visage, du cou et des membres supérieurs sont sollicités, ce qui provoque des douleurs et des gênes dans le dos après de longues prestations musicales ». (Andrade et al., 2021, p37)
Le risque qui est encouru par le musicien lors de trop fortes sollicitations et la pression continue devient l’épuisement physique et psychique. Le corps se fatigue mais également la volonté de poursuivre ses efforts.
Selon les recherches du psychanalyste Christophe Dejours, des problématiques telles que l’insatisfaction et l’épuisement peuvent gravement affecter la santé des travailleurs. « L’inadéquation entre la forme créée et la jouissance toujours incomplète de l’artiste ouvre la porte à la sublimation en lui faisant percevoir aussi le manque. De sorte que, sous la pression de la récurrence du manque, il doit reprendre son œuvre, la poursuivre et la faire évoluer. » (Dejours, 2001/2018, p132) Tel le supplice de Sisyphe, le rocher à mener au sommet est toujours plus lourd et dégringole chaque fois plus bas. Les moyens que se donnent le sujet ne suffisent plus à atteindre les objectifs attendus. Il se réalise alors comme une brisure du continuum somatopsychique. La souffrance psychique vient signifier qu’il y a déjà eu précédemment une rupture entre soi et son identité corporelle. Le premier trauma serait cette désintrication pulsionnelle chez le sujet, le second serait l’émergence du symptôme de la douleur ou de l’usure. L’un et l’autre s’entraînant mutuellement. Cette expérience va tarir une libido qui ne parvient plus à se mobiliser pour agir.
Il semblerait que l’équilibre de la santé physique et mentale peut basculer avec un excès de pression vécu au travail. La première victime reconnue du Karōshi, la mort par dépassement du travail, est un jeune employé de 29 ans d’un service d’expédition d’un grand journal en 1969. Le terme sera repris par les médecins japonais Hosokawa, Tajikistan et Uehata en 1982 pour lier des pathologies cardiovasculaires à un temps de travail excessif. De nos jours, de nombreuses recherches viennent étayer la corrélation entre la souffrance du sujet et son travail. L’intensité générée par le contexte professionnel peut mener à des conduites autodestructrices. La passion peut être amenée à faiblir ou à s’inverser en une réelle aversion pour son instrument lors du surmenage.
Ainsi cette jeune patiente, musicienne professionnelle depuis 10 ans, ne pouvait plus, littéralement, toucher son instrument à vent suite à une blessure. L’arrêt brutal de pouvoir jouer de la musique déclenche en premier lieu chez elle une sorte de soulagement. L’obligation de cesser de travailler son jeu supplante un désir aussi grandissant qu’inavouable. Après une discipline acharnée depuis l’enfance pour obtenir un niveau espéré mais jamais atteint pour elle, se révèlent une frustration et une souffrance croissantes. La rivalité avec ses partenaires musiciens sur les comparaisons de temps de travail passé au quotidien sur l’instrument, à toujours repousser les limites physiques l’ont épuisée.
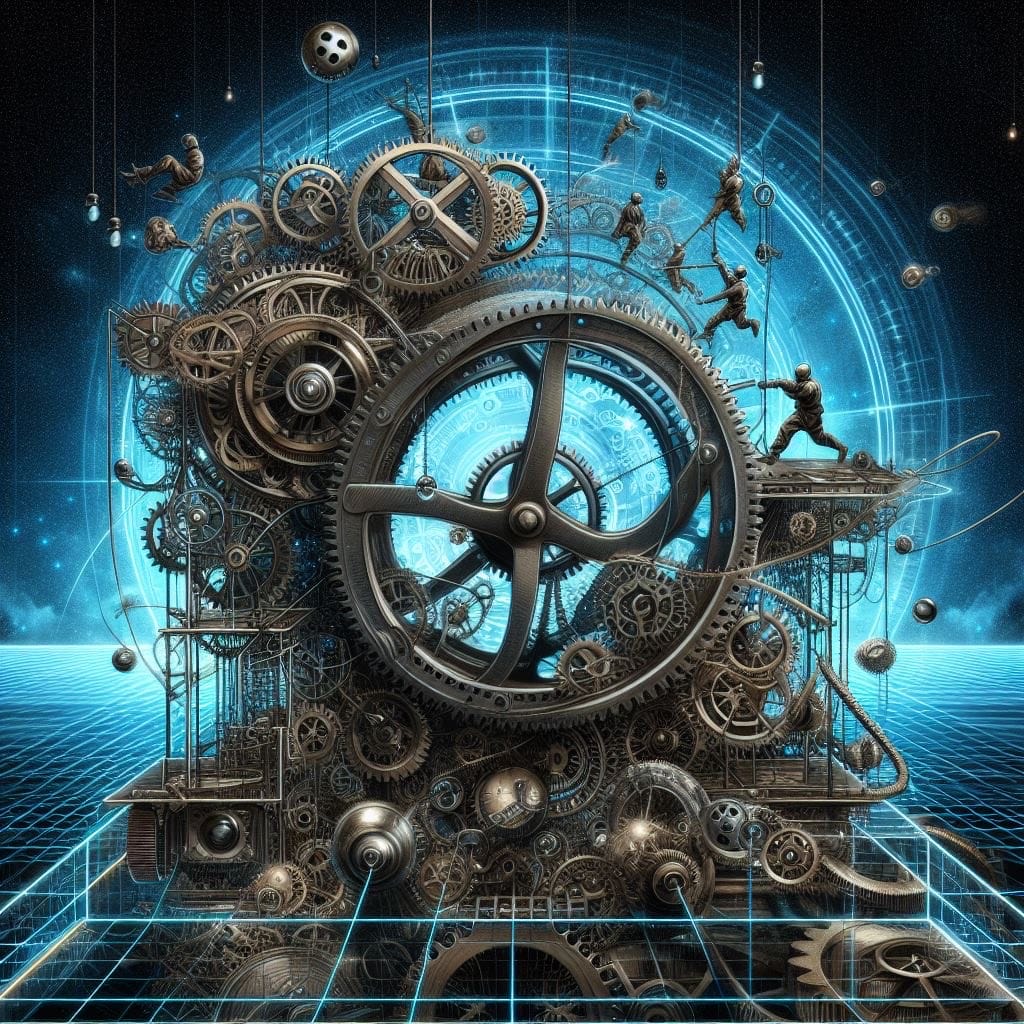
Le Burn-out
La rupture est totale et semble être irréversible. L’idée d’une reconversion après tant d’années de sacrifices, est inconcevable. C’est du fait de ce sentiment de ne pouvoir ni avancer ni revenir en arrière que peut provenir la chute. Dans la clinique, les termes « sans issue » ou « sans solution » reviennent avec redondance. La boussole qui jusque-là guidait tout son investissement n’existe plus. Tout un monde construit de longue haleine se fragmente et n’a plus de sens pour le sujet. Il lui devient impossible de se projeter dans un avenir maintenant incertain. Le désert intérieur, suffocant, devient le monde extérieur hostile qui cerne le sujet en souffrance, dans un mouvement d’introjection projective où tout est calciné autour de soi.
Le Burn-out est un anglicisme du verbe to burn out, brûler à l’extérieur. « Image d’un édifice soumis à une telle attaque incendiaire qu’il n’en demeure que l’armature interne ou encore d’une bougie fondue en consumation dont la matière cireuse s’effondre sur elle-même. » (P‑L. Assoun, 2020, p14)
Le psychanalyste évoque une déliaison qui se couple à « une ruine de l’idéal et une sorte de décroyance généralisée, dans un climat de mélancolisation. » (Assoun, 2020, p15) Le sujet porte un deuil, celui construit à partir de son idéal propre comme collectif et le vit telle une cruelle trahison. (Assoun, 2020, P22)
Les composantes narcissiques et agressives sont au cœur de cette quête de performance, que l’on retrouve également à l’œuvre chez le sportif de haut niveau.
C’est la course effrénée d’une exigence surmoïque qui se retourne contre le sujet. Le surmoi dont Freud fait l’héritier du complexe d’Œdipe se met à le sadiser jusqu’à l’épuisement de ses forces. L’excès à trop vouloir se conformer à ses exigences se transforme alors en une incapacité ou encore en lassitude là où devrait s’exprimer l’explosion d’une fureur.
Freud relève dès 1926 l’absence de l’expression de cette fureur pour un patient atteint de névrose de contrainte : « J’ai pu observer un exemple instructif d’une telle inhibition générale intense et de courte durée chez quelqu’un atteint d’une maladie de contrainte, qui tombait dans une fatigue paralysante d’une durée d’un à plusieurs jours, en des occasions qui auraient dû manifestement entraîner une explosion de fureur. » (Freud, 1926 d, p 208)
Ce musicien encore étudiant, confronté au burn-out, évoluait depuis dans une torpeur permanente. Les situations conflictuelles ne généraient plus ni résistance ni colère de sa part. Face à cet incendie intérieur, le sujet en vient comme à s’éteindre lui-même. L’épuisement intense prend la place de la rage. Le circuit économique libidinal s’inverse et révèle les fragilités antérieures.
Il y a un court-circuit dans la gestion économique des investissements usuels. Le château de carte érigé sans veiller à l’épuisement des ressources s’effondre alors sur lui-même. Ce qui était au cœur de la motivation devient ennemi, absent, voire un persécuteur. Ce qui jusqu’ici nourrissait la motivation du musicien s’amenuise voire disparaît en se transformant en une sorte d’exécration. Tout ce qui le rappelle à lui comme les lieux, l’odeur ou les bruits génèrent de l’angoisse et des conduites de fuite. Le rejet de tout ce qui était adoré avant est un signe clinique très marqué. La pianiste submergée ne pouvait plus voir son clavier sans s’effondrer en larmes, répétant que « cela lui brûlait les doigts ».
« Un autre couple typique de la position paranoïde, fonctionne à l’égard de l’œuvre comme vis-à-vis de toute autre entreprise fortement investie par le sujet. C’est l’alternative idéalisation-persécution. Je veux d’emblée un accomplissement parfait et achevé. La moindre constatation d’un défaut, d’un retard, d’une imperfection, inverse une œuvre qui, dans la tête, valait tout, en une œuvre qui, transcrite sur le papier, ne vaut plus rien ». (Anzieu, 1996/2012, P39)
Nous sommes au cœur du noyau narcissique de la pensée et de la névrose comme Anzieu l’a élaboré.
Les origines archaïques de la constitution du moi expliquent peut-être ainsi pourquoi cette épreuve narcissique du burn-out semble aussi destructrice et questionnent à quelles contrées aux confins de l’être elle renvoie le sujet qui en souffre.
« Le moi se constitue en instance psychique à partir d’un pré-corporel, que j’ai appelé le moi-peau. La situation paradoxale perturbe la constitution du moi-peau et, par là même, grève le développement ou le fonctionnement ultérieur du moi dans certains secteurs. » (Anzieu, 1996/2012, p 94)
« (…) le surmoi ne peut pas évoluer jusqu’au niveau œdipien et ambivalentiel ; il reste confondu avec l’idéal du moi et l’investissement pulsionnel qu’il reçoit est essentiellement le fait de la pulsion de mort ». (Anzieu, 1996/2012, p 94)
C’est d’ailleurs souvent la peau qui parle dans les prémisses d’un surmenage chez l’artiste : elle rougeoie, elle gonfle, s’irrite. Elle montre que quelque chose ne va pas et le dit en modifiant son aspect et son confort. Ensuite tout ce qui lui est relié comme les articulations et les muscles vont se mettre à exprimer le malaise de façon persistante, actionnant enfin l’alarme qui ne jouait plus son rôle d’avertissement. En évoquant Samuel Beckett et son œuvre, Anzieu souligne cet aspect indéfectible dans la constitution du sujet.
« Le lieu du corps d’où parle le narrateur de l’Innommable est significatif : c’est la membrane qui sépare en reliant, l’interface entre dehors et dedans, l’écran protecteur de la violence des intrusions, en un mot le tympan qui vibre aux ondes externes et internes, qui filtre et enregistre les signes sonores, qui fournit au Soi sa première enveloppe et qui fonde la capacité de communication ». (Anzieu, 1996/2012, p 141)
Le musicien surmené pourrait avoir perdu ce mode de communication de soi à soi. Il ne semble plus parvenir à dialoguer avec ses ressentis, ses éprouvés et ses douleurs. L’absence de retour sur lui-même en ce qui concerne la sphère de la proprioception nous indique peut-être une voie à suivre. Ce chemin évoque une phase essentielle élaborée par Henri Wallon, puis par la suite Jacques-Marie Lacan comme étant le Stade du miroir.
Le stade du miroir de Wallon à Lacan
C’est à la demande de Wallon qu’un article de Lacan est publié dans l’Encyclopédie Française, tome VIII en mars 1938. Il s’agit d’une première allocution sur le sujet qui n’a pas pu aller au bout par manque de temps lors d’une conférence internationale de psychanalyse en 1936 à Marienbad. Il y présente les idées principales, préfigurant l’article de 1949 Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique, lors d’une Communication au XVIème congrès international de psychanalyse à Zürich le 17 juillet 1949. (Lacan, 1966, p 89).
Lacan y désigne déjà l’image spéculaire comme illusoire et une révélation soudaine pour l’enfant à partir de l’âge de six mois qui se vivait jusque-là « affectivement et mentalement constitué sur la base d’une proprioceptivité qui donne le corps comme morcelé » (Lacan, 1938, p13).
Le sujet y reconnaît l’idéal de l’image du double. « Le monde propre à cette phase est donc un monde narcissique ». (Lacan, 1938, p14)
Cette étape fondamentale de stade du miroir se comprend comme une identification, jouant tel un imago pour la construction psychique de l’enfant.
« L’assomption jubilatoire de son image spéculaire par l’être encore plongé dans l’impuissance motrice et la dépendance du nourrissage qu’est le petit homme à ce stade infans, nous paraîtra dès lors manifester en une situation exemplaire la matrice, symbolique où le Je se précipite en une forme primordiale, avant qu’il ne s’objective dans la dialectique de l’identification à l’autre et que le langage ne lui restitue dans l’universel sa fonction de sujet. » (Lacan, 1966, p90)
Il s’édifie à ce stade de développement un je-idéal qui sera le terreau et le socle de toutes les identifications secondaires par la suite. Que peut nous apprendre le retour à ces temps archaïques dans la clinique du burn-out et plus particulièrement chez les musiciens ?
Elle nous permet d’observer des phases de régression à des besoins vitaux basiques, une nécessité de récupération massive de sommeil, le besoin de soutien voire de lien anaclitique avec l’entourage. La victime d’un burn-out redevient cet infans qu’il était autrefois. « En fait, le terme latin implique l’absence de langage (in-fans : qui ne parle pas)(…) ». (Winnicott, 1958/1969 p361) Il a une vision morcelée de lui-même, il subit une perte de ses contours et ne sait plus s’appuyer sur lui-même pour vivre. Les attentes sont impérieuses et requièrent une attention accrue de la part des autres. Le sommeil omniprésent se présente comme une fuite face à la frustration et aux risques de conflits.
Ce jeune musicien ne parvenait plus à se lever pour se rendre à ses cours, jouer de son instrument ou voir des amis. Les sorties étaient devenues anxiogènes et souvent irréalisables. Le repli sur soi n’est pas s’en rappeler des temps prénataux où tout besoin est pourvu passivement.
Une perception distordue de ses propres fonctionnements corporels amène le sujet à se sentir comme s’il ne faisait plus Un. Il perd de son unicité primordiale et toute la base narcissique se met à trembler. Les questions existentielles retentissent avec un spectre suicidaire non négligeable. Si je ne suis plus cette unité familière que j’ai toujours connue, comment puis-je continuer à exister ?
« Le stade du miroir est un drame dont la poussée interne se précipite de l’insuffisance à l’anticipation – et qui pour le sujet, pris au leurre de l’identification spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d’une image morcelée du corps à une forme que nous appelions orthopédique de sa totalité, – et à l’armure enfin assumée d’une identité aliénante, qui va marquer de sa structure rigide tout son développement mental. » (Lacan, 1966, p93)
Si la clinique du surmenage nous laisse voir des régressions psychiques aussi profondes, elle ouvre peut-être une porte sur une autre dimension du sujet qui s’y révèle. Cet infans perdu et désœuvré en lui pourrait-il venir de plus loin, de temps plus reculés encore ?
Si les besoins vitaux primaires ressurgissent aussi bruyamment, c’est peut-être qu’ils renvoient à un monde où l’indifférenciation règne en maître. Le sujet ne fait plus Un avec lui-même mais est à nouveau fondu avec l’autre, dans un temps où « Avant de progresser dans l’acquisition d’une identité propre, en se soutenant d’un antagoniste avec le non-soi, le soi-même archaïque doit d’abord se différencier d’avec lui-même ». (M de M’Uzan, 2005, p20) Il s’agit d’un temps où la personnalité n’existe pas encore de manière clairement définie puisqu’elle est encore immergée dans des ondes d’indifférenciation. Qu’en est-il à ce sujet de la clinique du surmenage des artistes ?
Pour être établi, un état de burn-out doit regrouper trois éléments fondamentaux : l’état d’épuisement professionnel, la dépersonnalisation et le sentiment d’incapacité. Un épuisement émotionnel et/ou physique, la déshumanisation de la relation avec les autres et un sentiment de diminution de l’accomplissement professionnel mène à un risque d’effondrement narcissique. Le milieu professionnel de la musique ne déroge en rien à ces risques psychosociaux.
L’étude psychosociale sur le burn-out des musiciens est en effet arrivée à la conclusion que « (…) compte tenu de la production culturelle à grande échelle, avec des lieux de travail réduits, l’exploitation des travailleurs, la peur de perdre leur emploi, l’intériorisation des valeurs organisationnelles et la déshumanisation du métier de musicien, il s’agit d’un professionnel présentant de sérieux risques de tomber malade ». (Andrade et al., 2021, p45)
La fragilité intrinsèque du musicien et l’organisation du travail d’orchestre créent ainsi des situations propices à l’affliction pour ceux qui y participent. Pourquoi alors cette sensibilité chez le musicien et l’artiste en général serait-elle exacerbée ?
Le musicien : artiste aux confins de l’être ?
Le recueil L’artiste et le psychanalyste offre des possibilités de réponse en rendant bien compte à travers le point de vue analytique des divers auteurs de la fragilité du musicien et du créateur.
Ce sont d’ailleurs ses propres failles qui font de lui l’artiste qu’il est. Il est sans doute périlleux pour l’artiste de jouer sans cesse les funambules au-dessus du gouffre de son existence. Mis à mal dans un principe de réalité très contraignant, les ressources internes s’épuisent. L’équilibre jusque-là maintenu au gré du vent peut se rompre, en libérant alors les forces pulsionnelles contraires.
Joyce McDougall nous rappelle à quel point les artistes sont des êtres violents « en ce qu’ils cherchent à exercer leur pouvoir sur le monde extérieur, c’est-à-dire à imposer leurs pensées, leurs images, leurs rêves ou leurs cauchemars ». (Mc Dougall, 2008/2016, p 13)
Le créateur prend sous sa plume les traits d’un volcan en constante ébullition qui s’il en est empêché, est voué à l’explosion. (Mc Dougall, 2008/2016, p 14). Le rapport ambivalent qu’entretient le musicien à son instrument ou l’artiste et son œuvre est constitutionnelle. « Bien souvent, les musiciens se plaignent de détester leurs instruments autant qu’ils l’aiment. » (McDougall, 2008/2016, p17)
L’objet d’une ardente passion peut devenir l’engin de torture par excellence. Avoir le mal de jouer peut conduire l’artiste à haïr son instrument ou sa création.
Les pulsions en jeu sont présentes et se maintiennent intriquées plus ou moins solidement chez le sujet. Mais si l’obstacle vient à mettre en péril cet équilibre, Freud relève que : « La composante érotique n’a, après la sublimation, plus la force de lier toute la destruction qui y est adjointe, et celle-ci devient libre comme penchant à l’agression et à la destruction. C’est de cette démixtion que l’idéal en général tirerait ce trait dur, cruel, qu’est le « tu dois » impérieux ». (Freud, 1923 b, p297-298)
Les motions pulsionnelles se désorganisent et dans la situation du sujet musicien, son unicité narcissique vacille. Comme nous le rappelle De M’Uzan « (…) l’artiste est d’abord une victime et l’exercice de son art, le fait de nécessités rigoureuses ; l’artiste ne dispose que d’une infime liberté, son destin est originellement fixé. » (De M’Uzan, 2008/2016, p37).
Avec le concept d’« a‑personnalisation » il rend compte de ce processus créatif où « (…) l’intime ne se distingue plus de l’extraterritorial ; frontières, limites, séparations se volatilisent cependant que l’immensité se réduit à une poncture. » (De M’Uzan, 2008/2016, p38)
L’artiste aurait ainsi des limites poreuses qui laissent potentiellement le pulsionnel le submerger.
Le surmenage va conduire le musicien à un désordre identitaire dont il va avoir maille à partir. Au-delà des douleurs et de l’épuisement, c’est dans son être primordial que l’abîme s’est creusé. Les épreuves vont mettre à jour les défaillances et les fragilités du sujet. En deçà du domaine narcissique, aux confins de l’être, les fondations originelles se fissurent.
Michel de M’Uzan propose le concept d’Identital pour évoquer ce qui a trait aux « fondements de l’être ». (De M’Uzan, 2008/2016, p40)
« Cet identital concerne l’être même auquel on a surtout accès lors de ses défaillances, par exemple à l’occasion de phénomènes de dépersonnalisation, quand tout vacille, que les limites de la personne se perdent (…). » (De M’Uzan, 2008/2016, p40) Mais ces failles indispensables à l’artiste pour faire vivre son art peuvent dans ce contexte de désordre identitaire menacer « la création d’un double mis en place auparavant pour sortir de l’indistinction première. » (De M’Uzan, 2008/2016, p41)
En effet, ce soi-même archaïque se doit de batailler ferme pour pouvoir « (…) émerger d’une entité syncrétique confuse que j’ai appelée être primordial. » (De M’uzan, 2005, p97 et 98)
Sur la ligne de crête, le péril est imminent quant à ce double créé pour sortir d’un univers indistinct de soi. La menace concerne peut-être ainsi l’anéantissement de ce « double-jumeau » (De M’Uzan, 2005, p21) et un retour à un monde aux limites sans réelle étanchéité. L’angoisse existentielle qui resurgit dans cette clinique touche bien aux contrées les plus lointaines de soi.
La plongée dans les abysses est spectaculaire et parfois foudroyante. Elle laisse néanmoins la possibilité au sujet de renouer contact avec ce qui est le plus édifiant de lui-même, aux sources de son être le plus intime. Mais une perte de ses limites et un doute identitaire majeur se manifestent. Ce qui est alors en jeu a pourtant demandé beaucoup de travail à ce soi-même archaïque. « Il s’agit d’une opération psychique complexe puisque c’est par l’avènement créateur d’un jumeau et d’une relation antagonique avec lui que le soi-même archaïque va pouvoir s’exonérer de l’être primordial et forger les prémices d’une identité distinctive. Ce double-jumeau, émanant d’une activité psychique originale, traduit un travail de « personnation » auquel on ne peut singulièrement accéder, par la suite, que lors d’expériences de dépersonnalisation ». (De M’Uzan, 2005, p21)
Les situations extrêmes ou traumatisantes ont le potentiel de constituer un vecteur processuel à l’émergence de formes archaïques de régressions psychiques du sujet. Au-delà d’un effondrement narcissique, le combat harassant contre l’indistinction première fait rage dans ces circonstances traumatiques. La lutte est exténuante car sans doute les ressources ont été mises à mal et que le risque de perte est fondamentalement effroyable.
« L’artiste, donc, se voit menacé par le système qui, précisément, devait le protéger. Ceci n’a rien de surprenant si l’on admet avec Freud qu’il est probablement doté d’une constitution instinctuelle anormalement forte et que, par conséquent, ses systèmes d’adaptation risquent constamment d’être mis en échec, de telle sorte qu’il est exposé plus que quiconque aux situations conflictuelles. » (De M’Uzan, 1972/1977, p16)
La constitution singulière du sujet musicien le rendrait ainsi plus vulnérable que les autres à certaines situations éprouvantes. Les qualités réclamées à l’artiste telles que s’adapter à la vision du compositeur, rendre sublime à un auditoire des notes et mesures écrites sur du papier à musique ou encore avoir une sensibilité qui doit engendrer des émotions chez celui qui l’écoute, vont être celles qui risquent de le perdre lorsqu’il est en souffrance. Le stress de sa situation professionnelle et surtout de ses conditions d’exercice peuvent littéralement le mettre en pièce, brisant son sentiment d’unité. Le risque de régression est d’autant plus important que les limites narcissiques ont été franchies. Il pourrait dépasser la ligne et alors basculer de l’autre côté de lui-même.
Que se passe-t-il pour le sujet ayant une fois franchi l’autre plan du miroir ?
L’écrivain Lewis Carroll nous en offre une certaine perspective avec la création de son personnage iconique d’Alice aux pays des merveilles. L’aventure contée de cette fillette résonne avec la porosité des limites du musicien et leurs conséquences.

La traversée du miroir d’Alice au Pays des merveilles
Alice s’est mise à visiter les contrées les plus obscures et fantastiques de son propre monde imaginaire en franchissant le miroir et y vécu une quête regorgeant de richesses.
Mais avant toute chose, au préalable de toutes ses aventures, d’abord il y a la chute : « Plus bas, toujours plus bas. N’en finirait-elle donc jamais de tomber ? ». (Carroll, 1865/2009, p 51)
D’abord le sujet se trouve précipité dans le vide. Un effondrement qui peut alors paraître sans fin et le plonge dans l’inconnu.
Dans cette aventure, le personnage de Carroll connaît de nombreux moments éprouvants et déroutants. Sa continuité d’être s’en trouve elle-même questionnée. Sa taille qui rétrécit ou s’agrandit sans son contrôle, la manière dont elle est perçue au travers des yeux de la galerie de personnages rencontrés sur son chemin la pousse à se perdre un peu plus à chaque expérience. Ainsi usée de toutes ces métamorphoses, elle ne sait plus bien qui elle est et si elle se retrouvera un jour telle qu’elle s’est connue.
Elle qui aimait parfois jouer à être deux personnes se retrouve démunie par ce qui lui reste d’elle-même :
« Mais à quoi bon faire semblant à présent d’être deux personnes ! Songea la pauvre Alice. Il ne reste même pas assez de moi pour faire une seule personne digne de ce nom. » (Carroll, 1865/2009, p 56)
Contrainte à trop d’élasticité, son être se réduit comme peau de chagrin. Le double si difficilement acquis dans les premiers âges de vie s’en trouve alors menacé. L’artiste qui se départ de lui-même ressent le désagrègement de sa consistance. Peut-être se rapproche-t-il de trop près de son double en créant ?
« Aux sources foncières de l’inspiration ou, mieux, d’un « saisissement autoritaire », il y a donc un désordre. Désordre identitaire, mais également phénomène de nature « économique » d’une gravité extrême, qui menace même la création d’un double, mis en place auparavant pour sortir de l’indistinction première. » (De M’uzan, 2008/2016, p40 et p41)
Lors de la confrontation avec la chenille, Alice montre aussi le glissement de soi dans une rupture de continuité : « Hélas ! madame, le « moi » que vous me demandez d’expliquer n’existe plus ; Je suis une autre, voyez-vous. » (Carroll, 1865/2009, p 86)
Comment ne pas se perdre en n’ayant plus les moyens d’être dans la même peau ? Alice ne se reconnaît plus au fil de tous ces changements et ressent l’imposture ou la falsification de l’être quand on l’y confronte.
Elle se cherche tout au long de son voyage initiatique sans parvenir à se retrouver elle-même à chaque fois. Pour autant, sa curiosité n’est en rien altérée puisque malgré ce qu’elle a vécu dans son rêve, son désir est à nouveau celui de se frayer un passage de l’autre côté du miroir. En cela le texte écrit après ce premier récit d’Alice aux pays des merveilles en est édifiant. La suite intitulée « La traversée du miroir et ce qu’Alice trouva de l’autre côté » montre une Alice déterminée à voir les choses derrière la paroi glacée du miroir et le monde qui peut s’y révéler à elle : « Faisons comme si la glace était devenue comme un rideau de gaze légère, à travers lequel on peut passer. D’ailleurs voilà qu’il se transforme en une sorte de brouillard ! Nous n’aurons pas de mal à le traverser… » (Carroll, 1871/2009, p172)
La peur ne peut en rien retenir Alice face à ce mouvement spéculaire de voir au-delà de son propre reflet. Pourra- t‑elle continuer à se voir toujours comme elle est une fois s’être traversée ?
Le monde de l’indistinct fait retour dans ce pan de l’histoire d’Alice. Les limites s’effacent et révèlent un milieu fondu et informe. Le passage de l’autre côté se fait retour à la symbiose, où l’indistinction règne.
« Et assurément le Miroir commençait bien à fondre, se dissipant comme une superbe brume argentée. » (Carroll, 1871/2009, p 172)
Cette œuvre littéraire nous éclaire sur ce que le fait de s’approcher de trop près de son double peut mettre en péril. Une fois le seuil franchi, les repères volent en éclat et une même personne ne se ressemble plus. Le retour à l’indistinction primitive renvoie à des angoisses archaïques de perte. Les couches successives de falsification de l’être reviennent avec crudité et ne protègent plus le sujet de se fondre à nouveau en lui-même. Les feuillets superposés s’envolent et continuer à vivre devient alors presque impossible.
Comme l’évoque De M’Uzan sur ce qu’est au fond cette difficulté : « Vivre, c’est-à-dire continuer de ressaisir le passé pour le remanier indéfiniment, pour en construire sans cesse les nouvelles versions, lesquelles, au passage, font surgir en pleine lumière, et avec toute leur charge, des vérités connues depuis toujours et pourtant foncièrement ignorées. » (De M’Uzan, 2005, p45-46)
Par ce regard, l’angoisse de se perdre rencontre également celle de retrouver des figures refoulées très anciennes mais qui n’ont jamais vraiment disparu. Ressaisir les confins de l’être c’est aussi le risque de faire tomber le ou les masques redoutés mais nécessaires à la continuité de son existence. La multiplicité des parements ajoute au trouble de découvrir ce qu’il y a encore derrière celui qui s’efface. L’artiste Constantin Brâncusi interpelle sur la duplicité de soi qui est au cœur de la création : « un dieu qui crée, comme un roi qui commande et comme un esclave qui travaille ». (Marinov, 2008/2016, p100)
À travers son œuvre, C. Brâncusi a tenté de réunir le dualisme du ciel et de la terre par l’évolution de l’oiseau. La cohabitation de ce trio impérieux pour la réalisation de ses créations pose le défi de la perte des limites. Le musicien va lui aussi y être confronté en allant potentiellement au-delà de la douleur.
Travailler comme un esclave pour son art peut représenter un péril majeur pour le musicien. Persévérer malgré la douleur et de ce qui peut lui en coûter peut l’amener sur des sentiers dangereux. Il sait mobiliser des défenses efficaces mais qui ne se tiennent que jusqu’à épuisement. Le compositeur Igor Stravinsky décrit le combat et les batailles qui sont en jeu dans l’art.
« À la voix qui me commande de créer, je réponds d’abord avec effroi, je me rassure ensuite en prenant pour armes les choses qui participent de la création mais qui lui sont encore extérieurs. » (Stravinsky, 1942/2011, p106)
La lutte est incessante et exténuante. Mais l’artiste pourrait-il renier sa nature et ses élans ? L’impulsion est si forte qu’elle ne laisse pas le choix de mobiliser toutes les puissances disponibles.
« Créature moi-même, je ne peux pas ne pas avoir le désir de créer. » (Stravinski, 1942/2011, p95). La pulsion créatrice est un fleuve qui peut se faire torrent même après avoir presque disparu par moments. Il ne se tari jamais vraiment et ne demande qu’à tout emporter sur son passage. Créer ne serait pas ainsi se recréer à soi-même indéfiniment et incessamment ? Après chaque bataille perdue et chaque deuil impossible de soi ? Se recréer perpétuellement montre des mouvements en jeu dans la relation avec la mise en abîme de son double. Au plus près ou au plus loin, se créer pour s’en éloigner et en même temps le garder en son for intérieur pour toujours.
Traverser le miroir et pouvoir en revenir, telle est la tentative désespérée du musicien épuisé. Selon ce qu’il va y trouver derrière, il en reviendra plus aguerri que jamais ou alors dilué dans les ondes premières. La curiosité semble être un moteur précieux pour retrouver une mobilité pulsionnelle et renouer avec ce qui s’est désintriqué dans cet âpre combat intérieur.
« La fonction de créateur est de passer au crible les éléments qu’il en reçoit, car il faut que l’activité humaine s’impose à elle-même ses limites. Plus l’art est contrôlé, limité, travaillé et plus il est libre. » (Stravinski, 1942/2011, p105)

La double bataille du musicien en surmenage
Dompter toutes ces motions pulsionnelles contraires paraît être un défi permanent pour l’artiste.
« Or l’art est le contraire du chaos. Il ne s’abandonne pas au chaos sans se voir immédiatement menacé dans ses œuvres vives, dans son existence même. » (Stravinsky, 1942/2011, p69)
L’équilibre entre toutes ces forces intérieures est fragile. Le musicien réalise sa prophétie en incarnant qui il se pense être. Il ne recule pas devant les difficultés, parfois il les devance puisqu’elles appartiennent à son parcours. Repousser les limites sans briser les remparts est un enjeu majeur pour le musicien.
« Nous fouillons donc dans l’attente de notre plaisir, guidés par notre flair et soudain nous nous heurtons à un obstacle inconnu. Nous en éprouvons une secousse, un choc et ce choc féconde notre puissance créatrice. » (Stravinski, 1942/2011, p99)
L’art de créer se nourrirait ainsi de ce qui s’oppose à lui. La lutte se superposerait alors au combat intérieur qui se joue déjà. Le musicien en burn-out semble porter en lui cette double bataille qui l’a menée à son épuisement.
La complexité du trouble et la longue durée avant le rétablissement du sujet découlent de ces processus tant internes qu’externes qui se confrontent. Les motions pulsionnelles qui y sont à l’œuvre semblent venir d’en deçà du stade du miroir. Sur les rives des « confins de l’être » décrits par De M’Uzan, le musicien exténué a perdu ses contours. Faire face à son double falsifié en le rencontrant à nouveau permet de mesurer l’archaïsme des mouvements psychiques en jeu. Il peut aussi représenter la poncture dans cet « enfer de la créativité » (De M’Uzan, 2008/2016, p.35) par où le sujet peut trouver le moyen de se ressaisir. La capacité à s‘appréhender dans toute sa multiplicité peut-être une des voies de résolution envisageables.
Le musicien surmené pourrait ainsi puiser dans ce miroir traversé un nouvel élan pour se réinventer lui-même.
Bibliographie
Andrade J.G., Brito L.M.P, Formiga N., (2021). Tous les musiciens ne sont pas calmes : du stress au burn-out chez les musiciens d’un orchestre symphonique et les chanteurs de chorale. Italie, Éditions notre-savoir.
Assoun P.-L., (2020/2). Le burn-out à l’épreuve de la psychanalyse. L’esprit du temps. N°77, pages 9 à 26
Anzieu D. (1996/2012). Créer-Détruire. Paris, Dunod.
Carroll. L. (1865/2009). Alice au Pays des merveilles (traduit par L. Bury). Paris, Le livre de poche.
Carroll. L. (1871/2009). La traversée du miroir et ce qu’Alice trouva de l’autre côté (traduit par L. Bury). Paris, Le livre de poche.
Cousin C. (2012). Le Musicien, un sportif de haut niveau. Paris, Éditions Ad Hoc.
Dejours C. (2001/2018). Le corps, d’abord. Paris, Éditions Payot.
De M’Uzan M., (2005). Aux confins de l’identité. Paris, Éditions Gallimard.
De M’Uzan M. (1972/1977). De l’art à la mort. Paris, Éditions Gallimard.
Freud S. (1925)[1926 d]. Inhibition, symptôme et angoisse. OCF.P, XVII : 205–270. Paris, Puf.
Freud S. (1922)[1923 b]. Le moi et le ça. OCF.P, XVI : 257–301. Paris, Puf.
Lacan J.M., (1938). Le stade du miroir. Chapitre 1.2 Le complexe de l’intrusion. Encyclopédie Française. Tome VIII. Paris. Comité de l’Encyclopédie Française Editeur. 8.40- 8
Lacan J.M., (1966). Écrits I. Paris, Éditions du Seuil.
McDougall J., André J., De M’Uzan M., Marinov V., Porret P., Schneider M., Suchet D. (2008/2016). L’artiste et le psychanalyste. Paris, Petite bibliothèque de psychanalyse, Puf.
Stravinsky I., (1942/2011). Poétique musicale. Paris, Flammarion.
Winnicott D.W. (1971/1975). Jeu et réalité (traduit par C. Monod et J.-B. Pontalis). Paris, Gallimard.
Winnicott D.W. (1958/1969). De la pédiatrie à la psychanalyse (traduit par J. Kalmanovitch). Paris, Éditions Payot.
