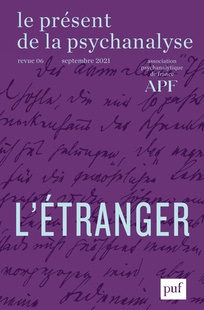« L’étranger » est le titre donné au 6ème numéro de la revue Le présent de la psychanalyse qui nous offre de publier certaines contributions ; ici celle de Jacques André.
« Je vois rien, c’est une fille ».
Les mots de l’échographiste ont fait passer l’équation entre sexe féminin et sexe châtré du fantasme à la réalité médicale observable. L’une n’annule pas l’autre, elle le renforce. Lorsque Louise entend cette phrase, elle a un petit pincement au cœur. Elle espérait un garçon, que son premier enfant soit « un petit être complet ».
Louise n’est pas moins « féministe » que d’autres. C’est une jeune femme d’aujourd’hui, pleinement de son temps. Ses mots, eux, ont l’a‑temporalité de l’inconscient. Ce ne sont pas des mots d’avant, aussi politiquement incorrects soient-ils devenus, ce sont des mots de toujours. Le « petit être complet », cet accent mis sur l’intégrité du corps, rappelle, s’il est nécessaire, que la problématique de la castration est inséparable de l’angoisse narcissique. Freud en tire une conséquence curieuse : il est au moins une relation humaine, écrit-il, qui échappe à l’ambivalence ; entendez, qui ne mêle pas la haine à l’amour, celle « d’une mère avec son enfant mâle »1 . L’intégrité corporelle enfin restaurée, la complétude retrouvée, une naissance qui apporte le petit morceau manquant… Comme quoi on peut être le fondateur de la psychanalyse et ne pas échapper à cette surdité particulière que fomente l’inconciliable inconscient. Parce qu’il faut se boucher les oreilles quand on est analyste pour ne pas entendre, à travers les mots d’une mère sur le divan, la sournoise ambivalence pour le « fils bien-aimé ». À sa décharge, c’est vrai que lorsque Sigismund avait 75 ans, sa mère Amalie, qui en avait alors 94, n’appelait son fils aîné et préféré jamais autrement qu’en le nommant mein goldener Sigi !
Différence, le mot distingue une chose d’une autre, il repose sur la négation, celle qui marque l’écart, et relève de la logique. Bien difficile pour les sexes, quand c’est en terme de « différence » que l’on pense ce qui les sépare, de ne pas se soumettre à la logique phallique : l’avoir ou pas. Moins une différence des sexes, qu’Un sexe qui fait la différence. « Je vois un petit truc (parole d’un autre échographiste) », ou « je vois rien ». Logique binaire en 0–1 qui ne commande pas que l’intelligence artificielle.
Différence, négation, logique, binaire… autant de mots qui portent la marque de l’élaboration, celle des processus secondaires. À quel étage de la vie psychique se situe la version phallique de la différence des sexes ? La marque narcissique qui l’accompagne rappelle que le moi en est partie prenante. Le discours manifeste d’une femme prise dans les rets du complexe de castration prend bien souvent la forme d’une litanie : « Je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je n’y arriverai jamais… » Entre ces mots et la représentation du « petit truc » qui fera toujours défaut, il y a certes un degré d’inconscience, et le plus souvent un refus de l’entendre. Que cela tourne au trait de caractère, et cette conviction d’une valeur moindre se révèle d’une fixité sur laquelle l’analyse vient buter. Toutes ces résistances définissent-elles pour autant le « morceau manquant » comme une représentation de l’inconscient, au sens topique du terme, ou plutôt comme une traduction, une symbolisation d’une chose plus enfouie et bien moins maîtrisable ?
Sur cette piste, l’incertitude de Freud est un guide paradoxal. « Le caractère majeur de l’organisation génitale infantile est qu’il n’existe pas un primat génital mais un primat du phallus. »2 Voilà qui a le mérite d’être clair, sauf que l’obscurité, celle de l’inconscient reprend immédiatement ses droits. Cette phrase à peine énoncée, Freud ajoute ce qui est plus qu’une nuance : « Malheureusement nous ne pouvons décrire cet état de fait que pour l’enfant masculin, l’intelligence des processus correspondants chez la petite fille nous manque. » Terra incognita. « La vie amoureuse des femmes est voilée d’une obscurité encore impénétrable… notre intelligence des processus de développement chez la fille est peu satisfaisante, pleine de lacunes et d’ombres… » Des mots obscurs qui résonnent comme autant d’images (c’est-à-dire de fantasmes) de la chose même, et que condense la célèbre métaphore du dark continent3 . Plus Freud construit une théorie phallique de la différence des sexes, théorie très claire, trop claire, plus se condensent féminité et obscurité.
Un passage du « Tabou de la virginité » décrit, mieux qu’un autre, ce glissement de l’altérité féminine, son étrangèreté (Fremdheit), à sa réduction, sa traduction en termes de castration :
« Là où le primitif a posé un tabou (celui de la virginité), c’est qu’il redoute un danger, et l’on ne peut écarter l’idée que dans toutes ces prescriptions d’évitement s’exprime une crainte de principe devant la femme. Peut-être cette crainte est-elle fondée en ceci que la femme est autre, qu’elle apparaît éternellement incompréhensible et mystérieuse, étrangère et partant hostile. L’homme redoute d’être affaibli par la femme, d’être contaminé par sa féminité et de se montrer alors incapable. L’effet du coït, ramollissant et résolutif des tensions, peut bien être le prototype de ce qu’il redoute ici, et la perception de l’influence que la femme acquiert sur l’homme par le commerce sexué, la considération qu’elle extorque par là, peuvent justifier l’extension de cette angoisse. Dans tout cela il n’est rien qui aurait vieilli, rien qui ne continuerait à vivre parmi nous. »4
Tout se passe comme si l’homme se vengeait de cette aventure périlleuse (Through the dark continent), qu’il paye de sa virilité ramollie, en attribuant au sexe féminin la castration qu’il vient de subir : « Quant au fondement de la récusation narcissique de la femme par l’homme – largement empreinte de dédain –, la psychanalyse croit en avoir deviné un élément capital en renvoyant au complexe de castration et à son influence sur le jugement porté sur la femme. »5 La femme était une « dangereuse étrangère », le narcissisme des petites différences la ramène à une « moins que rien ».
Les incertitudes de Freud‑l’aventurier sont inséparables d’une autre découverte : Athènes‑l’oedipienne n’est pas la civilisation première. Son éclat dissimule un monde plus enfoui, objet d’un « refoulement particulièrement inexorable », les civilisations de Minos et Mycènes. Derrière les amours oedipiennes de la fille et du père, la liaison originelle de la fille à la mère… C’en est fini de l’espoir d’une symétrie entre les histoires psychosexuelles du garçon et de la fille. La différence (phallique) des sexes n’est qu’une façon de remettre de l’ordre dans leur dissymétrie. Formulé autrement : autant le phallicisme de la différence est redevable à l’économie narcissique (le sexe est Un, présent ou absent), autant la dissymétrie reste empêtrée dans l’obscure altérité 6 (où commence, où finit le sexe féminin ? il ne suffit pas qu’il affiche la complexité clitoris-vagin, il faut encore qu’il ouvre sur « l’origine du monde », là où se font les enfants). Le sexe féminin « est un abîme où l’homme menace de se perdre sans retour », parole d’un célèbre mélancolique (Althusser) qui n’a trouvé d’autre issue à son angoisse devant la femme si étrangère qu’à tuer la sienne.
Deux brèves remarques cliniques pour donner corps à la dissymétrie…
Le fiasco. Passons sur le cas de figure où la « déprime » du phallus signe le triomphe de la femme castratrice ! Le scénario le plus commun réunit un homme chez qui l’auto-castration du membre répond à l’angoisse du même nom, provoquant un repli narcissique ; et une femme qui pense ou dit : il ne me désire plus, il ne m’aime plus… et comme l’inconscient ignore la nuance : « plus jamais ». Angoisse de castration d’un côté, angoisse de perte d’amour de l’autre. La dissymétrie des angoisses redouble celle des sexes.
Autre exemple, le rabaissement… Le femme sait y faire, à l’image de Marie Dorval, la muse des poètes, moquant Alfred de Vigny pour la « petite élévation » dont il est tout juste capable. Le rabaissement de la femme par l’homme suit une tout autre piste, celle de la « porte du Diable » (Tertullien), de la « sauvage au-dedans » (Diderot), de l’insatiable putain. Le rabaissement de l’homme le châtre, fait de lui un impuissant. Le rabaissement de la femme fait d’elle une pute. L’un n’a pas de sexe, l’autre n’est qu’un sexe.
Résumé : La version phallique de la différence des sexes est inséparable chez Freud d’un aveu d’inconnu et d’obscurité en ce qui concerne la psychogenèse de la féminité. La femme « châtrée » laisse dans l’ombre une femme autre, étrangère et dangereuse.
- OCF XVIII, 300
- OCF XVI, 306.
- OCF XVIII, 36.
- OCF XV, 86. (Les mots soulignés le sont par moi)
- ibid
- Ces formulations, sans doute trop condensées, ont pour toile de fond une argumentation sur la féminité longuement développée dans : Aux origines féminines de la sexualité (1995), Quadrige, PUF, 2004.