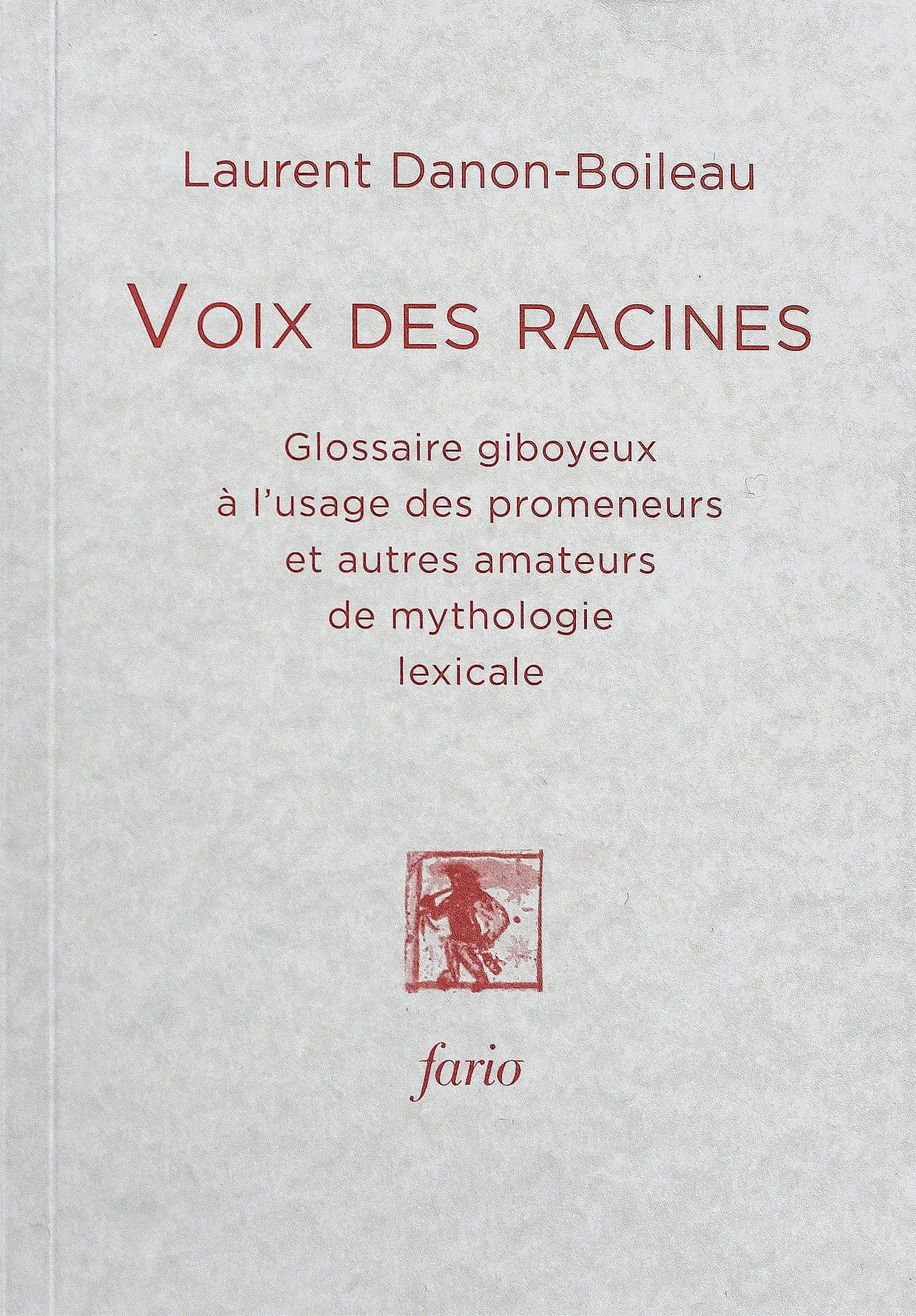Jean-Claude Rollet est psychiatre à Roanne (Loire).
Il arrive parfois qu’avant même d’ouvrir un livre, le futur lecteur soit séduit par l’objet qu’il représente et le plaisir est comble quand il n’est pas lié à un élément de couverture surajouté, photographie ou dessin par exemple, mais bien par une esthétique intrinsèque à l’ouvrage, comme ici son format si bien adapté à la préhension de la main et qui fait songer à l’harmonie du rectangle d’or, tant ses proportions sont parfaites, ainsi que la couleur parcheminée de sa couverture, le rose sépia de ses titres et écrits de présentation. Il s’y ajoute la petite gravure assez énigmatique qui réclame la loupe et à laquelle sera associée un peu plus loin la locution latine « Piscis hic non est omnium » : ce poisson-là n’est pas pour tout le monde, phrase qui fut placée par Denis Diderot en exergue de sa première œuvre[1]. Le livre de Laurent Danon-Boileau Voix des racines, se présente donc comme un précieux coffret et l’on n’est qu’à peine surpris en l’ouvrant, d’y trouver des mots dont le sage ordonnancement ne dissimulera pas longtemps la révélation de l’étonnante puissance de leur essence.
Trop souvent, la vie quotidienne nous confronte et nous habitue à une maltraitance des mots. Particulièrement en communication verbale, on les trouve embrigadés sans respect dans d’insipides logorrhées qui colonisent les espaces de paroles pour mieux endoctriner l’auditoire. Les discours sont déversés à flot continu, cataractes déferlantes, juxtaposant leurs fragments raccordés en d’interchangeables séquences, sans même s’octroyer l’espace d’une respiration. Les mots deviennent des esclaves qui en sortent usés, rincés, vidés de leur substantifique moelle, errant comme des âmes en peine à la recherche de leurs racines dont ils furent arrachés par l’ouragan verbal. L’auditoire consterné rêve d’assister à une pensée en état d’élaboration, confrontée aux embûches de la maîtrise du verbe, intégrant des silences, prenant le temps nécessaire pour parvenir à convertir les mystérieux mouvements de son flux mental en des mots adaptés venant à sa rencontre. Comme la déesse du poème de Parménide[2], cette pensée génératrice d’elle-même à travers les mots, pourrait dire : « Peu importe par où je commence puisque je reviendrai sur mes pas ». Tout se passe comme si la pensée ne devenait langage qu’en dialoguant avec ce dernier.
Voix des racines est un havre pour les mots. Ils s’y ressourcent à leur contact après avoir navigué sur l’océan du langage. Le petit personnage emblématique des Éditions Fario, vagabonde à leur manière sur les chemins de parole, portant dans son sac à dos son quantum de codage. La citation latine de Diderot se trouve aussi au seuil de Voix des racines. Pour l’encyclopédiste s’agissait-il seulement de désigner un livre dont le contenu dérangeant n’était pas à mettre entre toutes les mains ? Une autre raison commune à laquelle Laurent Danon-Boileau fait allusion en quatrième de couverture par une phrase extraite de la préface, motive ici sa présence : nulle élaboration de pensée en langage ne saurait prétendre à la maîtrise du verbe. Diderot refuse la notion d’une œuvre univoque, elle ne peut qu’être approximative, à plusieurs voix, résultant d’un ensemble de processus singuliers, accroissant ainsi le hiatus entre elle et celui qui se trouve être son auteur, comme entre un signifiant et son signifié. Il existe toujours une superposition de possibilités, comme si l’intuition quantique affleurait depuis longtemps chez nombre de penseurs, réfutant l’idée de la représentation unique. Les racines vibrent à travers leurs mots, et celui qui les emploie comme vecteur d’un sens à transmettre, doit s’attendre à ce qu’ils ne se comportent pas forcément comme de dociles véhicules. Pour autant, il ne s’agit pas non plus d’un parasitage inopportun, mais plutôt d’un étrange retour à une complexité, que la perception du réel nous a contraints à simplifier. Ainsi, ce poisson n’est pas davantage le même pour tout le monde, qu’il ne renseigne sur celui qui l’a péché.
Citant un texte de Plutarque, Laurent Danon-Boileau rapporte un événement où le grammairien Épitherses, passager d’un navire encalminé dans les parages de l’île Paxos, entendit annoncer par une voix de provenance indéterminée et comme surnaturelle, la mort du grand Pan, à la stupeur générale et consternée de la foule qui en fut témoin. La condition nécessaire à cette proclamation était l’immobilité du bateau sur la mer, comme si l’instant se devait d’emprunter au mouvement une identique suspension, pour mieux signifier un avant et un après ou plus rien ne serait semblable. Fils d’Hermès et de Dryope (ou de Pénélope), Pan, dieu de la vie, du désir, de l’animalité, de la fécondité, de l’universel, de la nature sauvage, des bergers, des troupeaux, mais aussi du désordre et de la panique, devait son nom au fait d’avoir été unanimement accueilli par tous les dieux de l’Olympe. Ils étaient les divinités de la troisième génération, sur laquelle Zeus régnait en maître, après avoir réglé leur compte aux Titans, aux Géants et même, non sans peine, au redoutable Typhon. Si Zeus était le dieu justicier et ordonnateur de l’univers, Pan était celui de la puissance créatrice empreinte d’une certaine sauvagerie, d’où son nom de Grand-Tout, mais plus tard, sa laideur finissant par déranger, il s’était exilé sur terre parmi les mortels. En Arcadie, il n’avait pas échappé à la maxime latine « Et in Arcadia Ego » : moi (la mort) je suis aussi en Arcadie. L’immortalité des dieux ne s’entendait qu’au sein de l’infini d’un temps achevé, qui venait donc, semble-t-il, d’advenir. C’est du moins ce que racontait ce récit énigmatique, annonçant peut-être avant tout, la fin du polythéisme.

Avec la mort de Pan, la nature perdit cet enchantement, qui associait son aura de spiritualité à la matérialité des objets, célébrait la joie du miracle inclus dans la vie, chantait le mystère universel que Pan accompagnait du son de sa flûte. Le réel ne s’en trouvait pas pour autant plus accessible, mais l’enchantement des perceptions favorisait un dialogue affectif capable d’ouvrir l’inatteignable à l’exploration du récit. Les dieux, tout à la fois humains et non- humains peuplaient cette interface, traçant des chemins à travers les incertitudes, les intuitions, les hasards, les désirs et les doutes, la sage protection ou la sauvagerie. Pan se présentait comme le potentialisateur de ces processus, celui qui les chargeait d’énergie pour les imposer à l’entendement, sans craindre le désordre ni la panique résultant de leur étrangeté. Mais le désenchantement de la nature abandonna les sortilèges de ces réseaux d’objets pour une existence réduite à leur stricte perception. Si Pan mourut à l’articulation du polythéisme et du monothéisme et que les dieux de l’Olympe se retrouvèrent en débandade, c’est non seulement qu’il ne peut y avoir de monothéisme sans un polythéisme préexistant, mais aussi que la raison souhaitait mettre un terme, ou du moins ordonner et canaliser, une imagination perçue comme trop effrénée. À ce stade de la culture humaine, il convenait désormais d’examiner les choses objectivement et rationnellement, l’une après l’autre, et non toutes à la fois. Le Dieu unique dans son omniprésence, étant créateur et possesseur de la nature, ce n’était plus qu’à travers lui qu’on devait la percevoir. L’ancien dialogue de liberté, cédait la place aux dogmes et aux rituels.
Une fois éliminés les préfixes et suffixes, la racine d’un mot représente son unité irréductible, sa plus ancienne partie, sa matrice à partir de laquelle se formeront tous les mots apparentés. « Après la mort du grand Pan, écrit Laurent Danon-Boileau, les mots furent le refuge ultime de quelques dieux païens qui, résolument, voulurent demeurer ici-bas ». Il est vrai que leur commerce avec les humains était si intense, que l’on peut imaginer leur désarroi à la pensée de ne plus exister qu’entre eux, assignés tristement à l’Olympe. Se faufiler au cœur des mots pour s’y réfugier était donc une divine stratégie, l’assurance de rester présent au sein de la plus fondamentale des affaires humaines, puisque toujours parcourue du désir, celle du langage. Qu’elle soit celle du végétal qu’elle soutient et nourrit, ou celle du mot qu’elle fait exister en lui donnant un sens, la racine demeure masquée, comme invisible, élément du monde souterrain, de la mémoire enclose. Mais si les dieux devenus obsolètes s’abritèrent dans les mots, l’esprit du paganisme n’y régnait-il pas depuis toujours, en un éternel présent ? Sans ce constant processus pour enchanter le mur obscur du réel, comment l’homme plongé dans la profusion des signes, symboles et phénomènes, serait-il parvenu à les agencer pour qu’en émergent le langage et la pensée ?
Par le terme « Agiter », l’auteur ouvre avec humour son « Glossaire giboyeux » sur une démonstration révélant erronée la première étymologie étudiée. Le gibier est des plus massifs, puisqu’il s’agit d’un ours, animal turbide dont l’anthropologue Nastassja Martin essuya dramatiquement l’agressivité. Elle décrit dans un livre Croire aux fauves, sa rencontre catastrophique avec le plantigrade sibérien dont elle sortit défigurée. Du mot « agiter » qui lui vint de cet accident d’une violence extrême, elle dériva l’association « a‑gîter » pouvant qualifier l’agitation capable de s’emparer d’un être vivant privé de son gîte protecteur, perçu comme son lien d’appartenance au monde. « Hélas, nous dit Laurent Danon-Boileau qui regrette de ne pouvoir valider une si belle trouvaille, cette étymologie est erronée. Le mot dérive, plus vraisemblablement, du verbe agitare, forme dite fréquentative qui exprime un renforcement intensif du sens du verbe agere, lequel signifie mettre en mouvement, faire bouger. » Cependant, les erreurs n’empêchant pas les associations, il me vient à propos de ce qui a été dit plus haut sur la maltraitance des mots, manipulés dans le dédain du respect des gîtes que sont leurs racines, qu’ils pourraient bien finir par s’agiter comme des ours mal léchés.
S’il fallait n’élire qu’un seul terme dans le foisonnement des mots de cet étonnant glossaire, mon choix retiendrait « Parole », vocable offrant son chemin de langage au lecteur rêveur qui parcourt ce wonderland lexical. Alice y chute-t-elle doucement au profond de son puits, observant au cours de sa descente l’étrange logique souterraine des racines des choses ? Elles forment des entrelacs dont la densité est à l’aune de la forêt des mots. Laurent Danon-Boileau en cite tour à tour les plus fréquentes que l’on mentionne seulement ici : fari, qui convertit en langage le flux de la pensée et dont découle fabula, la fable, qui met la parole en récit et fatum, qui du discours des dieux fait le destin des hommes ; puis paraulare, parler, la parabole ; loquor, le logos, l’énoncé, le discours, raisonnement logique qui agence entre eux les objets verbaux en établissant des liens formés par la pensée, générant en retour une pensée qui se déploie continument en établissant de nouveaux liens. Mais l’auteur évoque aussi deux processus ayant en commun de sursoir à la déroute de la fonction d’enchaînement pur du logos. Le satori de tradition japonaise, qui agit comme un réveil, brisant le déroulement des représentations établies. Par exemple, il en va en analyse de l’effet archétypal de l’interprétation, capable de changer le référentiel d’une perception, en la déplaçant vers un autre point de vue. Puis mythos, le mythe, et sa racine mu, renvoyant au corps, à l’animalité, mugissement des bêtes, origine du discours. Comme le satori, le mythe vient rompre l’agencement logique du logos, lorsqu’une telle nécessité l’impose. Il est un récit imaginaire proposant l’explication de la venue à l’existence d’une réalité ancestrale qui en est dépourvue. Roland Barthes[3] y voyait un processus sophistiqué dans lequel l’histoire du mythe prenait pour signifiant le signe d’un récit préalable. Satori et mythos sont comme de complexes agents d’ajustement au spectacle de l’existant, pour maintenir une cohérence que l’agencement du logos n’a pas réussi à poursuivre. La racine dic, quant à elle, indique à la manière de l’index, désignant un objet à partager dans le dialogue, en écartant ceux de son environnement, mais aussi en le présentant comme conforme au droit. Elle a donc valeur de justice en pointant le bien et marque aussi la prégnance du locuteur sur celui qui écoute.
Le logos nomme et crée des liens entre les objets de pensée pour les agencer en vastes réseaux, rendant perceptible et appréhendable une réalité du monde, reflet d’un réel à jamais obscur. Les racines des mots dont traite cet ouvrage tant érudit que captivant, paraissent effectivement, telle une toile dont une Arachné pérenne étendrait indéfiniment la vastitude, établir des ponts, murmurants et mouvants, entre une rive « être », telle celle des phénomènes perceptibles et l’autre « étant », celle des récits portés sur cette perception. Il est donc bien question d’arche, dont l’auteur précise le terme hébreu : tevah, nommant à la fois la nef de Noé flottant sur la colère océanique de Dieu, mais aussi la parole, comme filtre perceptif d’un chaos trop violent pour l’humain. Car si le logos réunit, il sépare aussi, les points d’union et de clivage s’étant déplacés jusqu’à former d’autres objets, aboutissant au monde intelligible où peut circuler la pensée. Le langage mathématique est de cet ordre, s’il nous arrive d’être ébahis de découvrir un univers répondant aux lois des équations, tel que l’aurait créé un Dieu mathématicien, c’est peut-être que notre flux de pensée a agencé nos perceptions selon ces liens logiques, pour en faire le récit d’un monde dont notre esprit puisse saisir la représentation.
L’expression « joindre le geste à la parole » a valeur éthique, puisqu’elle signifie tenir ses promesses en faisant ce que l’on a dit. Pourtant dans son sens premier, elle évoque le fait d’accompagner son discours d’une gestuelle venant le souligner, l’affirmer, le compléter, en associant au lien auditif avec son interlocuteur, une expression visuelle l’invitant dans un espace d’échange. Cette gestuelle expressive renvoie peut-être aux origines du langage, que ce soit à l’échelle de l’individu, ou à celle de l’espèce, quand un langage balbutiant émergea d’une expression plus globalement corporelle. Laurent Danon-Boileau précise à quel point la gestuelle, la posture, la mimique et la prosodie, créent avec l’autre, un espace transitionnel parcouru d’affects et de ressentis, au point que ce langage gestuel traverse parfois le temps en ayant acquis une telle stabilité, qu’il demeure sans être affecté par l’usage d’une succession de langues différentes. Comme la prosodie, la gestuelle associée à la parole, signe la profonde origine affective du langage. Ce n’est certes pas l’intellect qui fait venir les mots aux lèvres des enfants quittant le stade infans pour atteindre sa racine fari, mais bien l’élan vers l’autre et la joie d’être en vie et de nommer le monde pour le faire exister. L’intellect ne vient qu’après, et contient en son sein tout l’affect, au point que l’on peut se demander s’il n’est pas un processus supplémentaire du désir pour atteindre son accomplissement, comme dans la sublimation.
Désirer justement ! L’auteur nous indique sa racine sidus, l’étoile, la constellation. Fascination pour la puissance divine, mais aussi desiderare, l’éloignement de l’objet du désir, le désastre, l’astre détruit, la sidération à l’annonce de la mort du grand Pan. L’homme cherche dans le langage la satisfaction d’un désir qui ne saurait être nommée et c’est bien ainsi, car les récits ont l’avenir pour eux.
En soufflant à Laurent Danon-Boileau la nécessité́ d’arrêter là son œuvre, la déesse Ananké, défendant son omnipotence, a‑t-elle songé que par la voix des racines, les dieux s’étaient déjà suffisamment dévoilés aux mortels ? Sans oser la contredire, ni vouloir prolonger les racines en d’infinis rhizomes, ces quelques lignes ne sont que de « fraternels échos » adressés à l’auteur, par un scribe promeneur, livré à la rêverie de cette prosodie sur son entendement.
[1] Denis Diderot. Pensées philosophiques. Piscis hic non est omnium. Hachette BNF, 2022.
[2] Jean Beaufret. Parménide. Le poème. PUF, 2013.
[3] Roland Barthes. Mythologies. Seuil, 2011.